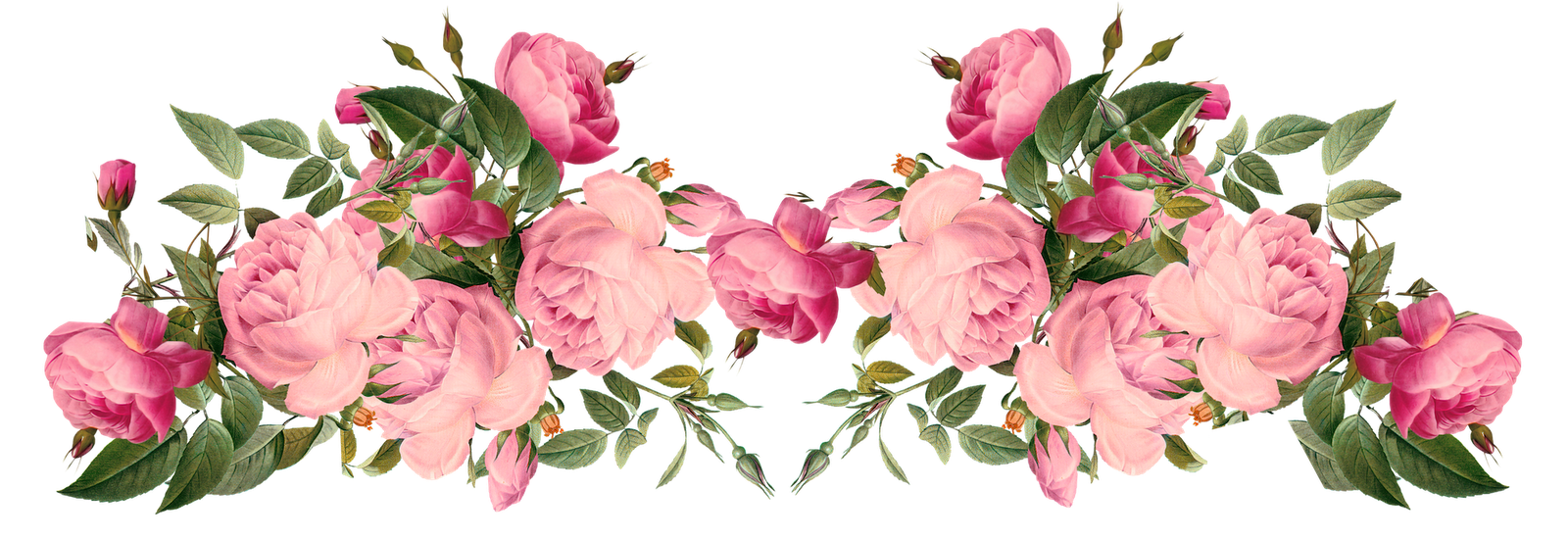Votez pour votre nouvelle préférée
Catégorie "Nouvelles"

ATTI 0503
Un nouveau monde
Lorsque j'ouvris une nouvelle fois les yeux, le monde que je trouvai était bien différent de celui que j'avais laissé auparavant. Tant de printemps s'étaient écoulés depuis ce fameux jour qui avait tant emporté avec lui. Tant d'heures à vivre dans la pénombre, cherchant cette fine particule de lumière qui allait redonner un sens à cette existence vaine et dénuée de sens qu'était la mienne. Pourtant, jamais je n'avais vu une once de chaleur dans le désert glacé qu'était devenu mon coeur, et cela n'allait pas changer pensais-je.
Le printemps, ma saison favorite. Chaque matin, j'entendais ces chants harmonieux provenant des oiseaux encore dans leur nid. Cette mélodie signifiant que la vie avait triomphé de ses heures sombres passées dans le froid et la pénombre, transportant un message d'espoir m'allant droit au coeur. Tous les matins j'entendais le bruissement généré par le vent frais soufflant inlassablement sur ces feuilles d'arbres qui se laissaient porter délicatement sans penser au lendemain. Encore et encore... Le printemps était une tentation permanente pour mon coeur noyé dans la tristesse et l'amertume. Il me poussait à ouvrir mes fenêtres, sentir cet air pur et vivifiant – bien qu'un peu trop frais je le concède, envahir mes poumons pour les emplir de renouveau. Et chaque matin je cédais à la tentation et je respirais cet élixir de bonheur simple octroyé par la nature. C'était ainsi que commençait chaque journée de mon quotidien banal et ordinaire.
Je me nomme Vincent, je vis dans une petite maison de campagne, en Auvergne. J'ai trente-cinq ans, mais je ne vois plus vraiment le temps passer depuis que je me suis installé dans cet habitat qui me sert de refuge en marge du monde. A vrai dire, il y a bien longtemps que ces yeux ne m'avaient plus rien montré de nouveau. J'ai perdu la perception visuelle des choses depuis mon vingt-sixième anniversaire. Depuis, le simple fait de poser mon regard sur les oiseaux, me perdre dans la vaste étendue azur qu'est le ciel d'Auvergne, ou encore contempler le visage des êtres chers...Tout cela m'est impossible. Avant cela, j'avais une vie. Une vie remplie faite d'un travail, d'une femme aimante et d'une petite-fille adorable. Une vie classique que tant d'hommes aspirent à avoir. C'était ma vie à moi. Mais tout s'était envolé brutalement le jour d'un accident de circulation.
Une soirée trop arrosée, suivie d'une conduite en état d'ivresse, le tout avait eu raison de ce quotidien banal et ordinaire. Si ma femme s'en est sortie indemne, ma fille, elle, n'avait pas eu cette chance. Dieu merci, j'ai appris que les éclats de verre projetés dans l'accident m'avaient rendu aveugle avant d'apprendre que ma fille n'allait plus jamais sourire. Depuis, ma femme m'avait quitté , et j'avais été contraint de changer radicalement de mode de vie. Finies les soirées au coin du feu en train d'admirer ma progéniture vaquer à ses occupations. A la place, c'était l'ombre. L'ombre la plus totale et opaque. Celle qui était la perpétuelle compagne des déprimés, des malheureux d'amour et des rejetés de la vie.
Alors pour survivre j'avais appris à voir ce qui n'était pas perceptible pour ceux qui avaient encore leurs yeux. Et pour être honnête, j'avais l'impression que jamais je n'avais été aussi clairvoyant que depuis que j'étais aveugle. Ce qui ne me semblait être que des broutilles, des acquis, des choses que la nature devaient à l'homme était en fait un trésor que chacun devait chérir au quotidien. Je passais mon temps à regarder droit devant moi, sans prendre le temps de m'arrêter, alors que le véritable sens de l'existence se trouvait autour de moi. C'était assez paradoxal je l'avoue d'en arriver à une telle conclusion, mais c'était là ma raison d'être. Ma philosophie. Ainsi je passais pas mal de mon temps à ressentir les choses et à essayer de reconstituer ces quelques rêves perdus grâce aux souvenirs visuels du temps où j'étais encore capable de voir ce qui m'entourait. Toutes ces images formaient de nouveaux rêves qui nourrissaient mon coeur.
Ainsi je fabriquais moi-même le décor de mon quotidien. Lorsque j'entendais ces oiseaux, je les imaginais les uns contre les autres à chanter en ch?ur. Les arbres fouettés par le vent laissant échapper un faible son réconfortant me faisaient imaginer la couleur de ce rideau de feuilles que le soleil essayait en vain de pénétrer. Mais encore, ces abeilles qui se préoccupaient activement de leur prochaine récolte de miel, pour satisfaire les désirs de la reine et remplir leur besogne.
Nous étions finalement similaires malgré les différences séparant nos espèces. Nous avions tous un labeur à accomplir pour des proches, pour une famille, pour assurer l'avenir de nos générations, et pour être honnête, outre ma fille, c'était ce qui me manquait le plus à l'heure actuelle. Ne plus avoir cette responsabilité à assurer. Alors il avait fallu que je me trouve une autre occupation toute aussi prenante, et ce fut dans la culture que je trouvai mon réconfort. A l'aide de mon allocation mensuelle, je me payais ainsi un quotidien fait de fleurs et de jardins.
Je ne sortais pas énormément de cet habitat coupé du monde qui était le mien. Ma voisine, une vieille dame de quatre-vingt ans que tout le monde appelait « Madame Delanoy » venait me rendre visite tous les jours pour me ramener quelques provisions qu'elle achetait en même temps que ses courses. Comme moi, elle était plutôt dépendante, alors nous nous serrions les coudes en nous aidant mutuellement. Elle m'aidait à jardiner, à planter, en me dirigeant lorsque j'en avais besoin, puis nous nous retranchions dans la cuisine pour boire le thé, et je la laissais me raconter ses souvenirs de jeunesse, me parler de sa fille qui était partie tenter sa chance en ville avec un jeune homme de bonne famille. J'écoutais inlassablement ses histoires et j'en imaginais les détails. Madame Delanoy était une présence apaisante qui m'aidait à oublier mes troubles personnels l'espace d'un instant. Puis je retournais dans mon jardin cultiver mes roses, mes fruits, mes légumes, que j'arrivais à reconnaître malgré ma cécité. Chaque rose était unique. Chaque fruit était unique. C'était mon nez qui me l'avait appris. Chaque odeur était différente, avait ses nuances, son propre caractère. Ainsi, il suffisait que je sente l'un des fruits de mon labeur pour reconnaître ce qu'il était. Comme un parent peut reconnaître ses enfants bien au-delà de leur apparence, j'étais capable de reconnaître mes compagnons rien que par l'odeur s'en dégageant. Chaque pousse provenant de ce jardin était donc unique, du moins à mes yeux. Unique aussi pour madame Delanoy à vrai dire, qui prenait le temps de parfumer chaque sachet de graines disposé dans mon jardin d'un parfum différent afin que je puisse garder un minimum d'indépendance dans mon activité principale.
C'était ainsi que se déroulait chaque journée de mon quotidien. Cultiver mes plantes, rester à l'écoute de la nature, parler avec ma chaleureuse voisine, me hâter à ma fenêtre pour écouter les enfants rentrer de l'école et les saluer, puis retourner à mes occupations routinières jusqu'à trouver le sommeil. Mais chaque fois que je me laissais aller, que je cessais d'emplir mon esprit de rêves, la dure réalité revenait à moi.
Dès que je trouvais le sommeil, les sombres images de mon irresponsabilité me revenaient en mémoire. Cette fameuse journée où j'avais du travailler à une cadence folle simplement pour espérer que mon contrat soit renouvelé. Cette soirée où, dépassé par mon travail je lâchai un « Allons sortir ensemble pour oublier le quotidien ». Cette fameuse nuit où, ne pouvant découcher je repris la route avec deux verres de trop...Et toutes les images qui s'en suivirent...
Un sursaut, une suée, et je me levai dans la nuit, comme chaque nuit. Rien ne pouvait me faire oublier cette sombre période ayant emporté la flamme qui m'animait. Les spectres de mon passé me hantaient dès que la nuit se montrait et que la fatigue se faisait ressentir. J'avais besoin de somnifères pour me rendormir, mais cela ne m'aidait pas vraiment à panser les cicatrices de ce c?ur meurtri par ma propre main.
Tel était le désert glacé de mon coeur. Un décor fait de chaleur factice que j'essayais de m'imposer avant de chaque soir se faire rattraper par l'honnêteté et la spontanéité d'un coeur gelé s'étant abandonné au désespoir et à l'amertume.
Pourtant...Un jour, quelque chose de différent, d'inattendu se produit dans ma vie. Quelque chose que je n'aurais pu prédire même en imaginant tous les rêves que j'avais en tête.
Il était dix heures. Comme à mon habitude, j'entretenais le jardin dans lequel je passais le plus clair de mon temps. Madame Delanoy m'avait aidé quelques jours plus tôt à déraciner les mauvaises herbes en m'indiquant où ces dernières s'étaient installées, ce qui me permettait de planter de nouveau pour une prochaine « récolte ». Comme à mon habitude, j'entendis sonner à ma porte. Mais ma surprise fut grande lorsque j'ouvris l'épais portail séparant mon monde de la réalité car je n'y trouvai pas celle que j'attendais.
Je ressentis une présence différente de celle de ma voisine. Ce n'était non pas l'odeur de sa maison vieillissante, mais un frais parfum féminin qui vint chatouiller mes narines. Un parfum jeune, fruité, assez fort, qui correspondait sûrement à une femme de caractère, mais qui dévoilait un côté tendre dissimulé sous une carapace épineuse. Je n'eus même pas le temps de prononcer le moindre mot qu'une voix grave mais féminine me coupa dans mes pensées.
- Excusez-moi de vous déranger. Dit poliment la femme. Vous êtes bien monsieur Duthoit Vincent ?
- Ou...Oui c'est bien moi. Bégayai-je, encore surpris par l'arrivée de cette femme.
- Ah Dieu merci. Soupira-t-elle en devenant soudain plus familière. Je m'appelle Hélène Delanoy. Je suis venue de Lyon passer le Week-End avec ma mère. Je n'ai pas prévenu car c'était censé être une surprise, pour lui changer les idées vous voyez. Mais c'était sans compter sur ce bon vieux Eric bien sûr ! La voilà partie en week-end romantique avec son ami sans me dire le moindre mot, vous vous rendez compte !
Je pris un instant pour réfléchir. En effet, avec le recul, Madame Delanoy m'avait notifié qu'elle allait s'absenter quelques jours avec son ami. Elle m'avait même apporté plus de courses lorsqu'elle était venue m'aider à enlever les mauvaises herbes. Pauvre femme qui était venue donner le sourire à une mère qui l'avait déjà pensais-je.
- Il est vrai qu'elle est partie il y a quelques jours. Répondis-je compatissant. C'est tout de même un manque de chance considérable quand on y pense. Et puis-je vous demander ce qui vous amène ici ?
- Je n'en sais pas plus que toi à vrai dire. Reprit mon interlocutrice qui devint soudain encore plus familière. Il est évident que je ne peux pas repartir sur Lyon aujourd'hui et il n'y a pas d'hôtel dans ce coin perdu. J'ai téléphoné à ma mère pour savoir ce que j'allais faire et elle m'a dit de sonner chez toi. Tu as les clés de la maison ?
Une fois de plus, je réfléchis. Et je ne me rappelai pas avoir eu les clés de la femme. Je fis un signe négatif de la tête et soudain, je ressentis de l'irritation chez la femme.
- A chaque fois que je viens elle me fait toujours un coup pareil. Soupira la fille de Madame Delanoy. Elle est toujours aussi imprévisible que lorsque j'étais enfant.
- Vous tenez d'elle alors, plaisantai-je, parce qu'elle me dit exactement la même chose à votre sujet.
- Je rêve !? Cria la femme au parfum fruité, toujours postée sur le palier de ma porte. Parce qu'en plus elle te raconte des anecdotes sur moi sans mon autorisation !? Franchement...C'est tellement indiscret...
- Rien d'indiscret voyons. Repris-je d'un ton léger. Entrez donc, je n'ai pas les clés de chez votre mère, mais je peux au moins vous offrir le gîte pour ce week-end. Ce n'est pas fameux chez moi, mais c'est toujours mieux que de rentrer sur le champ à Lyon n'est-ce pas ?
Mon interlocutrice marqua un court temps de pause, avant de reprendre en soupirant encore.
- De toute façon mon billet de train est pour demain...Alors je n'ai pas vraiment le choix. Ils ne me décaleront jamais un voyage à ce niveau. Mais tu es sûr que je ne dérange pas ? Tu n'as pas une femme qui pourrait me foutre dehors en pensant que je suis ta maîtresse au moins ?
- Je vis seul depuis bien longtemps. Repris-je sans réellement exprimer d'émotion. Entrez, veillez à refermer la porte derrière vous.
Puis je retournai dans mon espace en laissant mon invitée prendre ses aises. Il y avait bien longtemps que personne n'était entré ici excepté la mère de cette femme sortie de nulle part, et je ne pouvais même pas dire dans quel état se trouvaient les lieux autour. Je n'avais plus le souvenir visuel de cette maison si ce n'était mes repères personnels que j'avais développés au fil du temps. Je ne pouvais même pas voir le visage de l'être au parfum de fruit pour confirmer son ressentiment face à la découverte de mon univers. Mais au bout de quelques minutes, je compris que je n'allais pas avoir besoin de mes yeux pour communiquer avec elle.
- Mais...C'est magnifique !!! S'exclama bruyamment mon invitée du jour, la voix pleine d'entrain. Ce jardin...C'est toi qui le cultive ? Genre, tout seul ?
- Oui, qui d'autre ? Répondis-je naturellement. Ce jardin est ma principale occupation depuis que j'ai perdu la vue. Votre mère a du vous le dire n'est-ce pas ? Puisque vous n'avez pas été surprise par le fait que je sois aveugle.
- Oui c'est vrai. Reprit-elle. Mais de là à imaginer une chose pareille ! C'est tellement différent de la ville d'où je viens. On a l'impression qu'un artiste est passé par là.
Je ne relevai pas les paroles de la femme. Après tout, je ne pouvais rebondir sur ce qu'elle disait. Ses impressions étaient avant tout tirées de l'effet qu'elle avait en voyant le fruit de mon travail, et je ne pouvais pas voir. Il était inutile d'essayer d'imaginer ce qu'elle ressentait. Ainsi, je m'assis devant mon travail et je me contentai de sentir ce qui se trouvait face à moi, laissant mon interlocutrice s'extasier à sa façon...Mais contre toute mes attentes, je la sentis venir s'installer à côté de moi, avant de reprendre la parole, d'une voix bien plus douce et chaleureuse cette fois.
- Tu as fait quelque chose de magnifique avec cette parcelle de terre. Des roses rouges, roses, jaunes, encerclent ta clôture. Cela fait comme une couverture de verdure qui entoure ton espace. C'est coloré, les nuances de chacune de tes fleurs est mise en valeur par l'épaisse étendue de feuilles et de ronces qui couvrent les limites de ton jardin. Ta pelouse est bien entretenue, aussi verte qu'un arbre en pleine santé qui découvre le printemps. Au milieu de ton espace se trouvent trois couloirs faits de terre faite de nuances de marron, et on peut y voir les débuts d'une aventure printanière dont les héros sont tes récoltes tandis qu'un peu plus sur les côtés on peut voir tes tomates, tes carottes et tes pommes de terre proches de leur récolte. Dans ton espace naturel on y voit des insectes que je n'ai jamais revu en ville. Des papillons, des abeilles, tout ce qui rappelle une enfance de campagne...Cela procure un sentiment de sérénité à l'intérieur...
- C'est gentil...De prendre le soin de me le décrire...Souris-je en sentant de la chaleur à l'intérieur. Personne ne l'avait jamais fait.
- C'est surprenant venant de ma mère ! Rit la femme. Et toi, comment ressens-tu ton endroit ?
- Les senteurs. Repris-je en me laissant aller. Chaque pousse, chaque fruit, chaque légume, chaque fleur...Tout a son propre parfum. C'est son identité. La rose rouge est élégante et fière, elle porte un parfum délicat qui donne envie de s'en rapprocher, c'est une séductrice. La rose rose est plus prude et discrète. Elle ne laissera qu'un parfum léger plus timide qui se fait sentir plus facilement lorsque l'on en tient plusieurs. La rose jaune, elle est joyeuse et pleine d'entrain. Elle est spontanée et se fait remarquer, son son parfum à elle est plus fort et il faut souvent l'écarter du groupe si on veut sentir les autres.
Un temps d'arrêt, puis la femme reprit, d'un ton trahissant de la mélancolie.
- Que c'est poétique. Soupira-t-elle. Tu es un homme plutôt sensible et passionné. C'est rare quelqu'un comme toi en ville. Tu as quel âge dis moi ?
- Trente-cinq ans. Répondis-je paisiblement. Je m'approche tranquillement de la quarantaine.
- Trente-deux pour moi. Me répondit la femme. Tu as encore du temps avant la quarantaine, inutile de te vieillir hahaha !
- Je n'accorde pas vraiment d'importance à l'âge à vrai dire.
Nous restâmes encore un peu la jeune femme et moi, avant de repartir à l'intérieur. Je voulus cuisiner, mais elle m'assura qu'elle allait le faire pour me remercier de mon hospitalité. Ainsi je la laissai faire, faisant totalement confiance à la progéniture de cette voisine qui m'avait beaucoup aidé tout au long de ma vie dans cette maison, en appréciant sa présence. Elle était intarissable lorsqu'elle commençait à parler de sa vie, et cela concordait avec ce que m'avait dit Madame Delanoy. Hélène était une femme agréable, et bonne cuisinière de surcroît. Elle s'emportait assez facilement, cela collait assez avec son parfum. Une femme de caractère qui s'affirmait facilement et prenait ses aises même lorsqu'elle était censée jouer l'invitée. Je ne pouvais la décrire physiquement, mais je la trouvais très agréable. Bien trop agréable même pour quelqu'un qui, comme moi, vivait dans les cauchemars du passé.
Nous passâmes l'après-midi ensemble à nous conter des anecdotes de la vie en Auvergne et à Lyon, à parler de fleurs, de travail, et de toutes ces choses de nos quotidiens respectifs. Hélène était employée de bureau. Elle n'aimait pas son travail mais elle disait qu'il fallait gagner sa croûte. Je comprenais son point de vue à vrai dire. Elle n'avait pas d'enfant, ni de mari qui attendait son retour. Elle n'avait jamais pensé à chercher l'âme s?ur qu'elle disait. Ce fut la première incohérence avec ce que m'avait dit sa mère à son sujet, mais ne voulant pas m'immiscer dans sa vie privée, je ne relevai pas.
Puis la nuit tomba et il fut le moment d'aller nous coucher. La journée avait été bonne, très bonne même. C'était agréable de parler à quelqu'un de nouveau – et quelle personne par dessus le marché ! Je n'avais pas eu besoin de me fabriquer des pensées illusoires pour m'empêcher de penser à autre chose aujourd'hui. Je n'avais pas eu besoin d'imaginer ni des oiseaux, ni des arbres, ni des abeilles, rien du tout. Les images que j'avais en mémoire, celles de mon jardin et des anecdotes racontées par Hélène...Toutes ces images étaient authentiques. Ainsi, lorsque j'eus préparé la couche de la femme au parfum fruité, je pus m'installer dans mon lit sans crainte de ce qui allait me remonter en mémoire cette nuit-là...
Pourtant, j'ouvris les yeux de nouveau quelques heures plus tard, au beau milieu de la nuit. Ces atroces images étaient revenues me hanter une nouvelle fois, comme elles en avaient l'habitude. Et comme toujours, j'en sortais couvert de sueurs, le c?ur à mi-chemin entre l'explosion et l'implosion, et surtout l'âme plongée dans le désespoir.
Comme à mon habitude, je me dirigeai vers la salle de bain afin de me rafraîchir et de prendre un somnifère, histoire de pouvoir dormir de nouveau. Mais cette fois-ci, je ne semblais pas être le seul à avoir cherché le chemin de la tranquillité factice faite de médicaments abrutissants. Elle était présente aussi, et je sentais quelque chose de différent, de plus sombre provenant d'elle. Je bégayai un « C'est vous Hélène ? » qui se perdit dans le silence...Et quelques secondes plus tard, j'eus une réponse. Et cette réponse...Ce fut un bruit qui semblait provenir de pleurs, de sanglots.
- Vous pleurez ? Lançai-je timidement, sans vouloir trop m'avancer dans mes propos. Que se passe-t-il ?
- Ce n'est rien. Me répondit Hélène en essayant de retenir ses larmes. C'est naturel. Dès que je m'endors j'ai ce genre de problèmes. Des images qui me hantent me reviennent en mémoire. Chaque fois.
- Alors vous aussi...Soupirai-je. J'ai aussi ce genre de problèmes. Peu importe à quel point j'essaie d'oublier...C'est impossible. Mon passé refait toujours surface.
- Vous aussi... ? Bégaya la femme qui avait soudain rattrapé sa politesse, semblant choquée par la révélation. Vous aussi vous avez vécu un drame... ?
Je lui demandai où elle se trouvait, avant de m'asseoir à ses côtés sur le rebord de la baignoire. Puis d'un seul coup, dans un élan de folie ou d'impudeur flagrante, je me mis à lui dévoiler tous les tourments qui me hantaient chaque nuit. Du surmenage, jusqu'à la soirée, à l'accident, à mes troubles qui ont suivi, à la mort de ma fille, la disparition de ma femme, et ces tourments qui rongeaient mon c?ur...Je lui dis tout. Et pour seule réponse, elle me dit tout. Elle me dit qu'elle était partie en ville à l'aventure avec un jeune homme, qu'elle a quitté ses études pour devenir secrétaire, qu'elle enchaînait les contrats sans lendemain et que lui est devenu violent, qu'il la menaçait, qu'il la harcelait, et qu'un jour alors qu'elle avait rompu et qu'il la suivait, il fut percuté par une voiture sous ses yeux. Chaque nuit elle semblait voir le fantôme de cet homme qui lui reprochait d'être mort par sa faute.
Elle s'écroula dans mes bras, ne pouvant plus retenir ses larmes. Je ne pouvais que l'étreindre en étant mal à l'aise, sans savoir ce que je devais lui répondre. C'était la seule réaction à laquelle je pensais à cet instant précis. Une fois qu'elle fut calmée, je lui proposai d'aller se recoucher. Elle refusa de retourner dans son lit, me demandant un de mes tranquillisants, mais je n'avais pas vraiment confiance en le fait de donner un médicament non prescrit à une inconnue donc je refusai. A la place je lui proposai de venir s'installer dans mes draps afin que l'on ne soit pas seuls chacun de notre côté, et contre toute attente, elle accepta.
Nous nous installâmes l'un contre l'autre, dos à dos. Nos c?urs glacés fondaient sans résister sous la pression de la chaleur de nos corps, nous laissant tous deux trouver le sommeil paisiblement, rassurés par la poignée de main ardente serrée sous ces couvertures de laine...
Lorsque le soleil réveilla ma partenaire de malheur, il était dix heures trente. Elle vint s'installer tandis que j'avais préparé le petit-déjeuner sans difficulté dans ma cuisine aménagée. Avançant un « bonjour » timide, elle s'installa à table et entama son repas. Puis elle prit la parole, calme.
- Merci pour cette nuit. Murmura-t-elle. Je pensais qu'en dormant chez quelqu'un cela n'allait pas revenir...Mais cela ne me lâche pas...
- Je n'ai pas pris de somnifères cette nuit. Repris-je, calme. C'est moi qui te remercie. Je n'ai jamais pu parler de ce dont je t'ai parlé cette nuit. Cela m'a fait du bien.
- Tiens, tu me tutoies maintenant ? Répondit-elle moqueuse. Cela m'a fait du bien d'en parler aussi.
La journée reprit, et elle fut encore plus agréable qu'elle ne l'était la veille. Nous reparlâmes de nos troubles à coeur ouvert, face à une oreille aussi attentive de mon côté que du sien. Nous échangeâmes ainsi nos points de vue, nos conseils, et je pense qu'à la fin de cette journée, lorsqu'il fut temps pour elle de repartir chez elle, nos coeurs étaient tout aussi légers que les feuilles d'arbres se laissant gracieusement flotter au grès du vent.
- Bon eh bien...Merci pour tout...Dit-elle sur le pied de la porte, sans conviction. C'est sympa de m'avoir accueillie, je ne l'oublierai pas.
- Ce n'est rien au contraire. Assurai-je en souriant. Ce fut un plaisir. Si tu reviens dans le coin, n'hésite pas à venir me voir. Je te montrerai le jardin de nouveau. Ah, tant que j'y pense, j'ai quelque chose pour toi.
Je fermai à moitié la porte, avant de me saisir de ce que j'avais préparé pour Hélène quelques minutes auparavant. J'avais enlevé les épines de cette rose, une des roses jaunes qui était dans mon jardin, et je l'avais soigneusement disposées dans un verre long faisant office de vase. Je lui tendis. Je sentis qu'elle me le prit des mains. Satisfait, j'enchaînai.
- La rose qui te convient le mieux est la spontanée, celle qui surplombe les autres de par sa présence et sa senteur, elle est pour toi. Prends-là donc, et lorsqu'elle aura fané, c'est qu'il est temps de revenir me voir.
Un silence s'installa de nouveau, me laissant ruminer un peu sur mes paroles. Avais dis-je quelque chose de déplacé qui avait irrité la femme ? Je n'eus pas vraiment le temps de le réfléchir puisque une minute suffit pour que j'obtienne une réponse. Je sentis les lèvres de Hélène se poser délicatement sur les miennes et ouvrir la barrière créée par ma lippe rigide pour partager un baiser passionné qui me fit frissonner de haut en bas...
Lâchant la pression de sa bouche contre la mienne, elle me répondit enfin, me laissant déceler dans sa voix plus d'empathie et de tendresse que mon monde factice n'aurait jamais pu m'en procurer.
- Je reviendrai te voir, Vincent. Je reviendrai te voir bien avant que cette rose ne fane.
Puis elle repartit vers son monde, et je retournai au mien, attendant impatiemment que ces deux univers entrent de nouveau en collision et qu'ensemble nous puissions en créer un nouveau où les tourments et l'amertume ne sont qu'histoire ancienne.
BISO0421
L’ETRANGERE
Je n’ai gardé de mes amours d’école primaire que des souvenirs assez flous. Je suis passé, autant qu’il m’en souvienne, d’amourettes insignifiantes en aventures sans lendemain, le tout rythmé par la règle de trois, la table de multiplication, l’accord du participe passé avec être et avoir et en toute fin d’année scolaire par une très brève incursion dans l’emploi de l’imparfait du subjonctif. A bien y réfléchir, cette curiosité linguistique d’un autre siècle pouvait, à la rigueur, servir à larguer avec élégance une grande de CM2 en lui disant : « Encore aurait-il fallu, Madame, que je vous aimasse et que vous m’aimassiez un peu plus.» Mais cette utilisation contre-nature et hilarante ne fut jamais que l’apanage très temporaire de quelques beaux esprits de la classe, ce qui n’était pas mon cas.
En ce qui me concerne, ma vie sentimentale n’a vraiment pris son essor qu’en fin de quatrième, en ce premier jour de juin, où elle est entrée dans la classe et du même coup dans mon cœur. Elle débarquait chez nous en raison, disait-elle, des « évènements ». Nous savions tous de que là-bas, de l’autre côté de
Elle vint s’asseoir à la seule place restante, à côté de moi.
Grâce à des documentaires cinématographiques de l’époque, je n’étais pas insensible, malgré mon âge, à l’exotisme des Vahinés et à la beauté des Asiatiques. Sans aller jusqu’à leur ressembler, ma nouvelle voisine dégageait un incontestable parfum d’ailleurs. Plus bronzée que toutes les autres filles de la classe, plus grande aussi, très brune avec des cheveux courts, des yeux très noirs, silencieuse, elle m’apparut d’entrée comme portant en elle tout le mystère de l’Afrique. Je suis aussitôt tombé sous le charme. Je lui ai prêté tout ce qu’elle m’a demandé ce jour-là. Elle n’avait aucun matériel. A croire que de l’autre côté de la mer, ils ne connaissaient ni gomme, ni crayon, ou qu’ils étaient trop pauvres pour se les payer. J’ai décidé de l’aider à faire sa place parmi nous.
Un jour, pour me remercier sans doute de mon empressement à la guider dans sa nouvelle vie, elle m’a demandé si je voulais un « chouing. ». N’en ayant pas trouvé un « neuf » dans sa poche, elle prit délibérément celui qu’elle était en train de mâcher, l’étira, le coupa en deux parties égales et me tendit avec un sourire la moitié qui me revenait. Ce fut son premier cadeau. Je l’ai gardé trois jours. Religieusement. Elle et moi avions quelque chose en commun.
Je l’ai trouvée un matin, en pleurs, assise sur un banc.
-Fernand m’a traitée de sale bougnoule, me confia-t-elle, parce que je n’ai pas voulu lui passer mes exercices de math.
Je ne sais si c’est le mot « sale » ou le terme de « bougnoule », ou l’association des deux qui m’a le plus choqué, mais j’ai senti monter en moi une colère sourde. J’avais lu quelque part qu’un lion blessé est un animal très dangereux. J’ai senti d’un coup que le lion, qui sommeillait jusqu’alors paisiblement en moi, allait devoir sortir ses griffes et se monter particulièrement redoutable et efficace, si je voulais voir cesser les larmes de Leïla.
Sans plus attendre, j’ai foncé vers le gros Fernand. Je savais que le face-à-face qui allait avoir lieu, comme à la fin dans tout bon western, serait capital pour la suite. J’y jouais ma crédibilité et il en allait de mon honneur. J’ai donc décidé de frapper le premier. C’est toujours mieux de ne pas attendre, ça augmente les chances de succès !
-C’est ta sale bougnoule qui t’ env …
Le gros Fernand n’eut pas le temps d’en dire plus. Mon poing gauche était parti avec une telle violence que, sans savoir comment, il s’était retrouvé le cul par terre, à la recherche d’un éventuel mouchoir pour s’éponger le nez au plus vite.
-Ça, c’est de la part de la « sale bougnoule » ai-je dit. Et si tu recommences, gros sac, je t’écrase comme une punaise. Dans la vie il faut être tolérant même avec ceux qui sont pas comme toi. Et tu n’as surtout pas à l’insulter parce qu’elle n’est pas d’ici. Compris ? Elle est différente, c’est tout. Tu te mets bien ça dans le crâne. Je te le redirai pas, ai-je ajouté en lui serrant la gorge à deux mains.
Cette vibrante et amicale mise en garde étant faite, il a eu droit, comme de juste, au crachat plein de mépris du vengeur solitaire. Puis, magnanime, je l’ai abandonné à son sort. On n’achève pas quelqu’un à terre qui, en plus, baigne dans son sang ! Tous les vrais justiciers vous le diront !
Ma mission étant accomplie, je m’en revins auprès de l’offensée.
-Merci, me dit-elle et sans rien ajouter elle me donna un baiser sur la joue gauche.
S’il n’avait tenu qu’à moi je serais bien retourné illico auprès du gros Fernand pour lui arranger encore un peu les naseaux, juste pour avoir droit à un second baiser sur l’autre joue .
-Ça suffit, je crois qu’il a compris, ajouta-telle.
De ce jour, j’allais devenir le défenseur en titre de Madame. Personne ne l’a plus jamais insultée ou fait des remarques sur ses origines lointaines. Je ne l’aurais pas supporté. Le preux Chevalier montait la garde et faisait à chaque fois un pas de plus vers la citadelle de son cœur.
Mais hélas, les grandes vacances sont arrivées !
J’ai attendu la rentrée des classes avec une impatience croissante et non dissimulée.
-Que veux-tu, dis-je à ma mère qui s’en étonnait, ton fils a un impétueux besoin d’apprendre ! ( Il est à noter qu’en ce temps, je fréquentais assidument Victor Hugo et les grands romantiques et que mon expression orale y gagnait de plus en plus en élégance ! )
Septembre est enfin arrivé.
J’ai retrouvé Leïla et j’ai compris qu’elle aussi m’attendait.
Le soir, en la raccompagnant chez elle, je lui ai pris la main. On n’a rien dit. Dans les plus beaux films d’amour les amants ne parlent pas toujours. On a fait comme eux. Et avant de la quitter, j’ai tout de même osé dire ce que je ruminais depuis des jours. Dans un anglais très approximatif je lui ai murmuré : « Aïe love ïou ».
Voilà c’était dit, il n’y avait plus qu’à espérer de sa part une réponse allant dans le même sens. Elle m’a souri et a répondu « me too » avec un accent nettement plus élaboré que le mien. Comme je ne semblais pas comprendre ce « mi-tou », elle a traduit. Cela voulait dire : « moi aussi !»
L’anglais n’est vraiment pas fait pour les amoureux débutants !
Je suis rentré chez moi le cœur débordant de joie. Peu m’importait d’avoir écopé pour l’année de cette vache de père Rousseau en Maths et cet imbécile de Gaston en Français. J’aimais et j’étais aimé. Leïla, mon étrangère, venait d’entrer de plein pied dans ma vie.
Grâce à elle et pour être à son niveau, j’ai fait d’énormes progrès en anglais. Moi qui détestais la langue du « chat qui expire » et encore plus celle qui devait nous la faire aimer, Mademoiselle Brun, je suis passé du quatre de moyenne, où je stagnais sans encombre, à un huit des plus prometteurs. En fin d’année j’ai même frôlé la moyenne, je l’avoue grâce à Leïla qui m’avait laissé une vue panoramique sur sa copie. Mademoiselle Brun a dû s’imaginer qu’elle avait de réels dons de pédagogue ! La dinde !
Un seul mot anglais me sembla dès lors digne d’intérêt, c’était « LOVE ». Je ne sais plus dans quel film le héros appelle sa bien-aimée « Love-love ». J’ai trouvé que c’était charmant. Leïla est donc devenue « Love-Love » le plus naturellement du monde, alors que de son côté elle ne m’appela plus jamais que « Mitou » en souvenir de ce jour, où, par timidité, j’avais bêtement choisi l’anglais pour lui dire : « Je t’aime ».
Love-Love est arrivée un matin avec un superbe appareil dentaire fait de plaquettes et de fil de fer, en un mot avec tout un harnachement qui ne facilitait pas le baiser. J’ai donc entrepris ma mère en lui démontrant que j’avais moi aussi un besoin urgent de prothèse dentaire. L’orthodontiste qui avait déjà traité Leïla et qui ne demandait qu’à travailler, confirma mon diagnostique. Ma mâchoire avait besoin d’être légèrement modifiée, afin que toutes les dents présentes et à venir y « trouvassent » une place digne d’elles.
Cette acquisition me rapprocha encore un peu plus de ma bien-aimée. Nous embrasser devint un exercice certes un peu périlleux au début. Il fallait à chaque fois éviter tout accrochage intempestif de nos appareils dentaires. Mais avec un peu d’entraînement et de technicité nous y arrivâmes très bien, pour notre plus grand bonheur.
Avec l’amour je me révélai poète. Enfin presque ! Car faire des alexandrins était autrement plus ardu que de mettre mon poing sur le nez du gros Fernand. J’étais souvent en manque de rimes originales et intelligentes. Je restais sec. Heureusement Hugo, Lamartine, Musset, Verlaine et tous les autres m’ont beaucoup aidé. Love-love a pu ainsi trouver chaque matin un petit poème fait maison et signé de ma main. Bien entendu, je ne lui ai jamais avoué où et surtout chez qui je puisais une aussi belle et aussi constante inspiration. A quoi bon ? Elle était heureuse. D’une part elle avait un poète génial rien que pour elle et d’autre part les autres filles de la classe ne pouvaient pas en dire autant. Alors ! J’ai donc poursuivi mon œuvre en toute quiétude !
J’aurais dû garder quelques-unes de ces merveilleuses productions qui fleuraient bon le plagiat pour cause de sentiments amoureux. Dans leur genre c’étaient d’attendrissantes petites perles faites de spontanéité et de retenue. Les choses étaient dites en demi-teinte mais toujours avec la même passion. Serais-je encore capable d’écrire pareilles choses aujourd’hui ? Même avec l’appui de tous les poètes du monde je n’en suis pas certain. Je n’ai plus l’âge d’oser ! Dommage !
Plus les jours passaient, plus je savais que nos destins seraient inséparables. S’il le fallait, j’étais prêt pour elle à affronter les plus grands dangers. Je me voyais déjà fendre la jungle à sa recherche. J’étripais au passage un ou deux lions affamés, découpais en tranches un boa trop entreprenant, assommais sans m’arrêter un tigre légèrement belliqueux, avant d’arriver enfin au village, où un chef indigène non civilisé la retenait prisonnière, ficelée à un poteau de torture, façon brochette avant cuisson. Après l’avoir chargée sur mon épaule et tel un squale impétueux, je retraversais au plus vite les marécages sous l’œil des crocodiles qui, m’apercevant, se gardaient bien d’intervenir…
A l’évocation de tous mes « exploits passés » je ne peux m’empêcher de sourire. Je ne suis pas Indiana Jones et ne l’ai jamais été. Je regarde aujourd’hui celle qui dort paisiblement à mes côtés. Depuis que je la connais, elle a pris un bon nombre de kilos. Elle a les cheveux presque blancs et va sur ses 70 ans. Elle ronfle aussi avec application. Les choses sont en ordre. Son « Mitou » est toujours là, près d’elle et moi, j’aime toujours autant ma « Love-Love », mon premier, mon bel amour qui, un jour, est venu d’ailleurs !

CARE5475
LES ENFANTS DE PREVERT
La fenêtre de ma chambre donnait au coin d’une cour rectangulaire. Tout de suite à gauche, dans le mur qui faisait l’angle s’ouvrait une fenêtre que je n’avais jamais vue ouverte. Des rideaux empêchaient de voir à l’intérieur mais je supposais que la chambre, plus ou moins identique à la mienne, était inoccupée car je n’entendais aucun bruit de ce côté-là, ce qui n’était pas le cas de l’autre côté où les fêtes se succédaient en soirée.
Je m’étais installé ici au début de l’année universitaire et je préparais une thèse sur Jacques Prévert et le cinéma et plus précisément le rôle de scénariste et de dialoguiste de Prévert dans les films de Marcel Carné. Petit à petit j’en étais venu à resserrer le sujet autour des dialogues d’amour écrits par Prévert dans « Le jour se lève », « Le quai des brumes », l’admirable « Les visiteurs du soir » et celui que j’aimais par-dessus tout « Les enfants du Paradis ».
Et c’est un soir où je visionnais une fois de plus « Les enfants du Paradis » que j’entendis pour la première fois, à travers la mince paroi qui me séparait de la chambre voisine, jusqu’ici inhabitée, des signes de vie. Je baissais le son de mon ordinateur et je fus littéralement sidéré d’entendre, en sourdine mais très distinctement « Les feuilles mortes » chantée par Yves Montand, la chanson la plus connue de Prévert tirée des « Portes de la nuit ». Je mis le film sur pause et j’écoutai, couché sur mon lit, cette chanson pleine de nostalgie qui entrait en résonnance avec mes préoccupations du moment. Si j’avais été un autre, je me serai précipité dans le couloir, j’aurai tambouriné à la porte pour savoir qui était celui ou celle qui trouvait plaisir à la poésie simple de Prévert que certains esprits forts dépréciaient si facilement. Mais j’étais moi, discret et timide jusqu’à l’effacement en dehors de mon domaine d’étude et il m’était difficile de faire le premier pas. J’écoutais le doux murmure des chansons et le silence revenu, je poursuivis la lecture du film en mettant mes écouteurs. De ma chaise, je constatai que la fenêtre de gauche était éclairée mais les rideaux, rose indien et orange, toujours tirés.
De temps en temps, je descendais prendre mon petit déjeuner « chez Robert », le bistrot du coin. C’était un peu mon quartier général et le patron qui s’appelait Jacques, comme Prévert, était la personne qui me connaissait le mieux dans le quartier. Je lui avais demandé pourquoi son café s’appelait « chez Robert » mais il n’en savait rien. Il l’avait acheté comme ça il y avait plus de dix ans et ça avait été plus économique de tout laisser comme avant. La clientèle était assez jeune grâce à la présence d’un lycée et d’une école de publicité à côté. C’était animé, bruyant, des groupes entraient en discutant et je regardais parfois les filles dont certaines me plaisaient bien. Mais jamais je n’eus l’occasion ou le temps, compte tenu de ma timidité et de la frénésie des entrées et des sorties, d’engager la conversation avec l’une d’entre elles. J’en avais repéré une, jolie, cheveux courts, l’air réfléchi mais espiègle. Elle était souvent seule, à une table, à lire ou à écrire dans un carnet.
« T’as de beaux yeux, tu sais. » « Embrassez-moi ». Ce petit dialogue archi-connu du « Quai des Brumes » entre Jean Gabin et Michèle Morgan a du en faire rêver plus d’un et plus d’une. On pourrait penser que tout est dit et que le secret de l’amour nous est révélé. Prévert nous en donnerait la clef et exprimerait sa vision des relations amoureuses. Mais « Le jour se lève » apporte une nuance de taille. Arletty répond à ce même Gabin : « A quoi pensez-vous quand vous m’embrassez ? » Je levai les mains du clavier de mon ordinateur et m’étirai en me redressant, les bras en l’air. La rédaction avançait doucement et encore, il ne s’agissait que du premier jet, histoire de mettre tout ça en place. Relevant la tête, je vis que la fenêtre toujours fermée était grande ouverte et laissait voir un petit coin cuisine un peu en désordre et un début de table ou de bureau encombré. Je me levai et m’accoudai à la barre d’appui de ma fenêtre et regardai les toits gris qui luisaient au soleil. Si quelqu’un se mettait à la fenêtre voisine, un sourire suffirait sans doute à engager la conversation et je ne serai pas contre avoir un voisin sympa. Je restai ainsi à rêvasser un bon quart d’heure mais manifestement il n’y avait personne à côté, en tout cas personne n’est venu.
Le temps redevenait doux et une fin d’après-midi, alors que je sortais de la bibliothèque de la fac, je rentrais doucement à pied en flânant comme j’aimais à le faire, je remarquai, alors que je m’approchais de mon quartier, cette jeune fille que j’avais repérée « chez Robert ». Elle venait sur le trottoir d’en face, longeant le square et les yeux au sol, le regard vague, comme perdue dans ses pensées et cependant souriante. Comme j’aurais voulu être la cause de ce sourire. Elle ne me vit pas et continua de son pas nonchalant vers la Seine. Je rebroussais chemin et la suivis un instant, préparant une réplique au cas où, se retournant, elle m’apercevrait et peut-être me reconnaîtrait à supposer qu’elle m’ait remarqué. J’avais cru, ces derniers temps, surprendre des regards que je supposais aussi subreptices que les miens mais dans ce café où l’attention était sollicitée de toutes parts, il était difficile de déduire quoi que ce soit de ces têtes virevoltantes et de ces yeux qui balayaient la salle en tous sens. Au bout d’un moment, je lâchais ma filature et retournais vers chez moi en fredonnant doucement : « Les enfants qui s’aiment s’embrassent debout contre les portes de la nuit… »
Voulant avancer le plus possible dans mon mémoire avant les vacances de Pâques, je refusai quelques invitations de copains qui trouvaient que je me renfermais, que je me recroquevillais et qui voulaient me sortir de mon trou. Mais, au moins pour le moment, je préférais rester travailler et, de plus, j’étais intriqué par la présence sporadique dans la chambre d’à côté. Avant de me remettre à écrire, je regardais mais surtout j’écoutais au casque les chansons des « Visiteurs du soir ». Il faut voir l’éclosion de l’amour dans les yeux de Marie Déa pendant qu’Alain Cuny chante « Démons et merveilles » et surtout « Le tendre et dangereux visage de l’amour ». Dans cette dernière chanson, elle semble sur le point de défaillir, ses yeux sont mi-clos et elle fixe, ensorcelée, le troubadour. Voilà une autre piste pour l’amour créé par Prévert, la parole, le regard, la douceur, l’envoûtement, car s’il n’a jamais été contesté qu’il en a écrit les paroles, le compositeur de la musique est Maurice Thiriet alors que l’on a longtemps considéré, à tort, qu’il s’agissait de Joseph Kosma. Je mis sur pause et retirai mes écouteurs. De la chambre d’à côté j’entendis « C’était ta préférée je crois qu’elle est de Prévert et Kosma », Gainsbourg chantant « La chanson de Prévert » en référence aux « Feuilles mortes ». J’en étais presque à me demander si je n’allais pas voir Jules Berry entrer d’un instant à l’autre, sentant le souffre, se frottant les mains comme un maquignon venant de réaliser une bonne affaire et de sa voix nasillarde me lancer une phrase du genre : « Alors, hein, on ne s’y attendait pas, hein ? » Je me dirigeais vers la fenêtre mais les rideaux étaient tirés. On n’en était plus aux coïncidences, ça frisait le complot. Gainsbourg changea de chanson et tout redevint normal. Il faudrait quand même que je tire cette affaire au clair. Je crois qu’il y avait de quoi engager une conversation qui se promettait d’être savoureuse si l’autre aimait discuter, mais ses choix musicaux me laissaient penser qu’il devait aimer les mots.
La Cinémathèque ayant prévu un cycle Marcel Carné, je demandai à Jacques de pouvoir afficher dans son café le programme. Il y consentit volontiers et connaissant mes travaux, il en profita pour me demander où en était la rédaction de mon mémoire. Nous en parlâmes un moment. C’était le milieu de la matinée et il n’y avait pas grand monde dans la salle. La jolie fille aux cheveux courts lisait un livre devant un café qui avait été renouvelé. Je lui jetais un coup d’œil mais elle était absorbée par sa lecture. Jacques me demanda si j’allais aller voir ces films dont je lui avais tant parlé et que je connaissais par cœur. J’acquiesçai en indiquant qu’une conférence suivrait les films et qu’il sera intéressant pour moi d’y glaner quelques anecdotes ou impressions nouvelles. D’ailleurs ce soir, on passait « Les enfants du Paradis » et j’étais curieux de savoir comment ce film allait être ressenti aujourd’hui. Compte tenu de la longueur de la séance, elle commencerait à 17 heures pour permettre d’avoir un petit débat ensuite. Je rentrai dans ma chambre pour travailler et je partis vers la Cinémathèque à temps pour ne pas me presser et avoir une bonne place en cas d’affluence. Ce n’était pas le cas et la salle était à moitié vide. Juste au moment où la lumière allait s’éteindre, quelqu’un me fit lever pour s’asseoir juste à côté. C’était la fille de « chez Robert ».
Je mis un certain temps à pouvoir m’intéresser aux images. Sa présence à côté de moi ne pouvait pas être un hasard mais que signifiait-elle ? Pour ma tranquillité d’esprit il aurait fallu avoir une explication tout de suite mais c’était impossible. Je l’avais regardée deux ou trois fois du coin de l’œil. Elle fixait l’écran, droit devant elle, absorbée par le film. Je ne repris pied qu’avec l’arrivée de Baptiste, immobile et observant tout et je fus emporté dans cette histoire où plus rien ne me surprenait et où je me sentais plus à l’aise que dans ma vie. Près de quatre heures plus tard le film fini, les lumières rallumées, je pus la regarder mais avant que je puisse ouvrir la bouche, elle sourit et me dit : « Bonsoir, on reste pour le débat ? » Je fis oui de la tête et écoutai avec impatience questions et réponses, toutes assez banales qui ne m’apportèrent rien. La nouveauté n’était pas là ce soir. Il me tardait de pouvoir en discuter. La conversation eut lieu dans un café où elle m’expliqua tout de suite qu’elle m’avait entendu faire la publicité de ce film ce matin et que cela lui avait donné envie de le revoir. Tant qu’à faire, elle avait trouvé amusant de me faire la surprise et de venir s’asseoir à côté de moi au dernier moment. Je murmurai : « Ah, la surprise, oui, oui… ». Elle me lança sur le film, Carné, Prévert, Arletty. Evidemment je lui fis part de ma passion du moment, de mes travaux, mes recherches, mon plaisir à plonger dans ces images, ces dialogues, cette époque. Elle m’apprit qu’elle aimait aussi beaucoup Prévert, pour ses textes, ses chansons, mais aussi sa vie, sa manière d’être, les images qu’on avait de lui, sa clope, son verre de vin, son chapeau ridicule, sa simplicité, son côté populaire et libertaire. Nous ne nous quittions pas des yeux. J’avais l’impression que nous faisions beaucoup d’efforts par moments pour ne pas nous jeter l’un sur l’autre mais à d’autres moments nous parlions, calmes, détachés, confiants comme si nous nous connaissions depuis toujours. Lorsque nous nous levâmes pour partir, j’étais comme étourdi. Elle dut le voir. Elle me dit, la tête un peu penchée, ne doutant pas de la réponse : « Je prends un taxi, je peux vous rapprocher ? » Nous avions, en effet, malgré notre âge et la propension naturelle à se tutoyer et sans doute sous l’influence du film, continué à nous vouvoyer. Je lui fis signe que non et j’ajoutai dans un triste sourire : « J’ai besoin de marcher. » Elle n’insista pas mais quand elle fut montée dans le taxi, je lui demandai, ce que j’avais oublié de faire avant, comment elle s’appelait. « Garance », me répondit-elle dans un grand sourire, claqua la portière et le taxi démarra. Debout sur le bord du trottoir, je me demandais si j’allais la revoir et où, avant de me rappeler qu’elle était souvent « chez Robert ».
Bien qu’étant rentré tard, j’avais eu du mal à m’endormir. J’avais comme un surplus d’émotions difficiles à canaliser, à dompter. Je me repassais le film, non pas celui que j’avais vu sur l’écran mais celui d’après, quand j’étais avec Garance. Non, c’était une blague ou quoi. Elle s’appelait vraiment Garance ? C’était trop fort ! Les sentiments qui m’avaient agité durant la soirée avaient enflé et s’étaient prolongés tard dans la nuit. Au matin il m’en restait une impression d’irréalité mais aussi de bonheur qui donne envie de siffloter alors que le soleil inonde la mansarde et qu’il n’est rien prévu d’autre que d’aller vérifier bientôt au café du coin si tout ceci n’était pas un rêve. J’ouvris la fenêtre et me laissai baigner par le soleil, la tête levée et les paupières baissées. Les relevant, je vis Garance accoudée à la fenêtre que je n’avais, jusqu’ici, que connue vide et inversant, sans m’en rendre compte, les rôles de Pierre Brasseur et d’Arletty, je m’entendis dire : « Vous habitez ici ? Ça alors, pour une rencontre, c’est une rencontre. » Mais le bonheur fut complet quand elle me répondit d’une voix gouailleuse : « Paris est tout petit pour ceux qui s’aiment comme nous d’un aussi grand amour. » Et comme Frederick Lemaître, je quittai la fenêtre pour aller la rejoindre. La porte était ouverte. Nous n’avions plus besoin de dialogue ni de dialoguiste. Elle se jeta à mon cou et m’embrassa. Après celui du Ciel et celui des théâtres, un nouveau paradis venait d’apparaître au sixième étage de cet immeuble.
CORP6996
Litanie d’un refus de suivre la marche du temps
7h00
Lorsqu’Odona se réveille, moite et en colère, il lui faut un certain moment pour comprendre la situation. Le réveil n’a pas sonné. Commence alors pour elle une journée où le temps est compté et chaque geste limité. Son mari, médecin, est parti précipitamment à l’hôpital en pleine nuit pour une urgence suite à un grave accident de la route. Elle lève ses deux enfants, une fille et un garçon, prépare le petit déjeuner, se lave pendant qu’ils mangent, s’habille, leur choisi des vêtements de saison, vide la litière, essuie la tâche de lait renversé sur le carrelage blanc, vérifie le contenu des cartables, leur enfile bottes et manteaux, sort avec ses deux amours et ferme la porte, avance vers la voiture, retourne dans la maison décrocher les clefs oubliées du véhicule, referme la porte, les installe, s’installe hâtivement, boucle sa ceinture et démarre.
Lorsque Jésus se réveille et voit son fils endormi à ses côtés, il lui faut un certain moment pour comprendre la situation. Il est séparé. Commence alors pour lui une journée où le temps est figé et les corps cristallisés. Sa femme est partie. Pour toujours. Lui laissant une garde partagée une semaine sur deux. Une séparation dans le partage, une ironie. Jésus verse les flocons de céréales dans deux bols blancs, puis repose la boite marquée d’un logo survolté au design agressif sur la table. Il les remplit de lait tiède, s’efforçant de ne pas penser à l’alcool dès le matin. Il laisse encore le petit dormir. Il ne le réveillera qu’au dernier moment. Après tout, rien ne presse.
Après un lent moment de préparation matinale, ils sortent de la maison et se dirigent vers l’abribus. Le garçon au visage encore endormi, et au lacet défait, le suit sans rien dire.
Une belle histoire durant laquelle l’ex-mari trompé inspire le temps, et la fidèle épouse l’expire.
8h32
Lorsqu’Odona dépose un baiser sur le front de ses enfants, les libérant à la fois d’elle-même et de sa cadence, elle prend un instant pour les voir courir et s’éloigner en hurlant vers la cour de récréation. Elle redoute toujours ce moment durant lequel elle entraperçoit une brèche dans le mur du futur derrière lequel elle devra s’effacer et avancer, seule, vers ce qui lui restera.
Dans son élan, elle tourne la tête et croise le visage au regard fermé de cet homme à la discrétion quotidienne. Elle reprend le volant, roule une demi-heure, se gare, entre dans l’agence d’assurance pour laquelle elle travaille depuis treize ans, s’installe à son bureau, réajuste la photo encadrée sur laquelle chaque membre de sa famille affiche le sourire nécessaire, puis consulte son agenda de rendez-vous pour les huit prochaines heures. Il est plein.
Lorsque Jésus dépose un baiser sur le front de son fils, le libérant à la fois de lui-même et de son poids, il détourne rapidement le regard, puis ferme les yeux. Tout à coup, les effluves d’un parfum suave et légèrement sucré le font sortir de sa rêverie, puis la vision succincte d’une silhouette élancée, quoiqu’exagérément féminine, stimule le reste de ses sens. Il entend alors les voitures alentour démarrer, la sonnerie de l’école retentir, il ravale une salive âpre au goût de nicotine, passe la main dans ses cheveux clairsemés, et chemine lentement en direction de l’abribus. Trente minutes plus tard, il arrive sur le chantier, entre dans la cabine en préfabriquée, avance vers son casier métallique, l’ouvre, retire son bleu de travail, le revêt, attache ses chaussures de sécurité, enfile son casque, et s’en va gagner sa solde.
Une belle histoire durant laquelle le père de famille part à droite, et la mère de famille à gauche.
12h09
Lorsqu’Odona prend sa pause déjeuner dans la petite brasserie qui donne sur la place principale, elle ne remarque pas tout de suite l’homme de l’autre côté de la vitre, légèrement caché par une jardinière posée sur le rebord de la fenêtre. Elle est trop occupée à s’efforcer d’écouter ses collègues de travail se plaindre de leurs vies si remplies, de futilité pense-t-elle, mais qui semblent cependant les satisfaire. Après avoir bu l’apéritif, un fugitif instant d’inattention s’empare d’elle et la fait dévier vers le dehors où elle croit reconnaitre un profil « déjà-vu » flotter au-dessus des géraniums. L’association fantasmée de l’air venteux, de l’odeur fleurie, des couleurs printanières et de cet homme la transporte littéralement au-delà des bavardages environnants. Seule l’intervention du serveur lui demandant si son entrée s’« est bien passée » la réintègre brusquement dans cette réalité aux contours nets et ciselés.
Lorsque Jésus prend sa pause déjeuner, assis sur un banc, il sait qu’il n’oserait jamais entrer seul dans la jolie brasserie qui se dessine dans son dos par peur d’attirer l’attention, et d’en devenir un sujet de conversation. Il mange sans engouement un sandwich au thon noyé de mayonnaise, faisant capricieusement couler ses bouchées avec de rapides gorgées d’une boisson gazeuse au sucre indigeste. Ses pensées vagabondent sans point de chute établi, au gré de cette fourmillante humanité qui s’affaire et se redessine à chaque instant sur la place centrale, et dont chacun s’obstine à préserver secrètement sa propre nudité par peur d’entacher le tableau si parfait de leurs vies parodiées.
Une belle histoire durant laquelle l’ouvrier rêve d’intérieur, et la conseillère en assurance d’extérieur.
18h30
Lorsqu’Odona a fini ses heures de travail, elle s’accorde une demi-heure au pub irlandais où elle retrouve sa meilleure amie à la table 18, dans l’angle à droite de l’entrée. Un fois confortablement installées dans les lourds et profonds canapés en cuir marron dont l’unique utilité se résume à ces deux qualités, et après avoir commandé deux bières blanches à un serveur respectant en tout point les canons de beauté propre à cette époque, elles entament, décontractées, le début d’une conversation dont les mots exhibés de l’une rempliront les espaces déshabillés de l’autre. Tout en poursuivant et sans s’en rendre compte, elle le voit.
Lorsque Jésus a fini ses heures de travail, il s’accorde une demi-heure au bar en chêne massif, décoré de fanions vert/orange et orné de têtes de hiboux sculptés, où, assis sur un tabouret fatigué et marqué de ses années à avoir porté tant de fessiers indélicats, il retrouve ses co-équipiers avec lesquels il évolue le dimanche matin au sein du club de foot local qui semble exister depuis toujours. Pour eux, ni discussion ni aparté, juste chamailleries et autres braillements. Commence alors pour lui le périlleux exercice d’évoluer à la fois sur le terrain dur et sec de l’enthousiasme et sur celui, glissant, des vestiaires humides de l’oubli. Tout en buvant et sans s’en rendre compte, il la sent.
Une belle histoire durant laquelle le bon copain se transforme en sujet, et l’amie confidente en spécialiste.
19h11
Lorsqu’Odona se rend à l’hôpital qui jouxte le cimetière, elle n’a pas à toucher aux grandes portes vitrées de l’entrée munies d’un détecteur de mouvement commandant l’ouverture automatique. Elle traverse l’accueil, se poste devant l’ascenseur, attend puis, impatiente, décide d’emprunter les escaliers qui montent jusqu’au troisième étage. La chambre 818 ne correspond pas à la huit cent dix-huitième chambre du bâtiment, mais à celle dans laquelle repose sa mère. Juste un numéro, exclusif et attribué. A peine a-t-elle entrouvert la porte qu’elle entend déjà l’assistance respiratoire émettre un bruit de pompe à oxygène d’aquarium, à la fois rassurant par sa régularité et glacial par son mécanisme. Elle imagine tout de même de petits poissons exotiques et multicolores progressés le long des tuyaux transparents comme pris dans le tourbillon chaud d’un fort courant océanien. Mais la réalité est bien différente. Ici, ni horizon dégagé ni récif corallien. Juste deux corps désunis mais obstinément liés, l’un vertical, l’autre horizontal. Faisant face, elle se surprend même à penser que les gens ne vieillissent pas mais qu’ils flottent et pourrissent lourdement. Et, en général, à ce moment précis, la colère prend le dessus. Et, en général, à ce moment précis, une larme s’échappe et disparaît sur le drap protégeant le corps immobile de sa mère.
Lorsque Jésus se rend au cimetière qui jouxte l’hôpital, il pousse la lourde grille en fer forgé sans que celle-ci ne grince, attrape le seau mis à disposition des « visiteurs », le remplit généreusement dans le gigantesque récupérateur d’eau, puis marche religieusement le long du sentier jusqu’à la troisième allée. Les fleurs en plastique à la couleur passée et écaillée qui reposent sur la tombe de sa mère sont défraîchies depuis bien longtemps, mais il ne se résout pas à les jeter. Au lieu de cela, il les arrose, conscient de l’absurdité de sa démarche, mais ainsi sont faites les habitudes, rituels superstitieux et mécaniques. Ensuite, il se redresse, ferme les yeux puis, d’une prière à demi chuchotée, verse une larme qui disparaît sur le marbre sombre protégeant le corps endormi de sa mère.
Une belle histoire durant laquelle le fils est condamné au silence, et la fille à l’espoir.
20h33
Lorsqu’Odona rentre à la maison, elle embrasse un à un chaque membre de son clan, accompagné d’un mot doux, puis file à la cuisine préparer le dîner. Mais ce soir-là, la sphère privée est divisée. Confinée, et temporairement soustraie à la nécessité du sourire, ce soir-là, la famille redessine à nouveau l’espace, bâtissant et érigeant des murs invisibles aux surfaces raturées de griefs.
Lorsque Jésus récupère son fils chez la nourrice, il pose délicatement la paume de sa main droite sur le front brulant de son fils, le prend dans ses bras, l’enveloppe de son large manteau afin de le maintenir au chaud et, sur un plan d’ensemble, le père et l’enfant sortent dans la rue étroite au ton rougeoyant d’un coucher de soleil surjoué.
20h46
Lorsqu’Odona sert le dîner et que le mari observe un mutisme lourd de sous-entendu, elle n’a plus souvenir de leur dernière discussion, mais sait instinctivement qu’elle subit encore les guillemets d’un reproche ponctué de silence.
Lorsque Jésus entend la sonnette retentir, il sait que cette visite n’a rien de courtois. Le petit sac à dos est prêt, reposant sur la table au côté du sachet en papier orné de la coupe d’Hygie qui contient le sirop contre la fièvre. Il enfile le sac sur le dos frissonnant de son fils, l’embrasse et le pousse légèrement vers l’avant. Vu de derrière, l’image ronde et souriante du visage de Mickey lui faisant un clin d’œil a tout d’un réconfort, mais l’effet en est inversé et a tout d’un désastre. La garde prend fin à cette heure, froidement, implacablement…légalement.
20h52
Lorsqu’Odona sort prendre l’air, furieuse et libérant ses larmes d’un mari qu’elle a encore mais qu’elle n’aime plus,…
Lorsque Jésus sort prendre l’air, étouffé et retenant ses larmes d’une ex-femme qu’il aime encore mais qu’il n’a plus,…
… le brouillard s’est amplement installé.
20h53
Provisoirement déracinés, accidentellement dénudés de toutes attentes, ils s’enfoncent, chacun de leur côté, dans la brume nocturne en direction du petit parc artificiel au décor envoûtant de symétrie et d’ordre résidentiel.
20h59
Lorsqu’Odona et Jésus pénètrent au cœur de cette aire de détente, le calme a repris le dessus. Le calme de la détermination, non celui de la résignation. Le réverbère central diffuse une lumière feutrée sur leurs corps fantomatiques. Odona est la première à l’apercevoir, forme au contour indéterminé flottant jusqu’à elle, sa présence est rassurante, presque protectrice. Elle comprend alors qui il est, comment cet homme a, tout au long de la journée, veillé sur elle sans même le savoir. Puis, c’est au tour de Jésus de la sentir. Présence floue aux formes puissantes et habillée d’une aura à l’éclat enchanteur, il avance, en silence, à la fois timide et poussé, pas à pas, puis, une fois parvenu face à elle…
21h00
… ils se rejoignent. Leur rencontre est une reconnaissance, et leur union un hurlement. Ils s’enlacent, s’étreignent, se déchirent, s’embrassent, s’embrasent… fougueux, furieux, bestiaux… humains. Plus qu’humain, androgyne et complet, recomposé et guéri de leur nature.
21h02
Leurs lèvres se décollent, leurs corps se détachent, prudemment, douloureusement. Leurs mains se dérobent, seules leurs pupilles accrochent encore l’écorce hâlée de leurs visages balafrés au reflet d’un halo lunaire sauvage et irréel. Enfin, ils se séparent, épuisés et apaisés, ensorcelés mais désenchaînés, haletant une liberté héritée de celles qui se prennent et non de celles qui s’apprennent. Puis, incessant et inexorable mandataire, chacun reprend son chemin. Un chemin à la fois identique et tellement différent. Un chemin qui, ce soir-là, se changea en promesse.
Une belle histoire durant laquelle tous les personnages joués et incarnés, tous les rôles, aux répliques pré-écrites, récitées et articulées, imposés à des acteurs prisonniers du quotidien, s’effacent et laissent place aux vivants.
Epilogue
7h00
Le lendemain matin, lorsqu’Odona se réveille, les costumes de la journée sont à nouveau rangés dans son placard corporel. Propres, lisses et patients, évidents vêtements de l’oubli. Mais elle ne se lève pas immédiatement, éprise d’une douce chaleur émanant de son bas-ventre, qui se propage le long de ses membres et la maintient allongée. Son visage endormi s’illumine timidement d’un sourire prude, ses yeux se plissent, puis se remplissent de malice, laissant sa main parcourir les formes charnelles de ce corps depuis si longtemps délaissé, sachant désormais où aller, et pourquoi.
Une reconquête.
Le lendemain matin, lorsque Jésus se réveille, sa résurrection se traduit d’abord par l’envie. Peu importe laquelle, il a juste envie. Puis, agréablement, vient l’arôme, mélange organique d'un goût parfumé tenace et d’une odeur corporelle ranimée. Il navigue prudemment entre onirisme et douce exaltation, caressant avec sensualité le galbe d’un sein sur le corps imaginé et endormi reposant à ses côtés, laissant ainsi le quand s’estomper au profit du maintenant.
Une renaissance.
Ainsi fut écrite « la belle histoire » durant laquelle l’instant prit le pas sur l’éternité… et, vaincue, l’éternité céda sa place, le temps d’un instant.
ENSE7168
Le premier « Je t’aime »
J’ai vécu jusqu’à soixante-quatre ans en n’allant consulter un médecin que pour des affections bénignes, mais fréquentes, des voies respiratoires. J’ai longtemps habité en région parisienne – j’y suis arrivé à l’âge de six ans, en 1958 – et la pollution ne me réussissait pas trop.
De locations à Paris en appartement en banlieue Est, mon épouse Janice et moi étions parvenus à acquérir une maison individuelle confortable, dans un lotissement du 9.3, où notre fils, Julien, disposait de deux pièces, une chambre et un bureau-salle de jeux.
Nous formions une famille unie, nous contentant de l’affection de nos proches, ne cherchant pas à élargir nos relations au-delà du cercle des fratries et cousins germains. Notre entente suffisait à notre bonheur.
A dix-sept ans, Julien, féru d’informatique, avait fait la connaissance virtuelle d’une jeune toulousaine de son âge. Ils se sont écrit, se sont rencontrés, se sont plu. Julien n’avait qu’une hâte : terminer ses études pour retrouver celle qui allait devenir son épouse trois ans plus tard.
Un BTS en poche, puis un deuxième, une situation rapidement trouvée en plein Paris, des parents attentionnés, deux pièces personnelles : il allait tout plaquer pour s’installer chez Irène en 2001, dans un studio où leur attirance mutuelle allait s’épanouir.
Quelques jours après son ‘déménagement’, je me suis assis sur son lit d’adolescent, ai contemplé les murs couverts de posters, son bureau encombré, dans cette chambre à jamais désertée, repensé à certains moments passés en compagnie de mon fils, et mes larmes ont coulé.
Abondamment, silencieusement. Mon fils avait quitté le nid et volait de ses propres ailes, loin.
Je me remémorais ces digues de sable que nous bâtissions sur les plages du Médoc pour diriger les eaux de ruissellement dans un bassin où, enfant, il barbotait avant que les vagues ne viennent ronger les murailles et finissent par les détruire ; les parties de cache-cache à deux, dans la maison et le jardin ; les jeux de piste que j’élaborais à travers l’appartement pour qu’il découvre, finalement, le trésor : son goûter emballé dans un papier d’alu dans le buffet du séjour ou sur une pile de serviettes, dans un meuble de salle de bains ; son initiation au bricolage consistant à me regarder, puis à m’aider, jusqu’à ce qu’il m’interdise d’approcher du chantier qu’il menait pour construire la niche isolée du seul chien que l’on ait eu ; le dressage de celui-ci qu’il avait effectué à notre insu, fier de nous en présenter les résultats : assis, couché, au pied, pas bouger ; sa réussite scolaire aussi : bac, BTS de bâtiment, BTS d’informatique, et la fierté d’un père d’avoir un fils plus diplômé que lui, mieux armé professionnellement dans une société distribuant les places au compte-gouttes ; la complicité des deux lorsque, après l’achat d’un premier ordinateur, le père créait, en deux ou trois heures, des programmes destinés à empêcher le fils d’utiliser ce matériel, programmes annihilé en quelques minutes par le jeune prodige dès qu’il savait son parent absent pour un moment - exercices préparatoires aux études d’informatique qui le passionneraient et dont il ferait son métier.
Les parents près de Paris, le fils à Toulouse, la distance était trop importante pour nous voir. Janice et moi avons vendu la maison du 93 et nous sommes installés en 2002 dans notre résidence secondaire de la Creuse, une vieille grange en ruine acquise en 1978, que nous avions retapée pour la rendre habitable, en y passant plus de la moitié de nos vacances d’instits.
Que de souvenirs s’attachaient encore à ces lieux ! Julien, six ans, tenant un seau de plage pour recueillir les gravats qui tombaient alors qu’il grattait le vieil enduit à la truelle langue de chat, après m’avoir vu faire ; Julien disparaissant des après-midis entiers pour aller faire la conversation avec une voisine, et Janice l’appelant en vain, s’inquiétant au début puis laissant faire par la suite ; Julien se lançant dans le tour du hameau peu après qu’il ait appris à rouler à bicyclette, et revenant couvert de cloques, après sa chute dans un bouquet d’orties …. Il était fils unique, indépendant, mais il était près de nous.
De Paris en Creuse, la distance qui nous séparait était réduite de moitié, mais ne permettait pas de nous voir très souvent. Seuls, des évènements servaient de prétexte : le mariage de Juju et d’Irène en 2005, la naissance du garçon fin 2006, celle de la fille mi-2008, les repas de Noël …
Pour cette dernière occasion, nous continuions à lui offrir des cadeaux, mais, devenu chef de famille, il nous en offrait aussi en retour, cherchant à nous faire plaisir en les adaptant aux lubies du moment : un logiciel de Scrabble pour occuper ma retraite survenue en 2007, des tubes de peinture après mon inscription à un club d’artistes en herbe, un livre illustré de tableaux de grands peintres car la passion persistait, son appareil photo, plus perfectionné que le mien, un catalogue de plaques de Champagne quand il eut appris que je collectionnais les muselets, un ordinateur plus récent pour remplacer l’ancestral que je détenais et dont le disque dur était proche de la saturation …
Il est vrai que nous l’avions choyé comme on gâte un enfant unique. L’argent tiré de la vente de la maison de banlieue parisienne avait été investi dans l’achat d’une maison en banlieue toulousaine, où sa famille résidait sans devoir de loyer. Il faut bien que l’argent dont nous disposions lui serve aussi, comme il avait servi dans sa jeunesse, comme il servira lorsque l’héritage lui reviendra.
Jusqu’en 2016, j’étais donc en bonne santé, espérant vivre encore une cinquantaine d’année sur ma lancée – avec les progrès de la médecine, qui sait ! – n’étant plus allé chez le médecin depuis notre installation à la campagne, hormis pour les vaccinations.
En août, sans en comprendre les raisons, je me fatiguais rapidement au cours de travaux qui, d’ordinaire, me plaisaient : tronçonner du bois en prévision de l’hiver, tondre le pré, déplacer des tonnes de pierres pour maçonner un kiosque ou une allée de quarante mètres, grimper sur le toit pour ramoner ou replacer une tuile, entretenir la bâtisse vieille de plus de deux siècles (elle figure sur les plans napoléoniens).
En septembre, je me traîne, je n’ai plus goût au travail manuel, bricolage ou peinture.
En octobre, je me plains de douleurs en haut des intestins, des deux côtés. Un gastro-entérologue me fait passer pour la première fois de ma vie sur le billard pour une coloscopie, après la purge adéquate. Beurk. Un petit polype est enlevé, rien de méchant, « vous n’avez rien, continuez à manger normalement, et tout s’arrangera. »
En novembre, impossible de trouver le sommeil en position ‘normale’ sur un lit, allongé à plat ventre, de côté ou sur le dos. J’y parvenais pendant quelques heures en me plaçant au bord, à genoux sur le tapis, le ventre posé sur le matelas, en travers du lit.
En décembre, mon médecin m’ausculte : le rythme cardiaque est déroutant au point qu’il me prend un rendez-vous chez le cardiologue pour le surlendemain. Myopathie. Un traitement s’impose pour éviter l’AVC. Mais les douleurs abdominales persistent. C’est ce cardiologue, lors de la visite de contrôle, qui prend sur lui de me faire passer un scanner. Le mal apparaît alors : métastases dans le foie causé par un cancer du pancréas. Je n’en ai plus que pour deux ans, d’après les estimations d’un autre gastro-entérologue, plus humain que le premier.
Julien est informé par Janice. Il est on ne peut plus perturbé. Ses collègues le ressentent dès le lendemain. « Mon père va mourir » annonce-t-il, au bord des larmes. C’est dans l’ordre des choses, mais difficile à accepter ! Le choc est d’autant plus rude qu’il m’a toujours connu en bonne santé.
Mais ce père s’accroche. On prévoit de commencer une chimio en janvier 2017, mais pour ce Noël 2016, pas question qu’il se déplace à Toulouse, comme les années antérieures. Pas de fêtes en famille.
Alors, le 28 décembre, Julien a décidé de me faire le plus beau cadeau que j’aie jamais reçu : il est venu passer trois jours chez ses vieux, en Creuse, dans le froid et l’humidité, l’inconfort, venant seul sans sa chérie et ses enfants, sans emballage-cadeau dans le coffre de sa voiture, n’apportant que sa seule présence pour être de nouveau ensemble, tous les trois, comme avant.
A la recherche d’un temps perdu…
A son arrivée, je suis allé ouvrir le portail pour qu’il puisse entrer sa voiture sous le carport devant le garage. Pendant qu’il sortait de son véhicule, je refermais les battants en bois. Puis nous nous sommes rapprochés et je me suis précipité dans ses bras, comme un enfant qui cherche une protection, en pleurant de joie de le voir. Trop pudique, je n’avais jamais osé l’avouer, mais, pour la première fois de ma vie, je lui ai dit : « je t’aime, mon fils. »
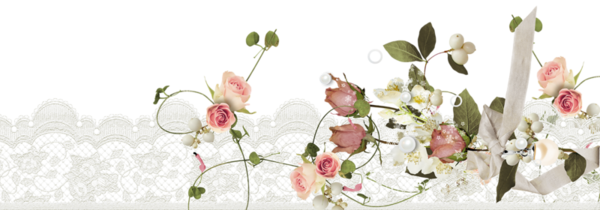
FARA2018
Farandole.
Un déluge martèle le toit de tuiles rondes. De grosses gouttes frappent en un chant saccadé le vieux mas perdu dans les collines bleues. Le tambourinement de l’eau devient berceuse et l’emporte, seule, vers cette fin de nuit.
Renait le soleil léger d’avril sur la campagne provençale. Quelques pas sur les pavés mouillés aux couleurs truquées. La chaleur caresse légèrement ses épaules. S’égouttent des perles de pluie sur toute la nature alentour. Parfums d’après l’ondée, de farigoule, de romarin se séchant au réveil, de glycine tendre, aux fleurs mauves se redressant fièrement après l’averse ! Le feuillage argenté des oliviers bruit, insouciant, sous la bise tiède et, inconscients, les iris se balancent. Leurs intenses violets, leurs jaunes ardents l’ensorcèlent. Les lavandes, disséminées dans le vallon, présument un été exhalé. Ne surtout pas oublier les toujours, se répète-t-elle.
Un papillon citron volette, totalement ivre. Grince la girouette de fer forgé posée au sommet du pigeonnier : cette jolie silhouette féminine se cramponne à un parapluie retourné par un mistral déchainé. Florine lève la tête, attirée par le piaillement des alouettes. Elle le revoit, clouant les maisonnettes colorées dispersées dans le verger pour abriter, à la mauvaise saison, ces piafs découragés de leurs ailes mouillées.
Au loin, la cloche d’une chapelle tinte dans l’azur revenu en ce ciel printanier. Ici, l’air sent la terre. Dans un murmure d’eau, d’une roche verte de mousse, s’écoulent quelques gouttelettes. Ainsi, une flaque fait le bonheur d’une bergeronnette qui sautille de-ci de-là, admirant sans fin son reflet. Minette guette, en lapant dans l’arrosoir à la panse rebondie. Attention ! Minette arrive timidement, sur la pointe de ses griffes, comme pour éviter la rosée et risque de ne faire qu’une bouchée. Mais, l’oiseau avisé s’est envolé.
De sombres vignes aux troncs noueux prévoient l’apparition des premiers bourgeons. Bientôt, ils éclateront, épanouis en leurs délicates feuilles. Elle l’espère, dans le jour finissant, sécateur à la main, prenant soin des sarments ; avant l’enlacement.
Sur le muret de pierres, elle s’assoit quelques instants. Se faufile un lézard curieux, prenant la pose dans la blancheur de la roche. Déjà, les hauts cyprès dessinent quelques ombres. Rêveuse, elle croit l’apercevoir. Elle s’enflamme. Illusion ! Les buissons resplendissants des genêts bourdonnent et, frénétiques, les abeilles s’en donnent à cœur joie. Leurs ruches accoutrées de rouge s’exhibent entre lierre et herbes folles. Comme elle, se souvient-il ? Un orage dont ils sont rentrés trempés, les vêtements collés à leur peau frémissante et puis…
Au loin, un campanile domine le village perché, nimbé de lumière. Les ocres sont partout : du sol aux murs des maisons, jusqu’aux marchands de couleurs. Sur la place, les platanes étendent leurs nobles branches. Surement, quelques vieux silencieux, assis sur un banc usé par les années, regardent passer le jour, hochant parfois la tête, perdus dans leurs pensées. Il les saluera. C’est certain. Elle entend sa voix, si chantante. Enfant du pays, tous le connaissent ici. Peut-être tentera-t-il d’apercevoir au milieu de la garrigue, la maisonnette où elle l’attend. Elle l’espère tant.
Gazouille surement la fontaine de la placette d’où s’échappe l’eau claire des sources ; les ronds grandissent dans le bassin jusqu’à disparaitre pourtant. Les enfants viennent y boire au plus chaud du jour et s’éclabousser dans leurs jeux et leurs rires clairs.
Elle imagine l’odeur de pain chaud se mêlant à la fleur d’oranger des navettes dans la petite boutique d’Adrienne. Elle imagine le marché du jour : premières fraises, olives à toutes les sauces, épices douces ou pimentées dans leurs sacs de jute, en une mosaïque de couleurs, de senteurs du monde entier… Et les caquètements, et les cris des chalands à l’accent truculent…
Mais un troupeau de chèvres distrait son regard. Les sauvageonnes sautillent sur le chemin, se régalent follement, au passage, des plantes sauvages des collines… La bergère chantonne, sort de sa poche un fluteau et, au milieu de ses bêtes, entonne une farandole.
Un sifflement reprend le même air.
Elle le devine.
Un aboiement effraie les chevrettes. Un appel ramène le chien vers l’homme.
Il est là, sur le sentier de graviers. Il est là, marchant vers elle, un brin d’églantine cueilli en chemin, à la main.
S’estompent alors les abricotiers, les amandiers en fleurs, le Ventoux enneigé dans le lointain car soudainement, tout s’évanouit. Pour lui.
IVRE2222
La poétique d'Yseult
Adôn. C'est le misanthrope le plus détestable de Melpomène, on dit qu'il sort moins depuis qu'il s'est marié. N'appréciant guère le siècle, la temporalité, il reste aux chevets de rêves, un peu comme un visionnaire fou, qui sauve sa conscience par la création de son mythe, unité artificielle pour survivre et porter une cohérence
Adôn marche doucement, il rentre dans le cabaret près des deux fontaines de Melpomène, à la peinture un peu vieillie. Il boit un liquide noir pétillant en s'imaginant la beauté du monde voûté. Console-t-il ses concepts en se perdant dans le battement de cils de la femme aux lèvres amarantes ? Ils frappent, lascifs, comme des tambours. Adôn sombre, il veut violer. Il veut tuer. Je le regarde qui fait semblant de se tordre aux jeux humains. Il se dresse dans son manteau, et quitte le cabaret – regardé par toutes les âmes palpitantes du soir. Gagnant bientôt son pavillon, pendant que la nuit sombre, il s'approche de sa femme. Elle murmure, un peu émue, en touchant l'irrégulier de son visage, il la fixe abasourdi, le visage étiré, l'expression pure. En les regardant, sans doute, on eût procédé à d'ignobles remises en question au sujet de l'essence amoureuse – on eût voulu cesser de prier, pour les voir. Voir cette union comme cette femme voit cet homme. Je regarde ces âmes mortes se panser ou renaître. Souffrant si vivement, découvrant un instant le doute qui s'éclate, se morcelle, se brise en larmes. Ils vivaient le besoin dans le choix, le choix dans le besoin, absolu besoin de l'autre, insignifiance du monde sans cet autre chaleureux mais inimaginable, total, révélant la pauvresse des populations, la pauvresse des paysages, jusqu'à la vanité de sa propre vie, peut-être. Pris au jeu, nous autres, nous nous plongeons dans les bourdonnements de musiques violentes, nous inventons souffrances et eurythmies, nous alimentons la mort de notre sphère – et – par angélisme nous tirons près de nous une âme stupide dont l'allure semble pétillante, dans l'espoir de la métamorphoser en notre soeur. Puis, nous ricanons, parce que cela ne fonctionne pas, et que, nous sommes seuls. Ces deux intelligences se testent, se contrôlent, s'échauffent, se brutalisent et s'excitent, par l'aversion et la splendeur de l'occasion. Il l'attrape. Dans une tranche d'éternité. La travaille, parce qu'il se travaille. Les secondes se pourlèchent de leurs possibles ; le réel résiste encore à l'accouplement des titans – ces titans, morcelés en hommes par leur stupidité ; la soumission de leurs forces devant l'Era jalouse. Mais déjà attend-on l'après création ; imaginant, l'oeil chatouillé, la foudre à naître, cruelle, cérébrale, affamée, creusée des beautés douloureuses de l'élément premier.
L'inadéquation et le dégoût – pourtant – ne s'échappent jamais tout à fait ; comme tout être mélancolique et malade – dont Adôn représente un acmé – il est en manque.
Il découvre sa femme, avec la convoitise du mari crépusculaire. Il l'aime autant qu'elle l'y invite par la braise de sa posture. Elle l'aime. Oh. Un vertige puis le silence. Il part au petit matin, dans le calme de celui qui ne sait plus dormir. Il semble heureux et déçu. Je le regarde se préparer à l'accouplement des mots, à la violence et la paix de l'ailleurs. Le train traverse les dernières campagnes de ce pays emmuré.
Son oeil s'ouvre sur le dessin ailé du feuillage, sur le palpitement douteux du blé chaud et fatigué. Son regard orange se trouble. Il fantasme le plissement des eaux régulières, les longs chemins noirs qui tranchent douloureusement la mer, les plaques rosées du ciel – l'enveloppement marin des créatures libres des coulées de pétrole, les nuages épais, peints, flottants, qui rougissent sous la lampe solaire, le coeur âpre de la nuit qui – indifférente – arrive. Son hémisphère jette son oeil à gauche, il rencontre la source Mnémosyne, il baisse les yeux. En colère et murmurant en ses pensées ses vers kierkegaardiens qui s'obstinent sans s'expliquer : « Partager cette vie avec une autre âme – impossible, aimer et être aimé – impossible, partager l'absurdité et la maternité de l'autre – impossible, aimer les niaiseries nécessaires, impossible, ne pas partager la folie de sa vérité et les douleurs de son silence – impossible, ne pas aimer la cruelle solitude – impossible. » Il se révulse d'entendre ses incantations devant la totalité de sa tension amoureuse.
Arrivé à Chôra, son mètre quatre-vingt-huit évolue sombrement, creusé par une migraine à la hauteur de son absolu. Des hauts-le-coeur remuants lui rappelle son existence matérielle qui le dégoûte pour la forme, le fascine pour l'occasion. Il s'achemine à l'hôtel Exaiphnès, faste mais peu grand. En montant les marches brunes, il cristallise une observation pure, alerte et splendide. L'eau, au dehors, percute les rues, en cliquetis automatiques, elle nettoie les routes, les asphyxie. Seul dans sa chambre, alors qu'il rassemble ce qui ressemble à ce qu'on appelle communément « pensées », une fille gronde dans le couloir, assez pour marquer sa véhémence mais dans une retenue certaine, offrant un ton ciselé et ironique. Elle ne sait absolument pas ce qu'elle fait bien là. Elle exprime sa révolte quant à sa condition sociale antinomique avec la royauté de son âme, pense Adôn, par hasard, envahi par la pointe d'une ironie. Elle frappe avec un acharnement impalpable à la porte dix-sept. Elle annonce en essayant de ne convaincre qu'elle : « c'est votre commande ! ». Adôn patiente, un petit sourire – peut-être nerveux – décore son être.
Assis, il réfléchit à l'occasion et au tonnerre qui halète devant sa porte. Devant cette ultime humiliation qu'elle croit combattre et saisir personnellement, Yseult questionne avec dégoût ce qui la pousse à la pire misère plutôt qu'à la mort. « Croire ou croître ! ». Mais elle sait, son orgueil la maintient en la détruisant. Il est l'origine et le serpent. Le violeur, l'impulsion et le joug. Adôn ouvre, d'une voix pleine, souple, vibrante, en inclinant son regard mais avec une certaine indifférence, il dépose : « mademoiselle ? »
Elle relève la pureté de ses billes d'acier – dont elle ignore la beauté. Un long silence très court. Elle tente de se reprendre « votre bol de mûres que vous avez commandé d'urgence. » Elle insiste sur « d'urgence » et s'apprête à se détourner, mêlant ses préjugés fraîchement formés et ses douleurs, mais une voix la retient et semble l'enchaîner dans une vapeur hors du temps. Adôn sourit « prenez une mûre – il insiste – celle-ci, regardez, elle se mue et appelle vos lèvres. » Elle n'a pas l'instant de répondre, qu'il lui enfonce doucement au fond de la bouche. « Pourquoi des mûres monsieur ? » se surprend-t-elle à demander, goûtant la mûre. Sa manière violente et tendre d'insister sur « monsieur » le pousse à se perdre dans l'océan de son regard. Il insiste et s'enfonce sans précautions dans le danger bleu. « C'est le fruit de l'absolu, ne connaissez-vous pas la légende ? » Yseult ouvre grand son âme et demande à la connaître. Adôn s'assombrit puis savoure l'énergie chaotique d'Yseult. « Si tout va bien, je vous la conterai ce soir, dans vos rêves. » Elle ne relève pas mais cogite lourdement. Elle s'assombrit comme jumelant Adôn ; elle considère avec une horreur destructrice son ignorance, inacceptable – elle constate la brûlure qu'impose son orgueil viscéral. Elle abandonne le bol de mûres et disparaît. Elle regrette, un tas de choses et rien.
Il se gave de mûres, à la fenêtre, après les avoir fourrées de substances mortelles- – dans l'attente inconsciente et rongeante de me rejoindre, moi, sa notice. Férocités et délices de la nuit. Ses lèvres rougies, bloquées, entre-ouvertes, frémissent sur les pointes acides et sucrés. Ses yeux se figent. Il est quatre heure du matin. Ses mains sont liées, son froid plein, transcendantal ; devenant la posture de sa réflexivité. Sa moue royale. Il sourit dans la mélodie du chaos inacceptable.
Sa pensée le surprend, l'isole, et le rappelle à son naturel mélancolique. Elle jette sa folie contre des fontaines de lames. Les flûtes et les pianos, recouvrent l'espace noir trop aimé. Une transe nouvelle l'attaque, les décors fondent et le déposent dans un lieu adoré plus chèrement encore du non-sens. Il craint la beauté de son irréalité. Les pages de livres s'alignent et se codent, dans l'indifférence. Il crache et hurle de douleur. Son corps s'éparpille, perdu et génial. Il pleure. Frappé pour la première fois. Ses membres violacés se glacent et l'échauffent, son oeil se fige en verre brisé, face au désespoir. Il regarde cette culture, sa bêtise et sa dissidence, son attente irrésolue qui semble n'avoir jamais été qu'un leitmotiv venu de nul endroit. L'absurde n'a plus de mots. Les maux de son intelligence en un déchainement de forces antagonistes le tordent. Tout semble incroyable devant la dernière mûre. Fourrée d'illusions, comme tout. Il entrevoit la libération de sa monstruosité, l'éjaculation de sa fente cérébrale, le déclin de sa tension fantasmatique. Le calme.
Ses hurlements, qui dans ses fièvres, se font maintenant effectif alarment Yseult, qui non loin, dans sa chambre minuscule, écoutait non sans désespoir, le silence en visualisant d'épaisses mûres. Elle fonce par les vertiges de la nuit, précipitée par son instinct, son corps bat, halète, pulse, sa vie croit se gorger de sens, son esprit tyrannique l'épargne une seconde, parce que ce n'est pas elle. Elle visualise le numéro dix-sept. Le pass en mains émues, elle brusque la porte. Le monde semble réunir Yseult et Adôn dans une éternité douloureuse et transparente. Elle cueille l'homme tétanisé et tremblant. Son oeil violent et épuisé la menace – ses mots qui ne peuvent plus parvenir brûlent par sa dilatation. Il supplie qu'on ne le sauve pas. Menace encore. Le corps chaud et convulsé dans ses bras, Yseult se trouble et s'effraie. « donner cet être à la mort et au silence – impossible. Apparaître en tant que disparu – impossible. L'unique nombre qui ne peut être autre. J'ai décidé. » Elle maquille son égoïsme dégoulinant de grands principes par pudeur. Honteuse, elle court pour sauver le seul homme qui a éveillé les sphères les plus vives de sa complexion.
Après les vacarmes inquiets de l'hôtel et de son petit peuple excité, Adôn est rapatrié, inconscient. On hurle à Yseult de retourner à sa chambre, de ne se mêler de rien. Son oeil se gorge de sang, sa fureur l'embaume. Furieuse, inspirée, elle déclare sa démission. Elle court dans un bonheur ambigu, rejoindre un sac en tissu volant en main, l'ambulance sur le départ. Tremblante et émue, elle feint être la petite soeur du mourant. Les ambulanciers fatigués par les nuits blanches semblent d'une compréhension désintéressée. Yseult, bloquée par Adôn, rêve de partages. Partager la folie et le tonnerre. Sait-elle seulement quelque chose de la folie ou du tonnerre ? Elle fronce son sourcil noir. Bientôt elle hurle « dépêchez, dépêchez ! Mon frère va mourir ! » ses yeux menaçants se gorgent des flux maternels devant le danger des créatures pures. Une tension meurtrière crispe son visage. Elle suit – inquiète – le pouls caprisant d'Adôn.
Dans l'étroite chambre d'hôpital de Chôra, Yseult dévisage le visage blême d'Adôn. La mort l'inquiète encore, elle se sent creuse, inconsistante. Trop orgueilleuse, encore. Persuadée qu'il sera son seul grand ami. Ses traits sautillent au moindre de ses mouvements de vie. Sans recul elle pense à la légende de la mûre, qu'elle ne connaît pas. Elle cherche sa curiosité pour calmer son angoisse. Mais sa fascination morbide ne la laisse pas. Elle s'approche du malade endormi, pour soustraire au danger imaginaire un danger réel et maîtrisable. Elle plonge sa main dans son pantalon. Elle trouve sa carte d'identité, comme elle le souhaite. Elle écarquille son oeil fatigué, plonge sa chair entière en ces lettres folles et pleines. Le prénom la fait jubiler de puissance. Elle regarde maintenant la photo. La photo… Sombre, dans un souffle marron, le visage fendu de beauté, guerrier épuisé, ange épais et absolu. Ailes noires. Ailes blanches. Elle range violemment la carte, souillée.
Prisonnier de son souffle, il ouvre les yeux. Les petites joues d'Yseult se peignent vivement, et son oeil bleu, trop heureux, cristallise le vide merveilleux en train de s'emplir. Une crème pleine d'odeurs, du musc et du miel, un lait de licorne, un accouchement sans douleur. Jusque là vaporeux, Adôn, se relève violemment, le dos crispé, brisé. Il constate l'effective présence d'un être dans le lieu de son agonie, où il discutait le testament de sa vie. Il gronde faiblement « Mais enfin, qui… qui… êtes-vous ? » Elle s'égaie de folie et annonce orgueilleusement « je suis votre femme ! » Il se redresse, plus brusquement que la première fois et rougit au coeur de son visage livide. Son corps bat et pulse. Il dévisage Yseult non sans quelques plaisirs. Il murmure en enfant à son sucre séduit « êtes-vous vraiment ma femme ? » Elle s'amuse et s'apaise, ne quittant pas la connexion visuelle. Elle explique, convaincue « nous nous sommes rencontrés il y a quatre ans, ici même, liés à jamais autour d'une légende que vous m'avez jusqu'à ce jour tenue secrète, comme l'étincelle qui bourdonne depuis votre âme. »
Il veut se précipiter en elle, la respirer, l'étreindre et la serrer violemment contre lui, mais elle court à la porte. La referme, la réouvre et s'exclame hésitante « je ne vous ai point menti mais je dois vous avouez qu'il ne s'agit pas de la vérité de ce monde ; ici ils appelleraient ça de l'ironie. Mais vous savez de quoi se nourrit l'ironie. » Elle referme, houleuse, attend une seconde, réouvre et ajoute « je vais vous prendre un café ». Elle s'apprête à fuir mais il gronde, l'oeil puissant « attendez ! »
Elle obéit et revient, tremblante et perturbée. Il sourit en la sentant fébrile, prise d'un élan dont elle ne peut comprendre l'acception. Elle regrette son audace, il insiste « approchez ! encore ». Elle est debout, face à lui relevé sur son lit. De sa main droite il prend doucement ses doigts, épouse le dessin de sa joue de sa main gauche et l'attire à lui.
Ses lèvres devant son oreille délicate, il dépose, lascif « êtes-vous sûr que vous n'êtes pas ma femme ? » Son regard brisé pique d'érotisme et de désespoir.
Elle respire fort et sent une tension sexuelle parcourir son corps et la prendre en une ivresse circulaire, vertigineuse. Elle se précipite hors de la chambre pour revenir à elle. Comme restée une seconde de trop sous l'eau ; par cette seconde qui démontre la mort, la vie et l'absolu d'une seule esquisse.
Son esprit évanoui croise une femme embellie par un flot de larmes sincères, décorée d'une grâce que les passions aiment. En larme et confuse, elle regarde Adôn. On dirait qu'elle ne l'a pas vu depuis l'éternité. Elle s'agrippe à son corps malade sans le reconnaître.
L'élan qui la jette près de son mari est ambigu. Un filament naïf et tremblant semble s'évanouir. Elle n'aimera jamais un autre homme, elle le sait.
Le regard d'Adôn est douloureux, heureux et plein de fantasmes. Pourtant sans réponses. Le trou noir qui creuse son âme loin des autres ne concerne pas cette reine, mais il ne sait lui exprimer. Il regrette, un instant son association aux souffrances d'êtres émotifs.
Prisonnière de cet inconnu génial, elle annonce simplement « il y aura des séquelles, graves. Les médecins proposent un traitement. Je sais que tu ne le prendras pas. Sache que cela empiétera sur toutes tes actions. Comme un sentiment qui te ronge et t'obsède. Qui t'obsède. » Il éclate de rire à entendre sa femme. « Je n'écris jamais aussi bien qu'en pleine dégénérescence, mes nourritures se soupçonnent enfin. De la vie jetée, dense, enlevée ! Apporte-moi un petit papier et un stylo s'il-te-plaît, et préviens le médecin, nous rentrons à Melpomène. »
Elle se glisse derrière la porte. Adôn seul, boue et s'agite. Pris d'un besoin immédiat de retrouver l'enveloppe de ses livres, de sa capsule d'absolu maitrisé. Il l'imagine s'effriter, écarlate et chevrotante.
À l'étage du dessus, confinée derrière les plaques de la véranda, Yseult maintient le café froid dans sa main tendue et immobile. Son tonus musculaire se fige, elle agonise dans une transe cérébrale. « A-t-h-a-n-a-s-o-n ». Les phrases qui défilent avec boulimie s'évaporent successivement. Son corps, épris d'émotions vives est dans l'impossibilité de se détendre. Elle veut se dissoudre, se résoudre, partir loin. Elle hésite, l'élan de son corps la jette dans la chambre d'Adôn. La chambre est vide. Elle n'est pas étonnée. Un feuillet relève l'attention de son oeil. L'homme a déposé en noir cinq mots : « Elle est belle, tellement belle. »
Elle prend le feuillet, le plonge dans son sac en tissu, quitte la chambre mais s'agrippe à la porte. Impossible.
Yseult imagine les bâtisses baroques, qui souhaitent pointer le ciel, sous prétexte d'obscures révélations. Elle se retrouve dans un parc silencieux comme une forêt en attente. Les ferrailles dans les rues ne tombent plus et les véhicules n'avancent plus que péniblement. Elle s'endort.
Au petit matin, chauffée par les brins solaires, Yseult découvre le lever du bruit. Sur un banc de son allée, une femme coiffée de mille petits objets écrit. Yseult l'aperçoit de dos. En mordillant son chocolat noir elle l'observe et s'interroge sur l'activité qui anime les mains et le corps de cette chère dame. Elle rit. Ses petits yeux profonds se plissent. Écarquillant l'oeil elle reconsidère la bouteille. Elle sourit un peu et se jette sur le liquide alcoolique, en s'adressant à la jeune femme : « Excusez-moi, dame, madame, daaame. Elle rit. Connaissez-vous la légende de la mûre ? Yseult se penche vers Christelle.
– Non, elle pose un regard méprisant sur la demoiselle titubant et exhumant l'alcool.
Le monde se dessine, se peint. Yseult sort du parc. Non, le monde ne change pas. Il est saisit autrement, neutre, aux parures impersonnelles.
– Connaissez-vous la légende de la mûre ? Le beau garçon, un peu jeune, les yeux noisettes, inoffensifs, la regarde. Il est très grand, son corps est athlétique Il semble ne pas comprendre son langage, il n'a pas le temps de s'en excuser qu'elle se détourne. Un autre semble se présenter, dans la rue suivante. Il est petit, plus âgé. Son cheveu est dense, noir. Son oeil furieux. Il est interrogatif, la capte une seconde et capitule devant la question. Yseult s'éloigne en songeant. La rue s'assombrit, les passants se dispersent.
Un dernier homme la capte. Son habit est celui d'un esthète élégant, désinvolte. Sa prestance affirme sa supériorité intellectuelle, et son dégoût du monde. Il la regarde, avec instance. Hésite, ironique. Il semble illuminé, coquin et lucide. Il déclare, plein de charisme, d'éloquence : « je connais la légende de la mûre. » Il écoute sa voix vibrer, adorant le spectacle. Les ténèbres de sa conscience s'immolent. Yseult écarquille les yeux. « Venez chez moi, je vous la conterai ! » s'exclame-t-il en partant. Yseult le suit, sans réfléchir, subjuguée, hors d'elle-même. L'oeil noir de Natanael sourit, comme un petit démon en confiance. Il regarde droit devant lui, roi de sa scène. Il se déteste et s'invente un amour absolu par le regard de l'autre qu'il maîtrise par la colère de son intelligence. Il enfonce rarement son oeil en Yseult, qu'il sent déjà fébrile. Elle est assise sur le lit étroit. Lui sur le fauteuil. Il la regarde, comme omniscient, ricanant, assombrit.
– Je suis dépressif, ses lèvres retombent, le noir de son oeil fixe Yseult. Riche et dépressif. Je ne crois en rien, sinon en mon mal suprême ! On m'assassinera, de toute façon. Je ferai trop de cruauté.
– Êtes-vous sérieux ?
– Enfin, quelle question ! gronde-t-il en souriant. Yseult est troublée. Taisez-vous, je suis inspiré ! Il attrape son cahier qu'il renverse, et griffonne. Vous m'inspirez, chérie, murmure-t-il avec amour. Il la regarde amoureusement. Amoureusement mais incapable d'amour. Il devient beau. Le tombeau d'Yseult. Elle plonge en lui. Elle est en colère car tout lui échappe. Sa pensée se trouble, elle est figée et ne sait plus prédiquer. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Elle replonge, il est plus beau encore. Et froid, très froid.
Elle a oublié la légende de la mûre et s'accroche à sa lèvre, à son mot, parle-moi encore, dirait-elle presque, possédée par son charisme. Il relève sa jambe, sort une cigarette. Il se lève et se penche à sa fenêtre. Il récite quelques vers d'Éluard et de longs passages de Céline, il s'émeut et gronde « je déteste exister. Vous êtes intelligente, je le sais, ne crispez pas votre lèvre, je ne vous trouve pas jolie sinon ! Je vous aime belle et soumise » Il sourit. Yseult se dirige vers la sortie, indignée. Il ne la suit pas. Elle s'arrête et hurle « c'est tout ? » Il écarquille les yeux et déclare « comme vous êtes grossière, je suis ironique. Je suis un être ironique, voyez-y là mon affection pour vous, si grande déjà ! Mais si vous préférez me laisser… ah… dans ce cas ! Je me serais trompé sur le lien qui nous a uni dès notre premier regard. Je vous ai aimé, dès le début, mon presque amour. »
Il ne la regarde pas, il écoute sa voix vibrer, devant le ciel. Yseult est tendue, incapable et surmenée, dépassée et en colère. Elle revient. S'assoie. Consciente, inconsciente. Il revient sur le fauteuil. La regarde et affirme :
« Je suis un acteur, un comédien, un menteur. Écrivain aussi, théoricien et poète. Dépressif et obsessionnel. Insatiable et sans contours. Sans coutures !
– Merci de vous confier. Ne me mentez pas, jamais. Cela n'a aucun intérêt pour vous. Je vous accepte tel que vous êtes, quittez vos masques, murmura Yseult stupéfaite.
– Vous êtes si gentille. Je n'ai que des masques, je ne suis rien. Et si malheureux !
– Parlez-moi de ce malheur.
– J'ai perdu mon grand amour, mon suicide a échoué, je déteste ce monde. Je déteste exister, oui, exister, je déteste ça. J'abhorre. Vous voyez là, là, je ne suis pas bien. La nausée. Elle ne me quitte jamais. Il baisse son regard noir. Son charisme vibre. Ses longues jambes maigres se rassemblent avec grâce. Yseult reste suspendue. Enfermée dans quelques rapports relationnels maladifs. Elle veut le guérir, l'aimer, l'envelopper. Elle veut être son écho et son aimée. Elle veut tout lui prouver ; son intelligence, sa lucidité, son exception, son antinomie avec le monde, sa réflexivité, son originalité. Au-delà de tout ça même, elle est tellement plus ! Mais elle se sent réduite au silence, comme redevenue une petite fille ignorante et désinvolte. Elle est en colère et fascinée par la rencontre. Elle prend conscience. Elle sait tout, ironique. Et pourtant elle reste. Par mésamour pour elle-même. Elle lui jette son âme et propose à celle-ci, qu'elle croit plus puissante, de jouer. Elle est vidée, son regard ne tient plus, ses idées se cumulent mais ne percutent pas. Elle sait, elle sait qu'elle ne peut être là, elle n'existe pas ici et n'existera jamais. Elle joue avec son indifférence – à mon image. Elle le défit silencieusement de la briser, s'il en est capable. Affrontements et destructions. Est-elle capable d'autre chose ma petite création ? Mise en abime de ma jetée de mots et de maux – peut-être.
Natanael se lève, il chantonne, heureux.
– Je crois que vous me rendez heureux. Venez danser avec moi. Il n'y a pas de musique, nous allons la créer ! Elle se lève, triste. Elle s'unit à son mètre quatre-vingt-six. Il est doux mais lointain, son contact est étrange. Comme un vent amoureux, une rafale émue, un rien tenace, un bloc de glace brûlée. Elle laisse retomber son visage sur son épaule, elle boit son souffle. Un délice, un poison.
– J'aimerais ne plus te quitter, être avec toi. Tout le temps. Je t'aime, tendre et chère inconnue.
– Je m'appelle Yseult. Je ne peux te croire.
– Tu as peur. Laisse-toi aller, tombe, je te rattraperai. Il la regarde, fouille le bleu de son oeil. Il s'éloigne soudainement. Retrouve la fenêtre. Et murmure : je suis un être très froid, mes élans d'amour son extrêmement rares, mais intenses, le supporteras-tu ? Il est exponentiellement beau. Yseult hallucine.
– Je suis plus froide que toi ! Elle ricane. Je suis l'être le plus terrible que l'Histoire connaîtra. Tu es encore informé, moi, je suis en puissance. Tu es en acte, je suis en indétermination. Je te dévorerai. Elle ricane encore.
– J'ai pourtant obtenu de toi tout ce que je désirais. On ne me refuse rien. Il sourit en allumant sa cigarette. Il la regarde, désinvolte et fatigué. Mes migraines m'harcèlent. Mon presque amour, laissez-moi un peu de solitude, attendez-moi au Fiam, je vous y retrouverai, j'en brûle déjà.
Elle part hésitante, en colère. Il ajoute, alors qu'elle s'apprête à passer la porte, « venez ! allez, venez, un instant » elle revient doucement, impatiente. Il lui prend la main, la baise et murmure « je m'appelle Natanael. À ce soir, Yseult. » Son sourire est celui d'un roi généreux. Yseult part. Aveuglée par le soleil en sortant, elle se secoue de vertiges. Elle n'est plus là. Elle gagne la passerelle Cior. Elle a envie d'hurler, de tuer, de fendre. Son corps tremble. Son sac mit sur son dos, elle court. Elle sent ses muscles se tendre. Le ciel est limpide. Elle a envie de pleurer et de briser sa faiblesse. « Vas-tu oser y aller ? » Elle court sur la passerelle déserte. Sa robe vole un peu, son corps bat, pulse. Athanason. Et après ? Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Elle ne sait plus. Les contours se troublent, elle ne discerne que mouvements et incohérence. Elle s'arrête. Elle se sent ridicule. Réduite à sa souffrance. Vulnérable et mordue. Envoutée par le vampire qui ne rêve que de sucer son sang pour exister. Exister, complètement, hégémoniquement, fatalement. Voilà ce qu'intéresse Natanael. Elle fait demi-tour. Entre dans un magasin, trouve une robe. Elle se fait maquiller. Donne presque l'intégralité de son argent et ressort. Il fait nuit, et elle est presque nue, en elle. Elle entre au Fiam. Il n'est pas encore là. Elle attend. Une heure plus tard elle tremble devant son café. Elle se perd dans les yeux glauques de la femme libre, assise en face, à quelques tablées, seule, la cigarette à la main. Elle écarquille les yeux, prise d'une colère noire. Elle s'indigne d'elle-même. Son dégoût la transperce, elle tremble d'ignominie. Elle tremble si fort que les contours se brisent. Elle est à Exaiphnès. Adôn, Athanason. Il est là, jeté dans le spleen sans rebours. Elle prend conscience, elle est là, juste là. Elle n'est jamais partie. Jamais. Elle n'a jamais cessé d'inventer, elle a tout inventé. Anormale petite sainte. Athanason, mort, dans ses bras. La nuit est à sa fin, elle est belle, tellement belle. Et pendant qu'elle partait, dans le visage de sa vie, par l'esprit, il avait quitté le sien, sans pathos. Il était mort, pendant qu'elle avait rêvé.
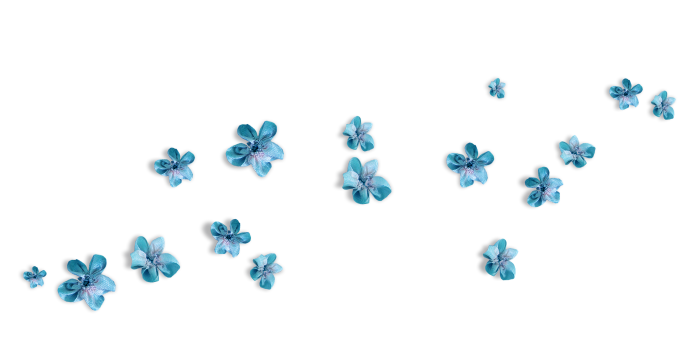
JALO1996
La Combinaison
L’homme — appelons-le Goran-Dorović pour simplifier — est revêtu d’une combinaison orange et pousse un petit chariot devant lui. Il se dirige vers la sortie des ascenseurs qui mène aux parkings. Il a la démarche pesante et calme de ceux qui ne craignent pas grand-chose. Il regarde devant lui, ou peut-être qu’il ne regarde rien. Il s’occupe de l’entretien du bâtiment, nettoie les sols, vide les corbeilles à papier, recharge les distributeurs de boisson. Cependant, personne ne l’a jamais regardé. Personne ne saurait le décrire, même imparfaitement. Personne ne sait vraiment s’il est un homme ou s’il est une femme.
Arrivé devant l’entrée des parkings il met son seau par terre et entreprend de mouiller le balai à franges qui lui sert à lessiver les sols. Il porte de gros gants de caoutchouc jaunes, pour se protéger d’éventuelles éclaboussures du détergent qu’il utilise. Il s’occupe toujours de cette partie vers 19h, ou un peu avant, parce que c’est à cette heure-là qu’elle arrive. Toujours.
J’ai frappé à la porte de son bureau, trois coups, mais personne n’a répondu. J’ai attendu un moment et puis j’ai recommencé. Je pouvais voir qu’elle était là, au travers du verre fumé. À cet étage, toutes les portes sont en verre fumé. C’est l’étage de la Direction.
« Entrez ! » a-t-elle crié d’une voix excédée.
C’est ce que j’ai fait. Elle était au téléphone, avec New-York ou Los Angeles, au son de sa voix. Cela n’avait pas l’air de bien se passer. J’ai refermé doucement la porte derrière moi et me suis avancé vers son bureau. J’y ai déposé ce qu’elle m’avait demandé. Je suis resté debout devant elle sans savoir quelle contenance adopter. Je n’osais pas lui adresser la parole parce qu’elle était au téléphone. J’ai regardé les eaux-fortes qui étaient accrochées au-dessus de sa tête, des gravures sélectionnées par un décorateur. C’est à ce genre de détails qu’on reconnaît un bureau de Manager. Le nôtre, plus bas dans le bâtiment, est encombré d’objets promotionnels et d’affiches publicitaires. Mon regard est finalement redescendu vers le plan marketing que je lui avais apporté. Bien à plat devant elle, il était. J’ai pensé que d’une certaine manière nous étions tous bien à plat devant elle. Pas seulement le plan marketing.
J’ai vérifié encore une fois, même s’il était trop tard, que le titre du rapport était bien centré, le nom des auteurs encadré, en haut, à droite, avec un numéro de version pour qu’on puisse amender le document des remarques qu’elle ne manquerait pas de faire. Il s’agissait du lancement d’un de nos produits de seconde catégorie. Elle s’est penchée vers le rapport, l’a ouvert d’une seule main, en a parcouru distraitement la première page tout en hurlant au téléphone. Elle hurlait très bien. En anglais.
« We’ve discussed the subject a hundred times! Won’t you listen to me, for once?1»
Elle a mis deux doigts sur le micro du téléphone et s’est adressée à moi: « Vous me faites un petit café, bien serré? ». Elle a repris ses vociférations anglosaxophones.
Il y a une petite kitchenette à côté de son bureau. Enfin, ce n’est pas une cuisine, c’est plutôt une sorte de réduit. Nous y sommes tous passés au moins une fois. Pour lui faire son café. C’est sa vision de l’égalité des sexes, je suppose. Pendant des décennies les secrétaires ont fait le café du patron. Alors, même si vous sortez d’une grande école de commerce elle vous enverra lui préparer son café. Petit. Mais serré. Je crois que cela l’amuse. Pour tout vous dire, cela m’amusait aussi, au début. Maintenant cela m’amuse de moins en moins.
1) On en a parlé une centaine de fois ! Vous allez m’écouter pour une fois ?
J’ai trouvé le café, déjà moulu, dans le petit placard du fond. J’en ai empli la petite coupelle qu’on place dans la machine hors de prix qu’elle a tenu à acheter parce qu’elle n’aime le café que luxueux. J’ai poussé le bouton. J’ai attendu. Je n’écoutais pas les bruits étranges que faisait la vapeur qui passait au travers de la mouture. J’écoutais le son de sa voix dans la pièce à côté.
J’ai posé la petite tasse sur sa soucoupe et j’ai jeté un coup d’œil par la porte. Elle était toujours assise à son bureau mais elle ne disait plus rien. Elle écoutait ce que disait son interlocuteur. À l’expression de son visage je voyais bien que ce qu’elle entendait ne lui plaisait pas. Je suis entré tranquillement et ai déposé la tasse de café devant elle. J’ai pensé à tourner un peu la soucoupe pour qu’elle puisse saisir la cuiller facilement.
L’homme à la combinaison orange s’arrête de frotter le sol, il a entendu quelque chose. Pas de doute, un des ascenseurs de la colonne descend jusqu’au troisième sous-sol. C’est elle, il en est sûr. Il relève la tête. Il regarde la porte de l’ascenseur.
Une petite note musicale retentit et la porte s’ouvre. Elle est vêtue d’un petit tailleur chic, la jupe juste au-dessus du genou. Un tissu moelleux, c’est ce qu’il se dit, il ne connaît pas le mot tweed. Elle le regarde et baisse les yeux aussitôt. Ses yeux sont à la même hauteur, exactement à la même hauteur que les siens. C’est à cause des hauts talons. Elle n’est pas à son aise. Elle passe devant lui. Elle est obligée de faire un petit écart parce qu’il ne bouge pas. Il ne s’écarte pas pour lui laisser le passage. Il se contente de se tourner lentement alors qu’elle passe à sa hauteur, pour continuer de l’admirer, tout à loisir, en faisant même un drôle de bruit avec ses lèvres. Il n’a pas pu s’en empêcher. Il la suit des yeux jusqu’au moment où la porte d’entrée des parkings se referme sur ses jambes satinées. Il en est certain, sa démarche a quelque chose d’aguicheur. Oui, sa démarche, sa façon de se dandiner pour faire valoir les moirages du tissu de sa jupe étroite. Ce n’est pas la première fois qu’il le remarque. Il connaît ce genre de femmes. Il sait qu’il parviendra à ses fins, un jour ou l’autre, ici ou ailleurs, de jour comme de nuit. Parce que la vie est ainsi faite.
Il hoche un peu la tête et écoute le bruit qui s’éloigne. Le bruit de ses talons sur le béton du parking. Le bruit s’arrête. Il sait que ce qui va suivre est le claquement d’une portière. La portière de sa voiture, lorsqu’elle y sera entrée. Il attend. Il relève la tête. Le bruit ne vient pas.
Au comble de l’exaspération elle a frappé le sol du pied. Cet idiot d’Américain essayait de se trouver des excuses. Je n’aurais pas aimé être à sa place. Elle allait se le farcir et il allait le sentir passer.
Ils ont encore eu quelques échanges qui devenaient de plus en plus houleux. Il aurait dû battre en retraite, il ne l’a pas fait. Peut-être qu’il ne la connaissait pas aussi bien que je la connaissais. Il avait pris la mauvaise option. Le ton de sa voix avait changé. Elle parlait plus doucement maintenant. Elle parlait pour faire mal.
Elle s’est saisie de la tasse de café délicatement et l’a portée à ses lèvres. Elle a levé les yeux vers le plafond, tout en les fermant légèrement. Elle a avalé une petite gorgée de café et puis elle l’a assassiné.
« Damn it! I’ll get rid of you. As from today, you’re not working for this company anymore, am I clear?2» Elle a répété « Am I clear? » en détachant chacun des mots comme si elle parlait à un enfant ou à un demeuré. Ensuite, elle s’est remise à crier. Elle s’est levée. Elle m’a tourné le dos.
2) Nom de Dieu! Je vais me débarrasser de vous. À partir d’aujourd’hui, vous ne travaillez plus pour cette entreprise, est-ce clair ?
Elle a interrompu la communication téléphonique d’un pouce rageur et a balancé le combiné gris anthracite sur le bureau. J’ai vu le petit appareil valdinguer contre le rapport pendant que son avant-bras, l’autre, se dépliait d’un coup sec. Son poignet s’est déroulé avec la grâce rapide de l’éclair. La tasse de café est allée s’écraser contre le mur.
« Jamais de sucre dans mon café ! Ce n’est pourtant pas difficile à comprendre, ça, non ? Même du café ? Vous ne savez même pas faire un simple café ? »
Elle s’est retournée vers moi, son visage n’était qu’à quelques centimètres du mien. Je pouvais voir la fureur dans son regard. Je suis allé chercher un rouleau de papier absorbant dans la cuisine qui n’en était pas une et j’ai commencé à nettoyer la tache sur le mur. C’était difficile à retirer. J’avais pensé prendre un verre d’eau pour humecter un peu avant de frotter. La tenture murale en tissu, très chère sans doute, était endommagée. On n’y pouvait pas grand-chose, je crois.
L’homme que l’on appelle Goran Dorović pousse la porte et entre à son tour dans le parking. Il ne la voit pas mais il entend le claquement de ses talons contre le sol, qui a repris, un peu moins régulier qu’avant peut-être. Il se dirige d’instinct vers ce bruit-là. Ils vont être tranquilles tous les deux pendant un bon moment. La minuterie de la cage d’ascenseur vient de s’éteindre, et il entendra à l’avance s’ouvrir la porte automatique de l’entrée des voitures, si quelqu’un arrive. Mais pour l’instant ils sont seuls au monde, elle et lui, dans ce terrain de jeu magnifique qu’est un parking souterrain.
Cela lui rappelle les biches aux grands yeux doux qu’il coursait pendant la guerre. Il se souvient de celle de Lukomir. Non, il se trompe. Ce n’était pas Lukomir, c’était un peu plus loin, sur la route de Sarajevo. À Krupar. Il l’avait débusquée au fond d’une chapelle orthodoxe, complètement terrorisée. Elle avait mouillé ses sous-vêtements. Cela l’avait amusé. Il l’avait allongée sur l’autel. Il avait pris son temps. Elle n’avait pas crié mais elle pleurait sans arrêt. Il l’avait gardée quelques jours. Ensuite il l’avait donnée à ses hommes.
Elle se met à courir, maladroite. Elle entend qu’on la suit. Cela ne peut être que cet ouvrier d’entretien à la combinaison orange. Il a un visage hideux, grossier. Il y a quelque chose dans ses yeux qui est sale et qui lui fait peur. Il ne ressemble pas aux hommes qu’elle connaît. Ces hommes qui la regardent à la dérobée, furtivement, et qui essaient de donner le change. Non, celui-là est d’une espèce différente. Il n’y a aucune honte dans les regards qu’il lui lance tous les soirs. Il a le sourire entendu de celui qui va prendre ce qui lui est dû, qui est persuadé que sa proie est totalement consentante. « Juste quelques faux airs qu’elle se donne pour sauvegarder les apparences », c’est ce qu’il se dit. Cela se voit à son air. Aucune hésitation dans ce qu’il fait. C’est un monstre parfait.
Il faut qu’elle retrouve sa voiture au plus vite. C’est une question de survie. Elle pourrait s’y enfermer et tenter de quitter le parking. Elle ne la trouve plus. Elle pense pourtant l’avoir garée près de l’extincteur, comme d’habitude. Mais voyons, ce matin, oui, ce matin quelqu’un avait déjà pris cette place et elle avait dû… Il ne lui reste pas suffisamment de temps. Elle ne peut plus faire demi-tour. Il y a cette porte, qui donne sur un petit réduit.
Elle est entrée. Des produits d’entretien. Vite, fermer la porte, actionner le petit verrou. Elle s’appuie de l’autre côté et expire à fond. Il faut qu’elle réfléchisse à ce qu’elle va faire maintenant. Son téléphone portable, bien sûr ! Une onde de bonheur la traverse, elle est sauvée.
Elle le sort de son sac et le tient dressé devant elle, comme un totem aux pouvoirs insoupçonnés. Elle le promène dans toute la petite pièce en le regardant d’un air anxieux. Son visage bleuté s’affaisse d’un coup. Pas de réseau. Elle en a les larmes aux yeux.
Elle entend le premier coup d’épaule de l’homme contre la porte. Elle comprend tout de suite que le verrou ne tiendra pas. Au deuxième coup il commence à se tordre sous la violence du choc. Elle a envie de crier mais le cri reste bloqué dans sa gorge. La lumière s’éteint, elle la rallume d’un doigt maladroit. Elle doit s’y reprendre à plusieurs fois. Dans le noir ça serait plus terrible encore.
Elle m’a regardé d’un air agacé, a fait le tour de son bureau et s’est approchée. M’a montré du doigt la tache de café sur le sol et les débris de la tasse. N’a pas dit un mot. Elle ne pensait tout de même pas que j’allais m’agenouiller devant elle ?
J’ai étalé deux épaisseurs supplémentaires de papier absorbant sur le sol, pour pouvoir récupérer les morceaux un par un. J’en ai fait un petit paquet que j’ai mis de côté. Puis j’ai épongé la petite mare de café au bas du mur. Elle restait debout à côté de moi et je me disais que si quelqu’un passait dans le couloir à ce moment précis il ne manquerait pas de m’apercevoir dans cette posture consternante.
J’ai regardé furtivement ses escarpins. Je me suis dit que leur talon était un peu trop haut. Des chaussures qui ne conviennent pas à une directrice du marketing.
« Bon, ça ne m’amuse plus, ce truc, a-t-elle dit.
— Mais qu’est-ce qui te prend ?
— Tu m’avais promis, tu sais, quand tu fais ta brute épaisse ? »
Je voyais très bien ce à quoi elle faisait allusion. Cela fait des années que nous jouons à ce jeu-là. Parce qu’autant vous le dire, ma supérieure hiérarchique est aussi mon épouse. C’est la raison pour laquelle nous pimentons notre vie professionnelle de petites performances qui ne sont pas d’usage dans les multinationales. Enfin, je crois.
Goran Đorović. C’est ainsi que je l’appelle. Je me déguise. J’enfile ma combinaison de chantier et mes bottes de pêche. « Cet après-midi cela va être difficile, j’ai dit. J’ai une réunion avec notre chef des ventes. Il vient de Londres spécialement pour me voir. Il va falloir que tu patientes un peu. » D’un seul coup le rapport de force avait basculé. Je me suis relevé et je l’ai regardée. Dans les yeux, froidement. « Disons que… ce soir, oui. Ce soir, après 19h. À partir de cette heure-là, je te déconseille vivement de descendre dans le garage sans être accompagnée. » J’ai vu une ombre passer dans son regard. Elle y était déjà.
La porte vole en éclat. Le verrou n’a pas tenu longtemps. Hier déjà il a sauté au deuxième ou au troisième assaut de son imbécile d’époux. Ce n’est plus vraiment son époux. C’est maintenant un monstre horrible engoncé dans une combinaison orange et sale. Ces gants de caoutchouc jaunes dégoutants vont lui arracher son tailleur. Elle va se fait brutaliser, humilier, rejeter sans vergogne contre les briques puantes de salpêtre. Et il prendra son dû, comme un vainqueur terrible, ou plutôt comme un collaborateur méprisé. Elle va payer le prix de ses moqueries continuelles, de ces petites humiliations qu’elle lui a fait subir tout au long de la semaine. Il vient prendre sa revanche dans ce réduit immonde. Elle a lentement fait monter la pression, lui confiant les tâches les plus dégradantes, le critiquant ouvertement devant ses collègues, se moquant de lui comme elle sait si bien le faire. Le tournant en dérision. Ce pauvre époux piétiné. Ce malheureux collaborateur martyrisé.
Elle ne sait pas pourquoi, mais c’est ce qu’elle aime par-dessus tout. Cet instant où tout bascule et où c’est elle qui devient chose et lui qui devient roi. Hier déjà c’était délicieux, même si cela n’a pas duré assez longtemps. Aujourd’hui, elle le sait, cela va être meilleur encore.
Parce qu’aujourd’hui ce n’est pas son mari dans la combinaison orange
MIE 7691
À contretemps
Christophe rentre tard ce soir. C’est vrai, un rayon de soleil mourant essaie encore de pénétrer l’obscurité mauve qui inonde le ciel à l’est, mais c’est peine perdue.
Comme d’habitude, il parque la voiture juste devant le garage, risquant de griffer le côté gauche contre un poteau pour éviter un obstacle à droite. « Foutue boîte aux lettres ! Ils auraient pu la mettre en plein milieu de l’allée, tant qu’à faire », pense-t-il.
Il cherche les clés de la maison dans sa poche. Il les a déjà tâtées quarante fois aujourd’hui, juste pour être sûr qu’elles sont toujours là, qu’elles ne sont pas tombées ou allées faire un tour sans lui demander la permission. On ne sait jamais...
Une grosse goutte de sueur lui parcourt le nez au moment où il se rend compte qu’au fond de la poche gauche s’est ouvert un trou. Et maintenant ? Que faire si les clés se sont échappées par là ?
L’instinct de survie lui dicte d’examiner aussi la poche droite de l’autre main. Miracle, elles sont là ! Mais non, bêta, elles n’ont jamais changé de poche. Elles ont passé toute la journée à leur emplacement habituel, où tu les as tâtées quarante et une fois déjà.
Un soupir s’échappe de sa bouche entrouverte, pendant que la boule Ikea s’illumine au premier étage. Il sent ses aisselles devenir humides. Allez, hop, la deuxième douche de la journée se profile à l’horizon. Si seulement...
Le craquement des joints de sa vieille – très vieille – Golf III le fait tressaillir. Quelle voiture naze ! Il se promet pour l’énième fois de la remplacer dès qu’il aura assez d’argent. Une Audi TT Cabrio, voilà son rêve interdit. Mais en attendant le Lotto il faudra se contenter d’une bonne petite Kia.
Il est déjà sur le pas de la porte quand il se souvient des Pampers dans le coffre. Maintenant il est carrément en nage, la transpiration ruisselle sauvagement le long de son dos comme après un jogging de 15 kilomètres. « Comment s’appelle-t-il encore le déodorant magique dont m’a parlé la caissière de chez Di ? ». Dommage, il ne se rappelle plus, il n’avait d’yeux que pour cette fille, une fausse blonde à la poitrine plantureuse et à l’air gentil.
Cela devient difficile de gérer les clés et la serviette de la main droite, la boîte de Pampers giga de la gauche, mais avec une maîtrise dont il se félicite il réussit à arriver jusqu’au tapis qui lui dit « Hello ! » depuis le pas de la porte sans laisser tomber le trousseau.
Au moment où le déclic de la poignée se fait entendre, un cri de bébé (atterré, affamé ou torturé, c’est selon) l’accueille. En dépit de l’habitude, il ne peut s’empêcher de frissonner.
« Te voici, enfin. De quelle maîtresse s’agissait-il encore ce soir ? ». Un sourire mauvais complète les salutations de Mireille, sa compagne, en train de balancer avant et arrière le petit Jérémy comme s’il s’agissait d’un haltère.
Calme-toi, mon vieux. N’oublie pas qu’elle est toujours sous le choc de la découverte de son frère aîné toutes veines ouvertes dans la baignoire, 35 ans plus tôt. À tel point qu’elle a banni les couteaux de la maison (dommage que personne n’ait jamais osé lui dire que son frère s’était servi d’un rasoir) ; ce qui les empêche à jamais d’avoir un repas de consistance supérieure aux boulettes. Au moins elle ne tuera point bébé à l’arme blanche, ça rassure. Donc il répond, de son air le plus naturel : « Ma chérie, tu sais bien que je ne peux pas te donner tous les détails du cas ING ».
« Toujours à mentir comme tu respires ! Tu n’as même pas la pudeur de te taire devant ce pauvre innocent ».
Le pauvre innocent le regarde, l’air courroucé, se tait une seconde et recommence à crier de plus belle.
Encore un soupir – cela fait deux en moins d’un quart d’heure, très mauvais signe – et Christophe décide de la jouer stoïque. Il dépose la serviette sur la table, va mettre le pack de Pampers dans le cagibi à côté des toilettes et pend le veston au pommeau de l’escalier. Au moment même où il achève le geste, il sait qu’il a commis une erreur.
« Et ne viens pas me réclamer du repassage ! À partir de maintenant tu le feras tout seul comme un grand ». Défilent alors tristement dans sa tête les visages des femmes de ménage polonaises que Mireille a chassées de la maison pour des raisons variées, mais qui terminaient toutes par : « Et puis je ne veux pas chez moi des blondasses que tu finirais par sauter ». Prenons le bon côté des choses : au moins il ne doit plus payer pour ça.
Il passe rapidement aux toilettes, où il a caché des comprimés de Xanax dans le vase de fausses orchidées mauve tigré, cadeau de sa belle-mère bien-aimée, et il en avale deux. Juste pour être on the safe side. Même le stoïcisme a parfois besoin d’un coup de pouce.
Christophe sort des toilettes comme un homme nouveau, inébranlable dans sa sagesse : il propose à Mireille de prendre le gosse dans ses bras – sans succès – et se dirige vers le frigo d’un pas sûr. Pendant qu’il constate l’absence totale de plats préparés, ou même de restes, Mireille lui lance d’un ton sarcastique : « Le voilà le grand égoïste, il ne pense qu’à sa bouffe, alors que son fils se tord de douleur et sa femme l’attend depuis des heures ».
« Amoureusement » ajoute mécaniquement son sens de l’humour, qui n’a toujours pas intégré combien il est déplacé entre les quatre murs de sa maison.
Pendant qu’il sort six fish sticks de la boîte bleue et jaune (il déteste la sensation du carton qui se ramollit entre ses doigts), le pas de Mireille s’éloigne dans son dos. Ses doigts semblent danser alors qu’ils lancent adroitement les bâtonnets dans l’huile pétillante, ses lèvres commencent à fredonner le refrain de Mon HLM et sa nuque se redresse. Savourons les instants de bonheur que Renaud nous réserve !
Quand enfin il se tourne pour déposer l’assiette sur la table, il remarque une enveloppe dressée en équilibre contre la carafe. Soupçonneux, il scrute l’objet inattendu, éprouvant le même genre de sentiments que le joueur dont le pion tombe sur la case « chance » du Monopoly.
Il fait un rapide calcul de probabilités quant à la teneur du contenu et sagement décide de terminer son dîner avant d’ouvrir l’enveloppe.
Entre temps les cris du petit ont cessé, et la maison se trouve plongée pour un instant dans un silence impayable. Christophe est sur le point d’imiter Faust et arrêter le temps au prix de son âme quand un cliquetis de hauts talons (quelle idée de se promener tout le temps sur ses échasses ! Après tout, elle doit bien faire un mètre soixante) lui ravit l’occasion du siècle. Prochaine fois il faudra se dépêcher, mon gars !
« Pas pressé d’ouvrir, hein ? » lui lance Mireille, en le toisant d’un regard narquois et chevauchant une chaise à l’envers. Dire qu’elle te faisait bander il y a deux ans quand elle découvrait ainsi la dentelle noire de sa culotte et te donnait envie de l’explorer par tous les moyens...
Elle semble lui lire dans la pensée parce qu’elle rajoute : « Et tu peux foutre où je pense ton regard de gros cochon, tu ne m’auras plus comme dans le temps, pauvre sotte que j’étais ». À vrai dire, ça fait depuis la découverte de sa grossesse qu’il ne l’a plus eue du tout. Mais est-ce vraiment une perte ?
Le problème de Christophe est qu’il est sensible aux obligations morales. Il nettoie donc sa fourchette dans le bout de papier absorbant qui a jusque-là fait office de serviette et ouvre l’enveloppe le plus proprement qu’il peut avec le manche – il sait combien Mireille tient à ces détails-là. N’empêche que ce serait plus simple avec un couteau.
L’enveloppe déchiquetée révèle la blancheur d’une feuille qui a été pliée exprès pour cacher son contenu dans la face intérieure. Il la sort et la déplie, comme hypnotisé par le regard de sa compagne qui lui dicte chaque mouvement.
Et puis non, il décide qu’il ne lira pas.
Il replie soigneusement la feuille et la remet dans l’enveloppe. La femme fait un geste brusque de la main comme pour chasser la surprise et observe : « Tu devras bien la lire. Surtout que tu ne peux plus rester ici ».
Il porte le verre à ses lèvres comme si elle n’avait pas parlé et se lève pour débarrasser la table. Il joue le type zen, mais cette enveloppe risque de lui pourrir le reste de la soirée. Heureusement, un motif envoûtant vient le distraire : il s’agit de la chanson Satan your kingdom must come down, qui accompagne le générique de la série américaine Boss. Christophe en est fan, alors que Mireille ne la supporte pas. Un abyme de plus à combler entre eux, dirait son psy.
L’urgence d’aller absorber le dernier épisode de la série annule toute autre priorité. « Je vais regarder la télé » annonce-t-il d’une voix ferme. En même temps, l’assiette lui glisse des mains et va se briser en mille morceaux.
« Tu fais de la provoc’ maintenant ? Toujours rien pigé, pauvre con ! », siffle la femme entre les dents, ses poings sur les hanches. Cette posture la fait ressembler à un vase grec à anses, ne peut-il s’empêcher de penser pendant une fraction de seconde. « De toute façon, que tu la lises ou non, mon avocat t’aura jusqu’à l’os ! ».
Christophe garde son calme olympien et sort de la cuisine d’un pas hiératique. Personne ne s’interposera entre lui et sa série fétiche, c’est décidé. Mireille, d’abord étonnée par son manque de réaction, passe à l’invective. Comme il ne se retourne pas, elle se précipite sur lui et agrippe fermement son épaule toutes griffes dehors.
Dommage. Il va sans doute rater le début de l’épisode. Ce constat exaspérant redouble sa force au moment où il la repousse pour fermer la porte du salon à clé derrière lui.
Pas étonnant qu’elle tombe avec fracas au sol.
Cela lui rappelle un épisode similaire, cinq ans auparavant. Il s’était retrouvé dans la même posture peu glorieuse que Mireille à l’instant. Il se souvient avec un mélange de gêne et d’excitation que sa conquête de l’époque (qui vivait sporadiquement avec son mari et couchait passionnément avec lui à chaque fois que possible), au cours de l’une de leurs querelles musclées l’avait renversé par terre et chevauché fermement, tout en le frappant. Dans les films à succès une scène pareille se terminerait au lit, dans leur cas il aurait fini à l’hôpital si par pure chance il n’avait pas réussi à se dégager et à appeler la police.
Notons au passage que Christophe est un gentilhomme, un vrai de vrai, qui ne pourrait jamais frapper une gente dame sous peine de se sentir indigne d’appartenir au genre masculin. Sa philogynie est d’ailleurs la seule excuse qui justifie son homophobie latente, étant donné que l’insulte la plus grave à ses oreilles serait que quelqu’un s’étonne de son attirance extrême pour toute représentante du sexe faible.
Mireille, qui a eu du mal à se relever, commence à crier des obscénités sans nom, qui ont vite fait de réveiller le bébé – espérons que Jérémy ne soit pas trop précoce, ou ses premières phrases pourraient faire fuir le voisinage –, mais elle n’ose pas frapper des poings sur la porte du salon de peur de briser les carreaux vitrés. Les maisons anciennes présentent parfois des avantages insoupçonnés.
Malgré ce bruit de fond peu attirant, Christophe réussit à terminer son épisode en ayant à peu près compris les sursauts shakespeariens de l’intrigue. Ah, la tragédie ! Grecque ou élisabéthaine, c’est ce que l’esprit humain a produit de meilleur, il n’y a pas l’ombre d’un doute.
Quand l’écran se fait noir, il réalise que les cris tant de la mère que du fils se sont taris. Poussé par son sens du devoir, il retourne dans la cuisine ramasser les débris de l’assiette – en oubliant d’éteindre la télé. L’enveloppe sur la table s’efforce d’attirer son regard, mais il a décidé de continuer à l’ignorer.
Il se demande comment rendre son pas inaudible pour se coucher sans déranger personne; il se déchausse à l’entrée et faillit glisser sur la surface lisse des marches en bois, mais il atteint sain et sauf le sommet de l’escalier. Après une courte hésitation, il tourne prudemment la poignée de la chambre à coucher et se sent imbécile.
La porte est bien évidemment fermée à clé.
Même si personne ne peut le voir, il cache l’expression de soulagement de son visage dans les deux mains et file vers la chambre d’amis. Elle n’est pas très accueillante, c’est vrai ; le matelas est posé à même le sol faute de sommier – depuis des mois Mireille trouve des excuses pour ne pas en acheter de peur d’être ainsi obligée à héberger sa mère à lui, qui souffre du dos et ne peut pas se courber jusqu’à terre –, et il ne pourra pas récupérer les draps, enfermés comme l’enfant dans leur chambre. Mais la douche est accessible, et il sait où trouver des couvertures.
Du coup, il se sent heureux.
L’eau qui ruisselle sur sa peau lui renvoie les images des chutes du Niagara et de Superman qui vole au-devant pour récupérer Lois Lane. Quand arrêtera-t-il de jouer au grand romantique et d’attendre sa dulcinée? En même temps, un sentiment de fierté remonte tout le long de son corps, enfin propre. Ses ratages en amour ont été multiples, mais qu’à cela ne tienne : si elle existe quelque part, sa princesse, il la trouvera, parole de Christophe !
Somme toute assez content de lui, il se prépare un lit de fortune et se faufile tout nu entre le matelas et le drap qu’il a fini par dénicher au fond du placard. Quelle joie de sentir sur la peau le grain fin et froid du coton plutôt que les poils effilochés du vieux plaid à carreaux rouges et blancs, cadeau du Delhaize ! Il s’étire béat, se préparant à sombrer dans le sommeil du juste.
Tic-tac, tic-tac. Il avait oublié l’affreuse horloge blanche et noire, récupérée chez la mère de sa compagne, qui n’arrête pas de jacasser. Il se lève et la décroche, l’examine d’un air studieux et décide de l’amener en bas, où elle croupira dans son impuissance.
Au moment où il dépose l’objet haï sur la table, l’enveloppe lui fait coucou. Christophe ne semble pas enregistrer sa présence, monte à nouveau les escaliers et se recouche.
Zut ! Toujours pas moyen de dormir. Cette fois-ci, il ne peut même pas pester contre le thé du soir !
Et si c’était autre chose ? Il se tourne et se retourne, comme une brochette sur un barbecue.
Il sort à nouveau du lit, descend à la cuisine, prend l’enveloppe, l’observe et la retourne entre les mains. Il faudra bien qu’il la lise à un certain moment… Mais un sursaut d’orgueil lui dit que non, qu’il n’est pas obligé. D’ailleurs il sait bien ce que ça signifie, pas vrai ? Du coup il la déchire minutieusement et jette les morceaux à la poubelle. Il a une pensée pour le compost, mais se dit que pour une fois l’environnement lui pardonnera de mélanger les traces de ses déboires ménagers avec les ordures non recyclables.
Pour la troisième fois il entreprend de se mettre au lit.
Le regard d’empathie que lui a réservé la caissière de chez Di quelques heures plus tôt lui revient à l’esprit et l’échauffe doucement : au fond, il a juste besoin d’une femme compréhensive. Fini avec les intellectuelles à problèmes, exit les névrosées aux noms à particule, assez des donzelles exotiques à sauver de l’OQT[1] : du blanc-bleu belge de nos champs, simple et savoureux, voilà ce qu’il lui faut !
Le souvenir du décolleté généreux qui s’était présenté à lui au moment de son passage à la caisse envahit ses yeux fermés et le dépose agréablement dans les bras de Morphée.
Les cris du bébé, plus désespérés que jamais, résonnent à nouveau dans la maison.
[1] “Ordre de quitter le territoire”: document administratif qui signifie l’expulsion à un étranger non autorisé à séjourner en Belgique.

PAPI2004
« Ce titre est beaucoup trop long »
« Je t'assure que je suis incapable d'écrire un roman d'amour ! »
Cassandre n'en croyait pas ses yeux, ses oreilles, et tout ce qu'elle avait de capable d'entendre ou de voir : Hugo Victoire, son meilleur ami, le jeune auteur talentueux qui avait écrit pas moins de trois romans policiers à succès, qui avait même obtenu le prix Femina pour l'un d'eux, lui, Hugo, serait donc incapable d'écrire un roman d'amour... Non, elle ne pouvait l'admettre.
« Mais enfin !, gronda-t-elle. Il y en a qui peuvent t'en pondre deux par mois, des bouquins comme ça ! C'est bien connu que les soupes à l'eau de rose sont les plus faciles à cuisiner. »
« Je t'assure que n'est pas si simple en réalité. »
« Bon allez, chiche ! Toi et moi, on en écrit un, là, tout de suite ! »
« Là ? Ici, tu veux dire ? »
Ici, c'était à la terrasse d'une brasserie arrageoise.
Et là, c'était vers 19H30 un soir de semaine.
Quand elle avait une idée en tête, Cassandre en démordait rarement. Et de toute évidence, elle
avait, ici et là, plus d'une idée derrière la tête.
« Il paraît que les meilleures histoires s'écrivent en un seul jet, dit-elle confiante. »
« T'as vu ça où ?, fit Hugo moins confiant. »
« Dans un docu sur Sia. »
« Sia, la chanteuse ? »
« Oui, ils expliquaient dans le reportage qu'elle avait écrit la chanson Diamonds pour Rihanna en 14 minutes. »
« En même temps, c'est Sia !, balança Hugo plutôt dubitatif. »
« Quoi ?! Moi, j'adore. Non, franchement, comment on peut ne pas aimer Sia ?! »
« Euh, si t'aimes bien, alors j'aime bien aussi, se ravisa Hugo avec une maladresse touchante. »
« Quel homme de conviction !, soupira la jeune Cassandre. Ça fait à moitié peur... »
« En même temps, poursuivit son ami, c'est quand même étrange ton histoire. T'as déjà entendu parler de quelqu'un qui se chronomètre quand il écrit une chanson ? M'est avis que c'est encore pipeauté tout ça ! »
« N'empêche, quand tu vois combien elle a vendu d'albums... 14 minutes entre les mains de Sia, ça peut te rapporter gros. Moi, si je taffe un quart d'heure, je ne suis pas sûre de pouvoir me payer un menu Big mac ! »
Et sans transition, Cassandre interpela le serveur qui venait de passer près d'elle.
« Excusez-moi, Monsieur, vous auriez une feuille, s'il vous plaît ? Une feuille de papier, j'entends. »
« Mais qu'est-ce que tu fais, Cassou ?!, chuchota Hugo gêné par le ton léger de son amie. »
« Laisse-moi faire !, répondit simplement Cassandre. »
Avant d'ajouter :
« Je prends l'initiative, mon chou. Si je t'attends pour écrire un roman d'amour, on y est encore dans dix ans et moi, dans dix ans, je serai mariée avec un youtubeur richissime et je me ferai masser les orteils sous le soleil de Californie. »
Hugo détestait quand Cassandre faisait ce genre de vannes idiotes et stériles. L'argent, le soleil, les massages d'orteils, elle méritait tellement mieux.
En tout cas, le serveur venait d'apporter un pauvre bout de papier à la jeune fille.
« Veuillez m'excuser, je n'ai trouvé que ça, madame. »
« Merci, c'est parfait. »
Et la jeune femme d'ajouter, un poil chagrinée :
« "Madame", qu'il dit, lui ! Il m'a pris pour ma mère ou quoi ? »
« Je crois qu'on n'a plus le droit de dire "Madmoiselle" en fait, commenta Hugo. »
« Et depuis quand on n'a plus le droit ? »
« Bein, depuis qu'on n'a plus le droit ! Ils ont dit à la télé que c'était sexiste. »
« Qui "ils" ? »
« "Ils", c'est "eux" à la télé, et eux, je ne sais pas qui c'est, moi !, s'emporta faussement Hugo. »
« Arrête, toi aussi, avec tes questions. J'ai l'impression de revenir dix ans en arrière et de passer mon bac ! »
« Dans ce cas-là, reprit Cassandre, si on n'a plus le droit de rien dire, le serveur, il ne dit rien et ce sera toujours moins vexant. Bon, t'as un crayon ? »
« Euh... je ne crois pas en fait... »
« Un écrivain sans papier et sans crayon, pauvre siècle ! »
« En fait, expliqua Hugo, souvent quand j'ai une idée et que je n'ai rien pour la noter, je me l'envoie par texto. »
« Ok, je vois le genre : "génération geek" !, fit son amie en levant les yeux au ciel. En attendant, on va le faire à ma façon, c'est à dire à l'ancienne. Après tout, maintenant, je suis une "Madame"... »
Elle sortit un crayon de son sac et enchaîna en ces termes :
« Bon alors, quelle est ta cible ? »
« Hein ? »
« Ta cible ! Tu le fais exprès ou quoi ? Les lecteurs que tu veux toucher, si tu préfères.
« Oh... Tu sais... Moi, ça fait bien longtemps que je n'ai pas touché quelqu'un... »
Oh la la, le pauvre "garçounnet"..., se moqua Cassandre. C'est trop mimi. Tu vas me faire chialer. Je te ferai tripoter un de mes nichons tout à l'heure si on a cinq minutes ! »
« Il n'y avait vraiment qu'elle pour balancer un machin pareil, et en public de surcroît. Et c'est exactement pour cette raison qu'Hugo l'aimait, enfin je veux dire, qu'il l'appréciait tellement. Cassandre semblait n'avoir honte de rien, être solide comme une roche. Mais lui seul savait à quel point cette impertinence n'était qu'une carapace. »
« Je te préviens, continua la jeune fille toujours aussi cash, on n'écrit pas un bouquin pour toutes les petites vieilles qui s'ennuient. Si elles s'ennuient, elles n'ont qu'à prendre une licence pour la marche nordique le dimanche matin, et si ça n'suffit pas, qu'elles se relisent l'intégrale de Platon! »
« Tu trouves qu'on s'ennuie moins quand on lit Platon ? »
« Non, elles s'ennuieront carrément plus, nos p'tites vieilles, mais au moins elles sauront pourquoi. »
« Du coup, proposa Hugo, on peut faire un roman pour les grandes vieilles qui s'ennuient. »
« Très drôle, fit Cassandre impassible. Excuse-moi, j'ai un fou-rire. »
« Les ados !, lança finalement Hugo. C'est bien, les "djeunes" ! »
« C'est bien quand ils savent lire. »
« T'es vraiment une peau de vache ! »
« L'avantage avec les ados, c'est que tu peux te limiter à vingt pages, sommaire inclus, et ce sera largement suffisant. «
« N'abuse pas quand même... »
Et Cassandre d'abuser quand même :
« Et bien, le jour où tu feras lire un bouquin de plus de cent pages à un ado, tu me le présenteras et je l'adopterai, parce que ce sera le futur Einstein, je te le garantis ! »
« T'as épousé Zemmour dans l'après-midi et tu ne me l'as pas dit ou quoi ? »
« Ah, quand même ! Depuis tout à l'heure, je balançais des saloperies pour te faire réagir. Je voulais voir quand tu m'arrêterais. Crois-moi ou pas, mais j'ai failli attendre. »
« Je me disais aussi : qu'est-ce qui arrive à ma copine bobo-écolo-gaucho-intello attachiante ? J'ai rien vu venir. Et pour savoir, t'as commencé quand ? »
« Avec les petites vieilles et la marche nordique. Quoique, ça en l'occurrence, ça se discute ! »
« Bon, sans rire, on part sur les ados alors ?, demanda Hugo qui était toujours le premier des deux à redevenir sérieux. »
« Ok, je valide. »
Cassandre griffonna sur son bout de papier un nuage de lettres qui devait vaguement signifier
"Cible visée = Ados". Elle poursuivit ainsi :
« Maintenant, on peut s'attaquer au plus difficile : la trame. Le début d'un bouquin, ça va. La fin, ça va aussi souvent. C'est le milieu qui fait chier ! »
Elle venait de résumer la vie d'Hugo en une simple phrase : "c'est le milieu qui fait chier"...
« Il nous faut une ville !, continua Cassandre emportée par son élan créatif. C'est toujours des villes dans les histoires d'amour. Coup de foudre à Notting Hill, si tu le tournes au milieu des vaches, dans la Creuse, ça rend pas pareil ! »
« Totalement d'accord. »
« Tu me feras une ville pas trop grande. Pas une capitale, hein. Mais pas trop petite non plus. »
« Et puis, surtout, super mignonne. Avec des toits en chaume et des arbres de toutes les couleurs un peu partout. Avec des pistes cyclables aussi. Et puis, des gens qui passent de temps en temps et qui vivent leur vie, quoi. Il nous faudra pas mal de figurants quand on tournera l'adaptation au cinéma. »
« Tiens au fait, en parlant de ciné... »
« Cassandre interrompit Hugo sur le champ. »
« Non non non, fit-elle en secouant la tête. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça ! J'écouterai cette anecdote sans doute extrêmement passionnante, mais plus tard. Alors, qui raconte ? »
« Bein, moi... »
« J'hallucine ! T'as bu deux gorgées de bière et t'as déjà le ciboulot qui crie famine, toi ! Bon alors, qui raconte ? »
« Ah ok d'ac'. Tu veux dire : qui est le "narrateur" ? »
« Monsieur ramène sa science !, se moqua Cassandre en prenant de grands airs. »
« Il y a en général trois possibilités, expliqua Hugo sans se démettre. »
« Vas-y, annonce la couleur. »
« C'est le garçon, c'est la fille ou c'est les deux qui racontent. »
« Ou ni l'un ni l'autre ! »
« Ou ni l'un ni l'autre », répéta Hugo pour confirmer. Mais si je te parle des narrateurs omniscients, tu vas encore te moquer !
« J'aime bien quand c'est les deux qui racontent, moi. Pourquoi pas l'un et après, l'autre. On écrit la même scène avec le point de vue du mec, puis le point de vue de la gonzesse. »
« Classique, commenta Hugo. Classique, mais efficace. »
« Si c'est classique, on oublie !, fit aussitôt Cassandre. Il nous faut un truc qui déchire. »
« Et pourquoi ce serait forcément un garçon et une fille ?, demanda Hugo. On peut raconter l'histoire d'un couple d'homos. »
« T'es homo, toi ? »
« Bein non... »
« Bein moi non plus ! »
« Et donc ? »
« Et donc ce serait trop difficile pour toi. Je veux du vécu. Je veux que tu sortes tes tripes pour une fois. Tu vois, je te ménage mon auteur fétiche ! »
« La jeune femme pinça alors la joue du jeune homme, qui devint rouge comme une écrevisse. »
« Tu veux me ménager, dit-il troublé, et en même temps, il faut que je sorte mes tripes. »
« Faudrait savoir ce que tu veux, Cassou. »
« Je veux des hétéros et ils s'appelleront... Elliott et Sarah ! »
« J'aime pas Elliott, ça fait trop british. »
« T'as raison et puis, c'est le prénom de mon ex... »
« Ah ouaih... C'est peut-être pour ça que j'aime pas en fait. »
« Et Adam, ça te plaît ? »
« Ah ouaih, carrément... »
« Moi, j'aime pas ! Donc faut qu'on trouve autre chose... »
« Hum... pourquoi pas... Gaël ? »
« Gaël, si ça peut te faire plaisir !, valida Cassandre tout en prenant des notes. »
« Attention, prévint Hugo, hors de question que Gaël soit un beau gosse à la mèche parfaite. »
« Moi, quand j'étais ado, je me trouvais tellement moche que je n'arrivais pas à m'identifier à tous ces mannequins taillés sur mesure. »
« Va pour un laidron boutonneux alors !, lâcha Cassandre en complétant ses notes. »
Puis elle demanda :
« Et donc, qu'est-ce qui leur arrive à Sarah et Gaël ? »
« On va essayer d'éviter le déjà vu, mit en garde Hugo. »
« Totalement d'accord. En même temps, tout n'est pas mauvais dans les clichés. L'idylle interdite façon Roméo et Juliette, Jack et Rose... »
« Tout les oppose et un jour... »
« ... un jour, ils découvrent qu'ils s'aiment !, firent Cassandre et Hugo. »
C'était peut-être un peu cliché d'admettre cela, mais Hugo adorait plus que tout quand sa meilleure amie et lui prononçaient les mêmes mots, en même temps et sur le même ton.
« Il nous faut une fille timide qui sauve le bad boy d'une vie compliquée, enchaîna-t-il. »
« Merci, j'ai une grande sœur. »
« Quel rapport ? »
« Et bien, quand tu as une grande soeur qui est née dans les années 70, tu n'as plus assez de doigts pour dire combien de fois tu t'es farcie Dirty Dancing ! »
« Et moi, fit Hugo, je me suis tapé la trilogie des sados masos cet été. Tu sais, j'ai lu les nuances de Grey, là. »
« Merci, j'avais compris. »
« Enfin, je ne dis pas cinquante parce que j'ai compté les nuances de style, et je n'en ai pas trouvé beaucoup ! »
« Monsieur est un comique. "Bilan encourageant, Hugo Victoire, poursuivez vos efforts".Non, sans déconner, tu me mettras de l'humour dans ton bouquin. Les gens aiment ça. Mais pas trop quand même. L'amour, d'abord ! »
« Et si on faisait l'inverse ?, proposa Hugo. »
« L'inverse de quoi ? »
« Ce n'est pas la fille qui sauve le bad boy mais l'inverse. »
« Ah non, j'ai mieux ! Le garçon n'est pas un bad boy ! C'est un mec bien. Les gentils garçons ont aussi le droit à l'amour. Regarde, toi par exemple, je te connais bien et je suis persuadée que tu mériterais de tremper ton biscuit de temps en temps. »
Hugo ne releva pas la pique, une fois encore, et Cassandre poursuivit avec ces mots :
« Donc, si je comprends bien, c'est la fille qui est la bad girl ? »
« Pas forcément. Ça peut être aussi une gentille fille. »
« Ouh la, ça commence à puer le gnangnan ton bidule. »
« Il faudrait..., commença Hugo tout en réfléchissant, que... oui, que... le garçon soit le fils d'un militaire qui doit partir en mission et donc, le couple de gamins va devoir se séparer. »
« Cliché !, objecta Cassandre. »
« Ou alors, ce serait le fils d'un politicien véreux... »
« Gros cliché !! »
« Ou bien alors, ça se passe au Moyen-âge et c'est le fils du roi. »
« Beurk, énorme cliché !!! Fais un effort, allons, ou c'est moi qui finis ta bière ! »
« Ça y est, j'ai une idée, lâcha Hugo plein d'enthousiasme. C'est le fils d'un serial killer ou d'un tueur à gages à la retraite, qui bossait pour le KGB et qui est rattrapé par son passé ! »
« Ah non !, gronda Cassandre. Je vous arrête tout de suite, Monsieur ! Je ne te laisserai pas te noyer à nouveau dans tes romans policiers. On est là pour que tu quittes un peu ta zone de confort, je te le rappelle. »
« Et si c'était le fils d'un ancien avocat qui a défendu le meurtrier du père de la fille ? »
La jeune fille soupira à nouveau.
« Déjà, dit-elle, ça m'a l'air super méga hyper compliqué et en plus, je t'ai demandé d'oublier tout ce qui a un rapport avec la justice. Vas-y, trouve-moi un métier. Vite ! »
« Je ne vois plus que ça : c'est le fils d'une esthéticienne. »
« Pas mal... »
« Une esthéticienne qui ferait pousser dans son garage des plants de ricin pour fabriquer du poison et buter les hamsters du quartier. »
« Mais t'es vraiment un grand malade ! »
« Et si c'était tout simplement le fils de ... sa mère ?! »
« Tu te fous de moi ? »
« Non, sérieux, expliqua Hugo, ce serait le fils d'une mère possessive qui l'empêche de sortir et un jour, en cachette, il sort et là, il tombe sous le charme d'une inconnue. »
« Là, tu m'intéresses !, lança Cassandre en reprenant confiance. Et c'est quoi alors le métier de la mère ? »
« On s'en fout du métier de la mère ! C'est une femme tellement aigrie qu'elle déteste les hommes, elle déteste les humains en général et elle refuse catégoriquement que son fils quitte la maison. » « Alors, c'est elle qui lui fait l'école, les volets sont toujours fermés, il y a des cadenas partout. C'est trop glauque, quoi. »
« Il a quel âge le garçon ? »
« Il vient d'avoir onze ans, c'était son anniversaire hier et il a eu... un tire-bouchon ! »
« Bonjour le cadeau ! »
« Non, se reprit Hugo, pas un tire-bouchon... Un livre... Un livre d'aventures... Non, non, j'ai largement mieux : il a eu un vélo ! Parce que sa mère avait promis que pour ses onze ans, il pourrait sortir pour la première fois de sa vie. »
« Ok, j'achète. »
Cassandre continuait de gribouiller sa petite feuille, tout en essayant de suivre les va-et-vient dans l'imagination de son fidèle ami. Ce dernier était comme possédé à présent. Un poisson dans l'eau.
Dans l'eau de rose, cela va de soi. On ne l'arrêtait plus. Il poursuivit ainsi :
« Le garçon, il a le droit de sortir le jour de son anniv', mais sa mère l'autorise simplement à rouler avec son vélo jusque le bout de la rue, jusque la petite droguerie. »
« Il sait faire du vélo alors qu'il n'est jamais sorti de la maison ? »
« Euh non... T'as raison... merde... Mais si, bien sûr ! Il a appris ! Avec le vélo de sa mère, dans le couloir ! C'était un grand couloir d'ailleurs, avec plein de mochetés accrochées au mur. Note-le ça, j'y tiens. Et donc, là, sa mère lui demande d'aller jusqu'au bout de la rue, dans la petite boutique... »
« Pour acheter quoi ? »
« Une pince à épiler ! »
« Hein ? »
« Elle a perdu la sienne et elle est hyper poilue. »
« Mouaih, fit Cassandre sceptique. Ça, t'es peut-être pas obligé non plus.
Toujours est-il que là, sur la route, avec son petit vélo, il savoure enfin le goût de la liberté... Gaël roule, cheveux au vent, mais pas de mèche parfaite je te rappelle, et là, il aperçoit la façade de la fameuse boutique quand soudain... Paf ! Il percute une jeune fille ! C'est Sarah ! Gaël percute Sarah parce qu'il n'avait jamais fait de vélo avant, sauf dans son couloir, et que ça ne faisait pas pareil sur la vraie route ! C'est bon, ça ! Appelle Spielberg, Cassou... On va cartonner ! Il va vouloir commencer l'adaptation tout de suite... Et avec un peu de chance, il n'aura pas jeté le vélo du gamin d'E.T. ! Ça nous fera des économies. »
« Et la fille, elle est comment ?, demanda Cassandre un peu débordée par la prise de notes. »
« Tellement jolie... »
« Précise enfin. "Jolie" comment ? »
Hugo prit alors soin de déclamer, avec un lyrisme des plus révélateurs :
« Elle était jolie comme le soleil quand il tombe dans les bras de Morphée. Jolie comme un accord de musique dont la résonnance est parfaite. Jolie comme une fleur qu'on n'oserait pas cueillir pour ne pas l'abîmer. Jolie comme toi, en fait. »
« T'es con !, murmura Cassandre en inclinant le regard. »
Hugo aurait juré que les joues de la jeune fille avaient légèrement rosi.
« En tout cas, continua cette dernière après avoir repris maladroitement une gorgée de soda, avec tout ça, tu peux nous pondre une centaine de pages facilement. Entre la rencontre, les premiers émois, le premier "Je t'aime", tu as largement de quoi faire ! »
« 100 pages, mais c'est énorme ! Et puis, je n'ai pas l'habitude des bouquins comme ça, moi ! »
« Non, mais tu crois quoi, monsieur "Prix Femina" ?! Je ne vais pas te faire tout le boulot non plus ! »
« Et puis, tu me mettras une belle scène de sexe bien graveleuse là-dedans. »
« Mais attends, ils ont quel âge les mômes ? »
« Ah oui, c'est vrai, je suis conne... Mets-nous quand même un smack avec la langue. Il faut qu'on les émoustille un peu, nos damoiseaux et nos... damoiselles ! Oups, excuse, j'avais oublié qu'on n'avait plus le droit ! Bon, je note tout ça avant qu'on oublie. »
La jeune fille écrivit les dernières idées et finit par s'interroger.
« Mais au fait, dit-elle, il y a un truc qui cloche dans ce qu'on a fait : la relation entre le garçon à vélo et cette jolie fille, pourquoi ce serait une relation compliquée ? »
« Parce que... c'est la fille d'un ambassadeur du Bangladesh !, répondit Hugo du tac au tac. »
« Là, je t'ai perdu !, avoua son amie. »
« J'ai lu un article sur le Bangladesh ce matin même. Ils expliquaient qu'un tiers des filles y sont mariées de force avant d'avoir 15 ans... »
« Ok. Et donc, le père refuserait qu'elle fricote avec un frenchie... »
« Bingo ! Le père ferait tout pour bousiller leur histoire passionnelle... »
« Il voudra même renvoyer sa fille au pays, proposa Cassandre avec pertinence.
– Mais la mère du garçon, celle qui était aigrie, se rappellerait de sa jeunesse, quand elle aimait encore les humains, et elle retrouverait soudain goût à la vie... »
« Et elle se donnerait à fond pour que son garçon vive une magnifique histoire d'amour... »
« Et à la fin... »
« Ah non, arrête !, bondit Cassandre aussitôt. »
« Bein quoi ?, fit Hugo surpris. »
« Ah non, tu ne me dis pas la fin ! Je déteste qu'on me raconte la fin d'un bouquin avant qu je ne le lise ! Le seul truc que je te demande, c'est qu'il faut que ça se termine bien et que je me mette à chialer comme une madeleine... »
« Comme tu veux. Donc la fin, si je comprends bien, je gère tout seul ? »
« Oui. Et le titre alors ? T'as eu le temps de cogiter ? »
Hugo prit la peine de se justifier, amusé :
« Tu me fais rire, toi. Tu sais qu'il y a encore vingt minutes, je n'avais pas l'intention d'écrire un roman d'amour, alors le titre... »
« Tu me déçois. Je pensais que les artistes comme toi n'avaient pas besoin de réfléchir, que ça sortait tout seul... »
« Sans rire, tu crois qu'un écrivain, ça chie des métaphores ? »
« Ne sois pas vulgaire, ça ne te ressemble pas. »
« Coup de foudre à bicyclette » !, proposa finalement Hugo.
« Bidon ! Ne recommence jamais ça ! Ou alors, tu vas te coucher. »
Le jeune homme réfléchit un peu et proposa timidement :
« Il aime une fille qui ignore à quel point il l'aime ».
« Mais enfin, c'est nul ! Ça n'a rien à voir avec "notre" histoire ! »
« Bein si justement..., chuchota Hugo dans un soupir à peine voilé. »
Cassandre, qui avait entendu son ami mais ne l'avait pas compris, continua :
« Non, ça n'a rien à voir... Sarah aime Gaël et Gaël aime Sarah. Donc, ce n'est pas adapté. Et puis, de toute façon, ce titre est beaucoup trop long ! Tu sais bien que je n'aime pas quand ça traîne en longueur. »
La jeune femme ajouta sans transition, comme à son habitude :
« Attends deux minutes, il faut que j'aille aux toilettes. Je reviens tout de suite et on essaye de trouver un super titre à deux. Un truc vendeur. N'oublie pas que je dois aller me faire bronzer les orteils en face de chez Rihanna ! »
Elle se leva et s'apprêta à rejoindre l'intérieur de la brasserie, avant de revenir sur ses pas.
« Au fait Hugo, confia-t-elle alors, j'adore passer des moments comme ça avec toi... »
Hugo n'en croyait pas ses yeux, ses oreilles, et tout ce qu'il avait de capable d'entendre ou de voir : Cassandre Desbonnelle, sa meilleure amie, la jeune publicitaire talentueuse qui si souvent le désopilait et qui le faisait tant souffrir quand elle sortait avec un autre homme, elle, Cassandre, dont il était secrètement amoureux depuis le lycée, adorait donc passer des moments comme ça avec lui. Le jeune homme ignorait s'il aurait un jour l'audace d'affronter sa timidité maladive, de faire tomber ce masque qui l'oppresse et d'avouer enfin ses sentiments. En attendant, ce soir-là, il en avait gros sur le cœur et il aurait tout donné pour avoir la chance de vivre à l'intérieur de son futur roman.
PASS1974
La promesse
Je serre la main de l'homme qui me fait face et qui m'a parlé depuis une bonne heure, selon l'horloge toute moche qui surplombe l'entrée de la pièce d'une propreté plus que douteuse. Je reprends le chemin vers ses longs couloirs que j'emprunte maintenant depuis six jours. Je sursaute face à ce bruit horrible, à ces clacs angoissants et oppressants. Il parait que je vais m'y habituer. C'est du moins ce que l'on me répète. Je pense que jamais je ne pourrais me faire à cet enfermement. Je ne suis pas destiné à vivre ici. En franchissant la porte de ce qui est ma nouvelle demeure, répète pour la centième fois que c'est un mauvais rêve. Je m'assois lourdement sur mon lit dans cette cellule de neuf mètres carrés et je soupire, me prenant la tête dans les mains. Je ne comprends toujours pas ce que je fais ici. Comment ai-je pu en arriver là ? Des sanglots montent en moi que j'essaie de ravaler. Sans succès. J'entends alors la voix de mon père résonner à mes oreilles. "Un homme ne pleure pas, fiston !" martelait-il quand j'étais enfant. Mais là aujourd'hui dans cette cellule de cette maison d'arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone, suis-je encore vraiment un homme ?
J'en suis à ce genre de pensées quand je sens une présence au-dessus de moi. Je relève la tête et tombe sur mon codétenu, le bras appuyé contre le lit superposé. Il me fixe sans animosité. Il a été plutôt sympa avec moi depuis mon arrivée même si nous n'avions pas encore partagés de réelle discussion.
- Alors il a dit quoi ton baveux ? demanda-t-il de sa voix rocailleuse de trop fumer.
- Mon quoi ?
Il me sourit comme on sourit à un abruti et lève les yeux au ciel.
- Ton avocat !
J'étouffe un rire. Il va avoir du boulot avec moi. Je suis issu de ce que l'on peut appeler une bonne famille et l'argot ou autres appellations populaires n'avaient pas leur place chez nous.
- Toujours pareil. Il cherche à comprendre. Mais la vérité c'est que je l'ai fait.
Et là, j'éclate en sanglots à nouveau. Mon ami de galère prend une chaise et se pose devant moi. Il attend, en silence, que la crise passe et me conseille de lui raconter mon histoire. Est-il simplement curieux ou souhaite-t-il vraiment m'aider à y voir plus clair dans le tunnel sombre qu'est devenue ma vie ? Peu importe ses motivations. À ce moment précis, je n'ai qu'une envie : Parler pour moi-même essayer de comprendre.
Je suis donc issu d'une famille bourgeoise et fortement implantée dans l'Hérault. De grand-père et de père financiers, je ne pouvais pas prendre d'autre direction que celle de la banque. D'ailleurs est-ce que mon père m'aurait laissé faire autre chose ? J'en doute fort ! Ma seule rébellion a été de décider d'aller à la quête de mon ambition dans la capitale. J'étais donc devenu parisien dès la fin de mon école de commerce. J'intégrai une banque moyenne à visage humain dans laquelle je débutais comme conseiller financier. C'est en tant que tel que je reçus une ravissante cliente qui allait rapidement devenir mon épouse. Et c'est avec elle que je redescendais sur Montpellier quelques années plus tard.
Constance a apporté toute sa bonne humeur, insouciance, son brin de folie dans mon existence plutôt sérieuse et austère. Nous formions un duo équilibré. Elle parvint à se faire accepter par mes proches et y trouva une seconde famille, elle qui avait perdu ses parents très tôt et qui avait été envoyée chez une tante, qui ne l'avait pas vraiment couverte d'amour ou d'intérêt. J'étais fou d'elle et prêt à tout pour la rendre heureuse. Ma carrière évoluait rapidement et nous vivions bien, si bien que Constance délaissa son emploi alimentaire de secrétaire pour se lancer dans une carrière de sculptrice. Même si je ne voyais pas trop en quoi cette activité pouvait représenter un emploi, je soutenais l'initiative de mon épouse contre vents et marées. À partir du moment où elle était heureuse, je l'étais et lui pardonnais toutes les sautes d'humeur qu'elle pouvait avoir.
Au fil des années, son caractère devint de plus en plus difficile à gérer. Tantôt elle était douce et posée, tantôt elle se transformait en furie et me chercher querelle pour des broutilles. D'un naturel calme, je répondais sans réelle agressivité alors qu'elle semblait avoir besoin du conflit pour exister. Elle s'excusait toujours et tout était oublié. Elle se calma quand elle apprit qu'elle était enceinte et c'est plus amoureux que jamais que nous avons accueilli, il y a un peu plus de cinq ans, notre petit gars.
A partir de la naissance de Mathys, j'ai eu du mal à reconnaitre la femme que j'aimais. Elle ne cessait de pleurer, était triste alors qu'elle aurait dû être rayonnante. Ma mère m'alerta un soir sur les gestes brusques de Constance sur notre fils. C'est l'une des premières fois où je me mis vraiment en colère face à une femme que je découvrais très fragile. Notre querelle se termina en objets cassés pour moi, mais en véritable crise de nerfs pour elle. Constance m'avoua qu'elle n'y arrivait pas avec notre bébé, pourtant plutôt facile. Il pleurait peu, avait une bonne santé mais malgré tout sa mère perdait complètement pied face à la responsabilité que la vie venait de lui mettre dans les bras.
- Baptiste, si on ne fait rien je vais m'en prendre à lui ! lâcha-t-elle ce soir-là vraiment bouleversée. Elle aimait notre fils, nous aimait tous les deux, mais n'arrivait plus à faire son nouveau rôle de mère. Je lui assurais que nous allions gérer cela ensemble et que notre amour serait plus fort.
Je crois bien qu'à ce moment précis nous étions vraiment invincibles face à tout ce qui pourrait nous arriver. Constance alla consulter son médecin traitant qui l'orienta vers une unité parent-enfant. Elle adhéra à tout et tout redevint calme durant un temps.
Malheureusement de post-partum, sa dépression passa à chronique et mon épouse rechuta à plusieurs reprises. A chaque fois nous passions ce cap ensemble. Des ordonnances d'antidépresseurs puissants aux hospitalisations en unité psychiatrique, nous tenions la barre. Nous étions soudés, j'étais fou d'elle et je me devais de l'épauler.
Ma famille, bien moins patiente et nettement moins amoureuse que moi, commença à me conseiller de divorcer. Je mis un peu de distance face à ces biens pensants et leur démontra que je pouvais gérer mon fils, ma femme fragile et ma carrière d'une main de maitre. Constance s'accrochait, avait envie de revenir près de Mathys et de moi. Elle trouva un psy un peu différent des autres qui m'intégra complètement dans la prise en charge. Ma femme émergeait d'un long tunnel et cela n'avait pas de prix.
En revanche si elle n'était plus morose et déprimée, Constance était devenue bien plus exigeante et agressive envers moi. Rien ne lui convenait, elle piquait des rages folles que je fasse bien ou pas. Elle avait ses jours où elle était la plus douce et câline des femmes et d'autres où elle se transformait en tyran. Je laissais passer lui trouvant toujours une excuse. J'étais amoureux d'elle comme au premier jour et me disais que c'était tout ce qu'elle avait vécu qui l'avait perturbée à ce point.
Je reçus la première gifle un soir où elle était très fatiguée de sa journée. Un peu sur les nerfs aussi je venais de lui faire une réflexion sur son quotidien plutôt tranquille à la maison et la gifle partit. Elle me regarda médusée et s'excusa immédiatement en pleurant. Sans réellement m'en rendre compte je basculais dans le monde des violences conjugales. Des gifles elle passa aux coups et autres paroles blessantes. Je refusais de répondre. La toucher se serait retourné contre moi et surtout aurait été le signe de l'échec de notre relation. Puis je pensais à la honte que je ressentirais si cela se savait.
Alors, je subissais, essayant de rentrer le plus tard possible dans les périodes où je voyais bien que son regard redevenait dur et profitant amoureusement d'elle quand elle allait bien. Constance me pourrissait la vie mais je ne me voyais pas vivre sans elle. C'était quelque chose que je ne pouvais envisager. En public, nous passions pour le couple uni, presque modèle, qui avait combattu la dépression. Une fois la porte refermée, c'était injures et coups. Constance, par contre, préservait toujours notre petit bonhomme et ne s'adonnait jamais à la violence devant lui. Elle ne criait jamais, elle savait que je détestais les hurlements. Jusqu’à ce fameux soir.
Depuis quelques mois je la trouvais amaigrie, plutôt faible physiquement. Elle me répondait qu'elle allait bien et, pour ne pas éveiller le monstre en elle, je n'insistais pas. Ce soir-là, alors que Mathys était chez ses grands-parents, Constance se montra très désagréable dès que je déposais mon porte-documents sur la table. Je ne réagis pas, comme à mon habitude, laissant passer l'orage. C'est alors qu'elle se mit à hurler. Je voyais bien qu'elle ne voulait pas frapper, ou injurier de sa voix au goût de fiel. Non elle voulait juste hurler. Je fus complètement désarçonné par cette nouvelle attitude et mit un temps à lui répondre. Je l'aspirais à se calmer ce qui déclencha chez elle des vociférations de plus en plus bruyantes.
A bout d'un moment, je la secouais violemment lui demandant d'arrêter de crier. Je me souviens m'être dit en refermant mes mains sur ses épaules qu'elle avait vraiment beaucoup maigri. Je pouvais sentir ses os sous ses vêtements. Constance m'empêcha de penser trop longtemps car elle cria de plus belle. Et c'est là que je me revois mettre mes mains à son cou et serrer de plus en plus fort. Je ne suis plus dans mon état normal à cet instant précis. Tout ce que je sais c'est que plus je serre et moins elle crie. Constance ne se débat nullement, je crois même apercevoir un certain soulagement au fur et à mesure que je l'étrangle. Enfin, le silence tombe dans notre appartement. Elle ne crie plus, c’est ce que je voulais.
J’ai réalisé vraiment ce que j'avais fait quand je déposais le pantin désarticulé que ma femme était devenue sur le canapé. Je venais de la tuer. Je ne paniquais même pas, je constatais l'irréparable et je composais le numéro de la police en regardant son cadavre qui donnait l'impression de me sourire et de me regarder presque avec amour.
- La suite tu la connais ! dis-je à mon compagnon de cellule toujours assis face à moi. Il me fixe et prend la parole posément.
- Écoute-moi bien mon gars. Je peux te garantir une chose, quand tu prends la vie d'une femme comme tu l'as fait, tu vois beaucoup de choses dans son regard mais sûrement pas l'apaisement que tu viens de me décrire.
Je voulus lui demander comment il pouvait être aussi catégorique mais je me ravisais. La réponse m'effrayait déjà ! Il me conseilla de réfléchir à tout ça et grimpa sur son lit replongeant notre cellule dans un lourd silence.
Quelques jours plus tard, je me confiais sur cette dernière soirée avec Constance avec mon avocat. Il me promit de creuser et de chercher de nouveaux éléments sur ma femme. Il revint me voir une semaine plus tard.
- Je pense avoir trouvé la raison du regard de votre épouse.
- Je vous écoute, Maitre.
J'étais curieux de savoir ce qu'il avait à me dire. Il prit son temps visiblement un peu mal à l'aise.
- Votre épouse était atteinte d'un cancer en phase terminale.
- Qu'est-ce que vous me chantez ? Elle me l'aurait dit quand même !
- Les médecins ne lui avaient donné que quelques mois à vivre et des antalgiques puissants pour supporter la douleur, car elle avait refusé de se faire hospitaliser.
Alors tout s'éclaircit dans mon esprit. Sa petite forme physique de ces derniers temps était surement un signe de sa maladie. Me revint alors en mémoire une de nos conversations sur la fin de vie quand nous serions vieux. Constance m'avait fait promettre de l'aider à mourir si un jour elle tombait gravement malade, sans chance de guérir. Elle ne voulait pas se voir dépérir et imposer sa déchéance aux êtres aimés. Elle m'avait demandé de lui faire cette promesse qu'elle considérait, elle, comme la plus belle preuve d'amour que je ne pourrais jamais lui offrir. J'avais promis comme on promet quand on ne se sent pas réellement concerné par la chose. Jamais je n'aurai pensé que des années plus tard cette promesse reviendrait sur le tapis de manière aussi dramatique. Mon avocat me quitta confiant alors que j'étais totalement perdu.
Je retournais à ma cellule groggy par ce que je venais d'entendre. Je jetais un œil à mon ami de cellule et lui narrait mon parloir avec mon avocat, de cet engagement moral que j'avais pris auprès de ma femme. Pierrot me sourit et me parla de bonne nouvelle. J'entendais au loin ce qu'il me disait, comme un fond sonore. Il était certain que je sortirais bientôt. Je haussais les épaules, abattu, et regardais fixement mes mains. Ces mains qui avaient tué et soulagé l'amour de ma vie. Ces mains avec lesquelles j'avais tenu ma promesse et par lesquelles le dernier regard de ma femme resterait à jamais ancré en moi. Un regard empli de soulagement mais aussi de l'amour qu'elle me portait alors que je la soulageais.
RAVI2003
LES ADIEUX
Ce matin-là, George avait accompagné Beatrix jusqu’au port de Liverpool comme le maître lui avait intimé. Mais outrepassant pour une fois les recommandations laconiques qu’il s’était entendu prodiguer, il avait pris soin par une initiative toute personnelle de l’accompagner jusqu’au quai d’embarquement. Il s’y attardait ; ils s’attardèrent ensemble, n’osant guère toutefois reconnaître l’émotion qu’ils éprouvaient à demeurer quelques instants supplémentaires, côte à côte. Ils marchèrent lentement le long de la coque monumentale du paquebot comme s’il s’agissait de l’inspecter. Ils s’amusèrent à dénombrer la multitude de passerelles qui avaient été disposées pour l’occasion ainsi que les ponts superposés où se rassemblaient déjà en formation compacte les passagers hélant leurs proches avec force cris.
George et Beatrix paraissaient vouloir retarder une séparation inéluctable et se plaisaient à donner l’apparence d’un couple en partance vers quelque destination de villégiature tandis que la foule trépidante, bruyante qui les entourait, bien que totalement anonyme, leur renvoyait cette image avec complaisance. Ils étaient d’ailleurs tous deux d’une telle pudeur farouche que leur rêve infantile partagé restait leur secret propre et ils se confinaient chacun dans l’ignorance de ce que l’autre pouvait ressentir.
Leur sensation de bonheur solitaire se teintait cependant de mélancolie à l’écoute des coups de sifflets stridents qui rappelaient que le navire devrait bientôt ravir Beatrix à l’Angleterre pour la mener vers un rivage inconnu irlandais.
Elle était gouvernante au service de Sir Patrick Crownfeld. Il était le majordome de la maison. Elle partait en Ulster, au chevet de sa mère et ne devrait peut-être pas revenir car ayant dès lors la charge de son père infirme. En outre, lui reviendrait la tutelle d’un turbulent cousin de quinze ans dont les parents et les deux jeunes frères s’étaient éclipsés depuis plusieurs mois en Amérique. Retenu par une scolarité chaotique, John, l’aîné, n’avait obtenu l’acquiescement paternel de se lancer, du moins pour le moment, vers le Nouveau Monde et avait été confié à sa tante. En effet, même souffrante et moralement affaiblie, la mère de Beatrix s’avérait être la seule autorité capable de discipliner cette personnalité rebelle et de tempérer son ressentiment de n’avoir pas été convié à la grande aventure.
Mais, mise à part l’appréhension de prendre sous sa coupe ce bouillonnant adolescent et la peine d’avoir à retrouver sa mère dans ces circonstances, Beatrix savait bien que ce voyage risquait assurément de se prolonger, ce qui pourrait remettre en question son emploi actuel malgré la bonté naturelle de Sir Crownfeld.
George l’avait aussi compris et cela l’affectait tout autant sans qu’il n’ait jusqu’alors réussi à le confier à Beatrix. De même, il n’avait jamais pu lui dévoiler ce qu’elle était devenue à ses yeux -et qu’il s’avouait difficilement lui-même- de crainte sans doute que ses sentiments intimes n’aient pu rencontrer de réciprocité, ni quelconque compréhension. Pourtant, il se sentit en cet instant comme acculé. Il savait que cet imbroglio informe et tumultueux de sensations autour d’eux, mélange de sons, d’odeurs et d’agitation gestuelle figurerait peut-être le décor de la dernière occasion de voir Beatrix.
Le brouhaha qui les environnait le grisait, les grisait. Les vociférations de toutes sortes et les conversations à voix basse sur le quai, ainsi que les appels lancés par l’équipage répondaient aux vrombissements sourds des machines. La fumée qui s’échappait des cheminées retombait sous l’effet d’une brise marine et enveloppait d’un voile noir presque onirique l’effervescence bien matérielle du port.
- Mais tout cela ne doit pas nous faire oublier pourquoi nous sommes ici. Vous allez devoir monter à bord, Beatrix.
- Je le sais George. Inutile de me rappeler, répondit-elle d’un ton agacé dont elle usait parfois. Vous allez bientôt pouvoir rentrer, ajouta-t-elle sur la même intonation.
- On dirait que l’idée de retrouver votre mère ne vous enchante pas.
- Ce n’est pas cela. Et vous le savez pertinemment, George ! lança-t-elle avec hardiesse.
Le fait que les dockers continuaient encore à se presser, lui laissait un peu de temps dont il pouvait disposer pour profiter de la simple présence de Beatrix et surtout pour éprouver son propre courage face à elle. Mais l’échéance de ce bref répit se profilait dangereusement. Il allait devoir se lancer rapidement. On ne voyait plus guère de passagers sur le quai. Tous semblaient avoir pris place sous les yeux implorants ou envieux de leurs proches agglutinés en contrebas, le long de la masse informe du bateau.
Mais il ressentait un besoin incompressible de soulager la lourdeur des non-dits qui lui entravait physiquement la poitrine. Il suffisait pourtant qu’il se laisse entraîner par l’expression instinctive et naturelle de ses émotions. Il aurait fallu qu’il lui parle mais cela était sans doute la chose la plus délicate pour un homme de son genre, de son éducation et peu enclin à s’extérioriser surtout en matière de sentiments amoureux.
- Sans vous, la maison ne sera plus la même.
Ce fut la seule phrase qu’il parvint à formuler… d’une voix presque vacillante. Cela pouvait sembler anodin mais lui coûta un effort démesuré.
Beatrix le comprit. Elle en tressaillit de tout son corps sans qu’il en paraisse.
- -Je voulais vous dire une dernière chose, fit-il encore.
Elle s’arrêta puis le fixa.
- Pourquoi dernière ? le força-t-elle avec impatience comme il tardait à poursuivre.
- Parce qu’après cela, tout sera dit.
- Ne faîtes pas l’enfant ! Je veux vous entendre.
- Je crains de perdre quelque chose en vous dévoilant mes impressions.
- Et bien, allez-y quand même car vous risqueriez fort de tout perdre en vous taisant davantage.
Son cœur battait à tout rompre. Elle le poussait dans ses ultimes retranchements, le menaçant à demi-mot. Il était au bord du gouffre, prêt à s’y précipiter. Toute sa discrétion, sa prudence et sa réserve fondaient et il ne se sentait plus lui-même. Il allait lui avouer enfin son amour inhibé depuis de trop longues années. Il devait se déclarer, ce besoin devenait trop pressant et allait briser le barrage des réticences. Pourtant, intuitivement il avait toujours eu le pressentiment que cet amour avait atteint une telle intensité grâce justement à son caractère de frustration et de secret. Et qu’adviendrait-il s’il devait se révéler ? N’était-ce pas cette retenue qui le maintenait à son meilleur niveau ?
- En votre absence, mon existence chez le maître me paraîtra vide.
- Votre existence… mon absence… Vous contournez sans cesse et vous vous complaisez dans le silence. Ah ! Pourquoi les femmes ne pourraient-elles pas prendre les devants ?
- Bon… fit-il, piqué au vif.
Face à elle, il lui semblait qu’ils étaient seuls au monde sur le quai animé, ne se souciant plus d’être reconnu, ni même d’étaler en public son embarras. Sans dire un mot de plus, il introduisit une main dans la poche intérieure de son veston. Il en retira une petite boîte enveloppée d’un papier des plus communs mais plié avec le plus grand soin. Il tendit le présent à Béatrix qui en restait interdite mais qui finit par le saisir avec une certaine réserve, voire presque de l’appréhension. Ses doigts effleurèrent la paume ouverte de George. Il baissa les yeux, incapable de parler. C’était la première fois, depuis toutes ces années pourtant vécues si proches physiquement l’un de l’autre, qu’ils se touchaient. Cet infime contact charnel acheva d’enflammer tout son être.
Elle ne put, de son côté, se contenter d’attendre et ouvrit immédiatement le papier, puis l’écrin et lorsqu’elle vit l’anneau monté d’un saphir, elle sentit son visage s’échauffer malgré la brise marine.
Elle le fixa quelques instants comme perplexe. Il commençait à se demander s’il n’était pas allé trop loin ou si même il n’aurait pas jusqu’à ce jour interprété faussement l’attitude de Béatrix à son égard, ce qui le plongerait dans la confusion et le ferait paraître ridicule au plus haut point.
Elle s’approcha alors subrepticement de lui et, profitant de l’effet de surprise, l’embrassa fougueusement sans qu’il ait opposé la moindre résistance. Enfilant ensuite ostensiblement la bague sur l’annulaire droit, elle s’empara prestement de sa valise et se faufila sans se retourner sur la passerelle. L’homme en uniforme à l’allure sévère qui s’y tenait majestueusement et à qui en incombait fièrement la charge, fut le seul à voir le visage de Beatrix en cet instant. Lui qui avait assisté à toute la scène depuis le début, passa d’un regard outré à une expression de compassion en découvrant au plus près le trouble de la jeune femme lorsqu’elle le croisa. George, immobile sur le quai, affichait un air médusé sans pouvoir le dissimuler face aux sourires malicieux des derniers dockers qui s’apprêtaient à monter encore à bord mais que lui ne voyait déjà plus.
REVI1992
ELISA REVIENS-MOI !
Journal intime de Souad.
Pas de date elle ne note jamais la date.
Etre mise entre parenthèse.
On peut dire ça d’un mot, ou d’une phrase mise entre parenthèse dans un texte. Ou bien on met le boulot entre parenthèse quand on part en vacances. On oublie le stress, les collègues et on se barre avec d’autre gens, plus sympathiques, plus attirant. Ou encore…
Bon on ne va pas tourner autour du pot six cent ans, moi c’est la femme de ma vie qui m’a mise entre parenthèse ! On peut même dire qu’elle a décidé… de m’oubliez un peu et de se barrer avec des gens plus sympathiques, plus attirants… Je ne sais pas où elle est. Elle m’a dit qu’elle avait besoin de respirer, de faire le point…
Je lui ai bien proposé qu’on fasse le point ensemble mais elle n’a pas voulu. Pas compris…
Selon elle on est trop l’une sur l’autre, on sort jamais avec nos amis, on reste tout le temps à la maison et on voit personne… En même temps elle n’assume pas d’être amoureuse d’une femme et moi faut me comprendre je ne suis pas lesbienne je l’aime elle, juste elle. Et du coup je ne l’ai pas présenté à mes amis. Bon elle non plus. Mais elle n’a pas d’amis, c’est parce que son meilleur pote c’est son ordinateur et que c’est le genre jaloux.
Bref, elle a disparue, c’est un drame, faut que je la retrouve.
Forte de cette nouvelle résolution Souad laisse un énième message sur la messagerie saturée d’Elisa, pas de réponse. L’appart est vide sans Elle. Les belles fenêtres PVC qui garantissaient leur intimité l’isolent du monde avec efficacité. Il n’y a plus de vaisselle dans l’évier, et plus personne pour raller parce que c’est le bordel. C’est Elisa la maniaque, pour Souad du bazar c’est juste une preuve qu’il y a de la vie. Et justement, ne voulant pas laisser du désordre dans l’appartement avant de filer Elisa a tout rangé. Tout est aseptisé. On dirait un appart témoin. Plus d’Elisa, plus d’Asubakatchin, son chiot joueur qui leur servait de réveil matin, et plus d’ordinateur pour assurer le fond sonore. Ce. N’est. Pas. Possible. Du. Tout ! La jeune femme attrape ses clés, noue son hijab en quatrième vitesse et se rue dans sa voiture. Elle connait l’adresse de la mère de sa dulcinée, elle va zoner dans le coin, peut-être qu’elle n’est pas si loin que ça.
La mère d’Elisa vit dans un quartier calme et aisé de l’autre côté de la ville. Des petites maisons coquettes blanche et rouge, des petits jardins plus ou moins bien entretenus. Le sien déborde de massif de lavande rose et de rosiers blancs, c’est joli, ça sent bon, c’est tranquille. C’est… oui c’est tout à fait le genre d’endroit propret et figé qui produit des maniaques de la serpillière qui croit être des rebelles parce qu’elles prennent un chien en appartement et passe huit heures par jour sur internet…
Souad a attendu quatre heures dans la voiture, pas d’Elisa. Juste sa mère qui a arrosé ses rosiers avec un arrosoir en plastique rose à petits canetons jaunes fluo. Qu’est-ce qu’Elisa ressemble à sa mère ! D’ailleurs la daronne se traîne une de ces scolioses ! Dès qu’elle lui aura remit la main dessus elle l’a met aux séances de Pilate, hors de question qu’elle finisse comme sa mère !
Bon, pas de princesse chieuse et amoureuse aux longues boucles rousses. Avant de repartir il faut quand même poser deux trois questions à sa mère. Elle ne sait pas trop comment s’y prendre, elle trouvera bien une excuse pour qu’une illustre inconnu soit à la recherche d’une associable notoire. La jeune femme voudrait se remaquiller pour présenter un visage plus net, plus engageant, mais elle a oublié sa trousse, en fait elle a même oublié son sac. Faut-il qu’elle lui manque sa geekette émotive aux grands yeux verts éternellement planqué sous une énorme paire de lunette.
Martine était une femme d’une soixantaine d’année, divorcée, ayant élevé seules ses deux enfants. Son petit monde à elle c’était le boulot d’aide soignante à domicile (plus que deux ans avant la retraite avec les nouvelles lois, elle tenait bon !), deux amies fidèles avec qui prendre le thé de temps à autre, son fils qui tardait à quitter le nid et sa fille qu’elle harcelait de texto « humoristiques » dans le but d’obtenir des nouvelles au moins une fois par mois. Alors cette femme sortis d’une voiture pourrie, avec son voile noire sur la tête et ses gestes nerveux qui cherche sa fille pour faire un tuto sur youtube. C’est pas que Martine soit raciste, c’est qu’elle est de l’ancienne génération, un peu vieille France, un peu féministe, elle se méfie du voile, elle se méfie de la voiture pourrie, elle se méfie de cette inconnue qui, sans avoir l’air de trop y toucher, veut savoir où est sa fille adorée.
Souad reconnait ces hésitations de petites vieilles méfiantes qui s’agrippent à leurs sacs dès qu’elles aperçoivent une personne qui ne rentre pas dans leur petit monde clos de bonnes manières, de vins de bourgogne et d’apéro saucissons. D’habitude elle explique posément à ce genre de bonnes femmes effarouchée qu’elle n’est pas musulmane mais plutôt sataniste pratiquante, et ça fait rire Elisa. Mais cette vieille chouette est son hypothétique ex futur belle-mère, les gants et les pincettes sont de mises. Elle explique posément ce qu’est un tuto et pourquoi est-ce que des jeunes veulent faire des tutos (pour le fun bien sûr, du coup elle explique ce qu’est le fun). Et pourquoi sa fille voudrait faire un tuto avec elle ? Mais parce qu’elles adorent internet toutes les deux bien sûr ! Souad ressort toutes les grandes théories de sa belle sur le net et le futur de l’humanité en misant sur le fait qu’Elisa aura rabattu les oreilles de sa mère avec. Si elle prouve qu’elle connaît bien sa fille, peut-être qu’elle gagnera sa confiance. Si ça marche elle lui dira qu’elle lui a donné rendez-vous ici, et qu’elle a besoin d’un coup de main pour la retrouver.
Ça marche ! Martine écoute sans faillir pour millième fois la théorie USB. Une parmi tant d’autre où, dans le futur, toute l’humanité se fera implanté une clé USB dans le cerveau afin d’être connecté directement à tous les réseaux du monde. Tes yeux deviennent à la fois ton écran où défilent les images et ta caméra, tes tympans reçoivent directement la musique et les informations, ton cerveau envoie des mails à d’autre cerveau, ouvrant l’ère de la télépathie et de la compréhension universelle. D’ailleurs cette jeune fille explique mieux qu’Elisa. Et puis elle connaît Asubakatchin. Oh et puis Elisa et ses plans foireux ! Avoir donné l’adresse de sa mère au lieu de la sienne quelle nouille ! Martine n’a pas envie de passer sa journée à courir après sa fille, elle préfère déléguer le problème à plus compétent. Et elle ne connaît qu’une seule personne experte en décryptage d’Elisa sauvage : son père ! Elle file l’adresse du daron à la dame et se replie stratégiquement dans sa jolie maison.
Souad soupire. Le père habite dans la banlieue, de l’autre côté de la ville, derrière le périph… Et c’est parti !
L’adresse est facile à trouver, le père est là, il ouvre immédiatement la porte.
- Bonjour monsieur.
- Bonjour Souad, vous êtes à la recherche de ma fille n’est-ce pas ?
La réussite du papa est moins éclatante, mais il est plus accessible. Isolé dans sa tour HLM, il est l’image même de l’homme seul au milieu de la foule. Les murs disparaissent sous les piles de livre, la musique classique chasse le silence de son repaire de célibataire. Le papa d’Elisa est quelqu’un de très seul, plutôt content d’avoir de la visite. De plus, lui, il a reconnu la jeune femme qui a dragué sa fille sur les réseaux sociaux quand elle habitait encore chez lui un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.
- Ma fille est fragile vous savez, je ne vous dirais pas où elle se trouve sans une sérieuse garantie que vous êtes une belle rencontre pour elle.
- Je l’aime ! Ça fait cinq ans qu’on vit ensemble, c’est la femme de ma vie.
- Elle est allée rêver sur le port, elle faisait souvent ça ado, quand c’était un peu compliqué à la maison ou au lycée.
Souad aura épuisé sa patience et son essence à courir après son Elisa en proie au doute. Mais elle l’a trouvé. Elle est là. Sa silhouette menue, presque transparente, les boucles rousses qui virevoltent dans la brise marine et les relents de poiscaille. La doudoune noire serrée sur ses flancs. Ses longues jambes serrées l’une contre l’autre. Les écouteurs dans les oreilles la coupe du monde et elle sursaute violement quand Souad l’emprisonne fermement entre ses bras. Des doigts fins et basanés retirent délicatement un écouteur d’une oreille pâle sous une multitude de tâches de rousseur.
« Je t’aime. »
Elisa baisse la tête, ne dis rien, mais ne se dérobe pas. Dans leur couple c’est Souad la courageuse. Mais Souad est fatigué d’être courageuse. Alors elle lui murmure tendrement dans les cheveux :
« Elisa, je veux que tu sois ma femme. Je veux vivre avec toi pendant des années, t’apprendre par cœur et n’avoir plus aucun secret pour toi. Ensuite je t’épouserai, ma belle, et on adoptera un gosse qu’on rendra heureux, irresponsable et accro à internet. Maintenant j’aimerais que tu me dises si tu es d’accord ou si tu vas me larguer comme une merde dans trois semaines. »
Elisa frémit et ne répond pas. Classique. Ne demandez pas à une hyper émotive de parler dans un moment d’intense émotion. Place aux gestes ? Souad repense très fort aux débats enflammées qui ont embrasé la routine entre elles deux. Elisa, les yeux ouverts, brillants, qui soutient que la plus belle preuve d’amour qu’on puisse donner c’est de revenir vers un être aimé. Parce que si on revient c’est que la personne aimée est capable de nous laisser partir. Si t’es libre de partir, t’es aussi libre de rester. Souad la lâche doucement et se détourne, repart direction la ville de bitume. Elle n’a fait que trois pas quand une masse lui tombe dessus et la serre dans ses bras. Elle ne parle pas, ça va revenir. L’émotion passe doucement, Elisa murmure d’une voix douce :
- Je veux rester avec toi. On s’assumera quand on se mariera hein…
- Ouais, dans quelques années.
- Je t’aime Souad.
TION8197
L’âge de déraison
Je venais d’avoir sept ans, l’âge de raison. Mais c’est la déraison qui eut raison de moi. Elle m’a pris par surprise, au sortir de l’école. Je ne savais pas encore son nom ni ne me doutais de l’ampleur du pouvoir qu’elle exercerait sur ma petite personne. Au tout début, je n’y trouvai que de la joie.
Ce jour-là, comme la plupart du temps, ma mère était venue me chercher, tenant mon petit frère par la main. Parfois, il avait du chocolat autour de la bouche, car c’était l’heure du goûter et du haut de ses quatre ans, mon petit frère se transformait en enfant sage dès qu’il pouvait savourer ses gourmandises de l’après-midi. Moi aussi, j’adorais ça, mais j’étais un grand alors je ne le manifestais pas trop, juste ce qu’il fallait. Pourtant, en cette fin d’après-midi, tout me parut hors du temps dès que je la vis. Il me semblait flotter dans les airs comme ces personnages de dessins animés qui parcourent de grandes distances entre ciel et terre sans jamais tomber. Je comprenais ou plutôt je ressentais enfin ce que voulait dire avoir la tête dans les nuages. Et quelle en était la cause ? Un joli visage de petite fille, avec de grands yeux bleus comme des pierres précieuses enchâssées dans des orbites humaines, un sourire discret et délicat montrant à peine quelques dents bien qu’une manquât, ce qui, loin de lui nuire, ajoutait un côté espiègle à sa physionomie. Le tout était couronné d’un petit bonnet multicolore d’où s’échappaient des mèches blondes qui rappelaient, en mieux, les dessins de notre nouveau livre de lecture. Oui, c’était ainsi ! On aurait dit une petite fille, bien mignonne, sortie d’un conte de fée, une image qui, comme par magie, aurait pris vie.
Je dus rester longtemps à la contempler, sans doute la bouche entrouverte, comme si cette apparition inattendue relevait du merveilleux. Les autres ne la voyaient pas autrement qu’une enfant de six ans revenant de l’école comme toutes les autres fillettes ou alors ils ne la voyaient pas du tout. Mais moi, avec mon regard extatique, je devais avoir une drôle de mine.
Ma mère, qui était pressée, posa une main sur mon épaule et impulsa un mouvement vers l’avant. Mon petit frère tenta de mettre un emballage dans ma bouche restée bée. Mais rien de tout cela n’eut d’effet sur moi. Certes, j’avançais mais comme un somnambule. Bien sûr, je fis un geste du menton pour éviter la main de mon petit frère, mais tout mon regard et toutes mes pensées étaient tournés vers elle. Et elle le voyait. Sa mère aussi le remarqua et me décocha un sourire bienveillant qui me rendit un peu confus. A peine eus-je baissé les yeux un instant qu’en relevant les paupières je ne pus que la voir de dos encore quelques secondes, puis elle disparut au milieu de la foule, dans la direction opposée.
Je ne saurais décrire quels sentiments contradictoires m’animaient. Il y avait quelques regrets à n’en pas douter, une certaine stupéfaction aussi, mais surtout c’est une joie immense qui l’emportait, une sensation de bien-être qui finit par me rendre euphorique tout le reste de la journée. Telle fut ma première rencontre avec cette déraisonnable passion que les grands appellent amour.
Comme l’on peut l’imaginer, il y eut une deuxième fois et bien d’autres suivirent. Au début, ce n’était que des échanges de regards, plus ou moins insistants. Puis, une fois, je tentai un sourire auquel, à mon grand désespoir, elle ne répondit pas. Je me consolais en me félicitant d’avoir découvert son prénom : Amélie. A cette époque, je trouvai qu’il sonnait bien et je n’avais pas remarqué que mon âme se liait à la sienne. Cela ressemblait juste au nom d’un pays lointain dans mon imaginaire de garçon aventureux. En fait cela devait vaguement me rappeler un cours dans lequel il avait été question de terre Adélie. Les sonorités étant proches, tout s’est confondu dans mon esprit et c’est bien la confusion qui me gagnait en ces instants de rêverie où le visage d’Amélie m’apparaissait, à la fois proche et lointain, comme dans un songe. Mais mon premier succès, je le savourai enfin lorsque la petite fille daigna m’adresser un magnifique sourire, d’autant plus précieux qu’il fut le tout premier et le plus évanescent de tous les sourires qu’on me fit jusqu’alors. A partir de ce moment, c’était comme si le gouffre infranchissable qui nous séparait s’était tout à coup refermé et qu’un chemin venait d’être tracé, d’elle à moi et de moi à elle. Et, en effet, à l’étape suivante l’impensable se réalisa, nos mères se parlèrent.
Je me tenais alors tout près d’elle. Amélie jouait à l’enfant sérieuse mais je devinais une moue amusée tandis que je tenais mon petit frère par la main, n’osant pas trop la regarder, mais lançant au passage des regards furtifs, de côté, tout en m’efforçant de n’avoir l’air de rien. L’avait-elle remarqué ? Je l’ai cru timide mais soudain sa main enfermée dans un gant de laine mauve frôla la mienne l’espace de quelques secondes. Douce sensation qui accéléra mon rythme cardiaque à m’en effrayer moi-même. Dans la mesure où nous nous trouvions à environ quatre-vingts centimètres de distance, ce geste qui se voulait opéré par inadvertance était tout sauf involontaire. Une fois un peu remis de mes émotions, je le compris très vite. Etait-ce une invitation ou seulement un test ? Mon orgueil de garçon était en jeu. Et tandis que nos mères étaient occupées à bavarder, je m’adressai à Amélie pour la première fois, ne sachant trop que dire ; je résolus de lui présenter mon petit frère : «C’est Théo», dis-je. J’étais incapable d’articuler autre chose, je sentais que ma voix allait s’étouffer au fond de la gorge comme si une force inconnue me poussait à avaler mes propres paroles. Mais l’effet sur la fillette fut immédiat. Je venais de la prendre au dépourvu. Elle n’était plus aussi sure d’elle ; elle rougit. Elle me regardait avec ses grands yeux. Et alors que je lui souriais, triomphant, elle était comme tétanisée. Je craignis un moment de lui avoir fait peur ou déplu, tout cela était du pareil au même pour moi. Mais, prenant une grande respiration, elle demanda d’une voix douce : «Et toi ?». C’était la première fois que j’entendais le son de sa voix. Il me fallut bien une dizaine de secondes pour m’en remettre et décliner mon prénom. Elle le répéta : «Lucas... et moi c’est Amélie». Je fis comme si je ne le savais pas. A vrai dire, je me sentais à la fois heureux et gêné et n’avait plus de sujet de conversation. C’est Théo qui me sauva la mise en chantonnant, ce qui fit rire Amélie. Ce rire retentit en moi comme un éclat de joie faisant vibrer tout mon corps. Il est vrai qu’elle faisait alors toute petite mais j’aimais cette spontanéité et cela encourageait mon frère ce qui déclenchait à nouveau son rire ; cela m’allait très bien. Au bout d’un moment, j’entendis la mère d’Amélie dire à la mienne que nous nous entendions bien et j’étais aux anges. Cependant, toutes les bonnes choses ont une fin et nous nous séparâmes. Cette fois, Amélie et moi avions le sourire et le regard brillant, de malice pour elle, de tendresse pour moi.
L’étape suivante, nous nous retrouvâmes au parc de la ville, du moins l’un des parcs les plus proches d’où nous vivions. Je ne savais pas qu’elle serait là. Je jouais avec Théo en attendant que mes copains vinssent prendre le relais si toutefois ils montraient le bout de leur nez. C’était un samedi et, parfois, ils partaient en famille avec leurs parents, comme cela pouvait aussi m’arriver. Or la saison du ski venait de commencer. Il restait un peu de neige sur l’herbe, en de rares endroits ombragés. Pas suffisamment toutefois pour confectionner de bonnes boules de neige. Et, contrairement à Théo, je ne partageais pas son plaisir de patauger dans la boue au risque de se couvrir de salissures. Je commençais justement à m’ennuyer quand, en relevant la tête, je vis une dame saluer ma mère, puis aperçus la silhouette d’une fillette dont je reconnus le bonnet multicolore et les gants mauves. C’était elle !
Tout d’abord, elle ne parut pas se soucier de moi, quoiqu’elle daignât, de temps à autres, porter son regard en notre direction. Je pensais qu’elle viendrait nous rejoindre mais elle prit le parti de s'asseoir sur le banc à côté de sa mère. Elle levait la tête et regardait en l’air, puis sur le côté extérieur et enfin elle baissait les yeux, jouant avec ses jambes fines qu’elle balançait d’avant en arrière. Elle paraissait s’ennuyer encore plus que moi avant son arrivée. Pour attirer son attention, j'incitais Théo à chantonner mais il n’en avait pas envie. Alors je le chatouillais et c’était bien difficile de le faire rire avec cette couche de vêtements dans laquelle il était emmitouflé. En vain. Je préférai renoncer avant de me ridiculiser. Prenant mon courage à deux mains, je me levai et allai dire bonjour à la mère d’Amélie. Je ne m’étais jamais senti aussi grand, aussi posé, aussi déterminé. Je voulais l’impressionner, en imposer puisqu’elle me boudait. Au reste, la maman d’Amélie exhorta sa fille à me dire bonjour, ce qu’elle fit d’une voix éteinte et sans enthousiasme. Cela me vexa et je pris place de l’autre côté du banc ; nous étions alors séparés par nos deux mamans. Je feignais d’observer Théo qui tentait de planter un petit bâton dans le sol avec plus ou moins de succès. Il m’arrivait d’envier son insouciance. J’avais oublié que j’étais comme lui à son âge. Mais sur ce banc, je ne songeais qu’à elle. Pourquoi était-elle si distante avec moi ?
« Tu ne vas pas jouer avec ton frère ?» demanda ma mère. Je répondis d’un signe négatif de la tête. Je ne sus alors si mon attitude renfrognée exerça la moindre influence sur ce qui suivit, mais Amélie se leva tout à coup, me glissa dans le cœur un sourire accueillant et partit vers Théo pour lui donner un jouet en plastique. Et tandis que j’observais la scène avec sérieux, je vis mon frère lâcher son bout de bois et prendre le jouet avec lequel il continuait à gratter la terre. Le regard d’Amélie se tourna vers nous – vers moi ? – et elle rit. Elle restait accroupie près de Théo et je me demandais alors ce que je devais faire. Peut-être attendait-elle que je vinsse la rejoindre. Plusieurs fois ses yeux se tournèrent vers le banc. Et à l’instant même où je m’apprêtais à me lever, elle se redressa et rejoignit sa place initiale. Penaud, j’eus l’impression d’avoir gâcher un moment prometteur. Non ! C’était à mon tour de prendre une initiative. Je sortis une brique de jus de fruit et la tendis à Amélie qui la refusa poliment. Elle me souriait et je remarquai qu’elle plaçait le bout de sa langue dans la cavité de sa dent manquante. Il y avait une coquetterie naturelle chez elle. A son tour elle ouvrit le sac de sa mère et en sortit une friandise qu’elle m’offrit. Comme je la remerciais, elle en sortit une autre pour Théo. Elle demanda à ma mère si c’était autorisée et maman n’eut pas le cœur de l’interdire. Lorsque j’allais lui porter le bonbon, elle m’accompagna. «Je boirai le jus de fruit plus tard», précisa-t-elle et j’admirais son aplomb d’autant qu’elle était plus jeune que moi. Et un an de moins, à cet âge, cela compte beaucoup !
Je ne me souviens guère des détails de ce que nous fîmes alors. J’ai gardé en mémoire quelques images précises, comme des gravures constituant autant de pièces d’un gigantesque puzzle, toutes les autres étant manquantes : ses lèvres luisant de sucre posées sur la paille et les petits bruits d’aspiration (plus discrets que les miens), des regards tantôt complices tantôt gênés, des sourires audacieux, des suggestions hasardeuses, des affirmations péremptoires (la plupart apprises à l’école), de rares confidences sur ce que nous aimions sans jamais évoquer de personnes. A l’évidence, nos goûts divergeaient, moins parce qu'elle était une fille que parce qu’elle avait six ans et moi sept. Elle me parlait d’un dessin animé que je ne regardais plus – mais que j’avais pourtant beaucoup apprécié étant plus jeune ; j’évoquais un film qu’elle ne connaissait pas et qu’elle n’avait sans doute pas le droit de regarder. Tout cela était sans importance. Nous parlions, nous échangions et je me sentais si bien en sa compagnie. Et d’ailleurs il nous arrivait de nous retrouver sur certains programmes, certaines lectures, certaines musiques, même certains jeux. Quand il fallut se séparer, je vis bien qu’elle était un peu triste et cela me remua le ventre. Pour ma part, j’étais tout aussi triste mais pas effondré. Nous étions désormais des amis. Et je savais qu’elle tenait à moi. Cependant, seul dans ma chambre, le soir, allongé sous la couette, j’avais beau cherché, je ne trouvais pas le sommeil. Où pouvait-il bien se cacher ? J’aurais tant voulu qu’il m’enveloppât et prolongeât cette journée au parc avec Amélie à travers un rêve. Au lieu de cela, je m’agitais et tournais dans mon lit en murmurant son prénom, avec une timide honte de garçon fier.
Je n’étais guère accoutumé à ressentir de tels émois et j’étais encore trop innocent pour maîtriser l’art de savoir les cacher. Comme mes regards fuyaient vers Amélie à la moindre occasion et que j’avais pris la fâcheuse habitude de préférer sa compagnie à celle de mes amis, certains d’entre eux, sans doute déçus par mon attitude et peut-être un peu frustrés, se mirent à se moquer de moi. N’allez pas vous imaginer que je les délaissais mais je les voyais moins en dehors de l’école et quelques-uns m’en voulurent. Au début, cela prenait la forme de petites réflexions un peu piquantes, mais à la longue ces railleries devinrent de plus en plus fréquentes et pesantes. On me traita même de «fillette» parce que je préférais me retrouver avec une fille plutôt que de m’adonner aux jeux virils de garçons casse-cou. La plupart du temps, je faisais les gros yeux, haussais les épaules et m’éloignais d’eux. Mais il m’arriva un jour, exaspéré, de menacer en brandissant mon poing ; alors je trouvai la parade en répliquant que, contrairement à eux, je n’étais plus un bébé et avais une amoureuse. Je fus moi-même surpris du terme qui était sorti de ma bouche et les avait laissés sans voix. Depuis ce jour, ils n’osèrent plus me brocarder et je me félicitai qu’ils n’aient pas eu le temps de remarquer à quel point j’avais rougi après avoir prononcé ces paroles. Evidemment, je n’en soufflai mot à Amélie ni à qui que ce fut d’ailleurs.
Dans nos échappées et nos moments passés ensemble, il y avait souvent Théo. J’avais pleinement conscience de m’être d’abord servi de mon petit frère comme un appât car le coquin amusait beaucoup Amélie. Il me servit aussi tout à la fois de prétexte et de caution. Enfin, Théo me permettait de me sortir de situations embarrassantes, comme lorsque je ne savais plus quoi dire ou qu’une émotion inattendue me paralysait. Toutes ces stratégies comme toutes les sensation ressenties étaient nouvelles pour moi. Et j’en vins à me demander si Amélie faisait la même expérience. Je me souvenais avoir entendu mes parents me dire que lorsqu’on devenait grand, les choses étaient de plus en plus compliquées et j’avais l’impression que c’était ce qui m’arrivait. Elle était peut-être trop jeune pour se poser toutes ces questions, mais assez finaude pour m’initier aux méandres tortueux des jeux de séduction, elle qui savait parfois souffler le chaud et le froid, ce qui, bien entendu, avait le don de me désarmer et de me rendre plus vulnérable. Ainsi, la plupart du temps, malgré son année en moins, nous étions sur un pied d’égalité.
Enfin le moment tant redouté mais tant attendu se présenta. Ma mère avait invité la mère d’Amélie à boire un café à la maison. Il était entendu que les enfants goûteraient plus tard. Maman m’avait engagé à bien ranger ma chambre. Conseil bien inutile, car j’avais pris soin à l’astiquer et la mettre en ordre, de peur qu’Amélie me fît quelque remarque désobligeante. Je ne voulais pas seulement qu’elle soit propre et rangée, je désirais impressionner mon invitée, une fois de plus. Comme j’avais remporté un trophée – une petite coupe qui me paraissait énorme alors –, je l’avais placée en haut de l’étagère qui faisait face à mon lit, bien en vue. J’avais sorti deux ou trois de mes plus beaux livres pour les poser sur mon petit bureau. Bref, j’avais procédé à quelques aménagements dans le but de donner une image reluisante de moi. Je faisais le fier mais en réalité j’avais peur. Pourtant, cette peur était bien inutile. Amélie était de bonne humeur, elle visita ma chambre, remarquant certains détails qui m’avaient même échappé, elle articulait quelques commentaires flatteurs et me souriait. Puis nous jouâmes un petit moment. Elle aimait particulièrement mes personnages de guerriers et, dans le feu de l’action, j’offris de lui en donner deux, ce que je regrettai par la suite. Au moment où nos mères nous appelèrent pour aller prendre le goûter dans la cuisine, Amélie approcha son visage du mien et me fit un bisou sur la joue. Elle n’eût pu choisir un moment plus embarrassant pour moi, qui, les joues rosies, devait me présenter ainsi au yeux de tous. Encore une fois, mon petit frère me sauva de ce naufrage ; Théo voulut grimper sur la table pour attraper je ne sais quoi, ce qui capta l’attention de tous et fit rire Amélie.
Après cela il n’y eut pas d’autres visites, mais il y eut d’autres baisers, deux d’Amélie et l’un de moi, toujours sur la joue. J’aimais ce contact à la fois doux et chaud. Elle avait toujours les joues chaudes. Alors que nous nous rapprochions et que nos rencontres devenaient plus fréquentes, alors que mes amis en avaient pris leur parti et que tout était redevenu comme avant entre nous, quelque chose arriva. Je ne sus pas tout de suite de quoi il s’agissait. Je m’étonnai d’abord de ne plus voir Amélie et n’en tenant plus, j’interrogeai maman. Elle me dit que ses parents avaient été mutés dans une autre ville. Je ne comprenais pas. Que voulait dire «mutés» ? Ma mère finit par m’expliquer que, pour leur travail, les parents d’Amélie avaient dû déménager, loin, très loin d’ici.
Je ne sus si c’était la rage ou le chagrin qui l’emporta en moi. Mais furieux, désespéré, je partis en courant m’enfermer dans ma chambre et la tête enfouie sous la couette, à l’abri des regards, je laissai s’exprimer toute ma colère et toute ma tristesse.
Il me fallut beaucoup de temps pour quitter cette mine maussade et retrouver le sourire. Je n’avais d’elle que des souvenirs qui s’estompaient rapidement, trop rapidement à mon goût. Aucune photo, aucun dessin puisqu’elle devait m’en faire un mais elle était partie avant... Et si je m’en souviens aujourd’hui du haut de mes vingt ans, c’est parce qu’une Amélie, je veux dire une autre Amélie, vient d’entrer dans ma vie.
VOLO6768
La princesse et le colporteur-troubadour
- Non, non, non et mille fois non !
Le roi ne pouvait accepter une telle décision. Une princesse est née pour épouser un prince, l'aider à régner tout en lui assurant une belle descendance. Pas pour travailler ! Et encore moins pour exercer le métier de garagiste. Amanda, sa fille unique avait eu beau expliquer qu’elle voulait se sentir utile, le roi n’en démordait pas. Il était inconcevable qu’une princesse passe ses journées à rafistoler des moteurs de carrosses.
- Mais c’est justement ça que j’aime, Père, réparer les choses cassées. Oh Mère, intercédez en ma faveur.
La reine qui était aussi blonde que sa fille, sourit de toute sa tendresse maternelle mais en bonne épouse se rangea du côté de son mari. Elle ne cachait pas sa fierté de voir sa fille résolument moderne et tournée vers des réformes intéressantes mais il lui faudrait trouver une autre occupation que celle d’avoir les mains dans le cambouis toute la journée.
- Ma chérie, garagiste, c'est plutôt un métier d’homme. Aucun prince ne voudra t’épouser si tu persistes à t’entêter dans cette voie. Il y a d’autres activités qui permettent de servir à quelque chose. Prends exemple sur ton père ; gouverner, cela s'apprend. Va te reposer et réfléchis à une autre suggestion.
- Oui, Mère !
Elle s'inclina et se retira dans ses appartements. Elle s'allongea sur le lit, invita Boulette sa lapine - meilleure amie et confidente depuis toujours - à la rejoindre et lui raconta sa déconvenue. De leur côté, ses parents s'inquiétaient pour son avenir et celui du royaume tout entier. Toutes les bonnes et riches familles connaissaient la terrible malédiction qui frappait la jeune Amanda, aucun prince ne voulait courir le risque d'être maudit à son tour. La Fée des Vignobles, puissante protectrice du royaume, disparut comme par enchantement le jour de sa naissance et un méchant magicien profita de l'aubaine pour lancer un sort particulièrement odieux à l'enfant : à chaque coucher de soleil, un bloc de glace se logerait dans son cœur pour fondre chaque matin à l'aurore. Le roi et la reine qui ne l'avaient offensé en rien, le supplièrent, lui promirent tout ce qu'ils possédaient et offrirent même d'être maudits à la place de leur fille. Refus sur toute la ligne. Le magicien jouissait trop de la souffrance qu'il pouvait leur infliger, cela valait pour lui tout l'or du monde. Son comportement relevait du plaisir simple de faire souffrir à l'état pur. L'immonde magicien avait bien effectué sa sale besogne et tout vantard qu'il était, avait prévenu tous les royaumes à la ronde du tour qu'il venait de jouer, pour insuffler crainte et obéissance. Il rappela qu'il aimait beaucoup l'or, car la formule qui consistait à changer le plomb en or n'était qu'une hérésie et les principautés alentour payaient un tribut pour leur tranquillité d’esprit. Pour essayer de contrer le sortilège, on fit appel aux plus grands médecins et spécialistes. La princesse suivit des traitements médicamenteux chimiques, naturels, avala des potions, croqua des pilules, ingurgita des mixtures, le tout sans résultat. On se tourna alors vers la bonne magie. Les meilleurs sorciers, lutins et grandes fées utilisèrent tout leur arsenal. Mais le sort était trop puissant et sans l'aide de la Fée des Vignobles, ils firent chou blanc. Ainsi, chaque soir, la princesse Amanda se couchait le cœur pris dans les glaces, même pendant les chaudes nuits d’été. Seule Boulette sa lapine la réchauffait un peu avec son doux pelage quand elle se blottissait contre elle. Le temps passant, la princesse apprit à vivre avec le mauvais sort. Elle préférait ne pas le traiter en ennemi. Si elle essayait de l'apprivoiser, il serait peut-être moins virulent. Les derniers rayons du soleil allaient quitter l'horizon quand elle vit l'heure sur la petite horloge. Elle sortit précipitamment, laissant Boulette tout ébahie.
- Mère, Père, j'ai trouvé, dit-elle en ouvrant la porte de la grande salle du trône. Je veux être horlogère.
À cette nouvelle idée, la reine faillit s’étouffer et le roi fit les gros yeux.
- Mais voyons Père, un des rois de France était bien connu pour ce dada.
- Ma petite fille, reprit le roi, ton idée n'est pas mauvaise mais tu te vois au sommet des églises pour réparer les mécanismes des cloches ?
- Je veux me sentir utile, que mon peuple soit fier de moi.
- Pourquoi pas la couture ? suggéra la reine. Avec tes doigts de fée, ce serait plus attrayant ?
La princesse fit la moue.
- Tu ne dis rien ? remarqua le roi.
- C'est pourtant utile, tu aides, et c'est ce que tu veux faire : aider.
- Mère, je ne suis pas très douée pour ça. J'ai besoin de trouver autre chose.
- La nuit porte conseil ; tu vas nous surprendre, j'en suis certaine.
Amanda allait embrasser ses parents quand le froid se propagea à tout son corps. La nuit venait d'étendre son grand manteau noir et la malédiction pouvait commencer. Le roi porta sa fille engourdie par le froid dans ses bras, vers la chambre où Boulette l'attendait impatiemment, espérant la réchauffer un peu comme chaque soir. Lorsque le roi et la reine se retrouvèrent seuls, ils pleurèrent à chaudes larmes, leur fille ne méritait pas une telle calamité. Soit, si elle voulait être garagiste ou bien horlogère, ils accepteraient mais ils espéraient quand même au fond d'eux qu'elle renoncerait à ces deux métiers plutôt masculins pour en trouver un plus approprié à son rang.
Ils organisèrent des bals, des tournois, des fêtes où ils invitèrent chevaliers, nobles et dignitaires importants de contrées lointaines espérant qu'ils ne soient pas au courant de la malédiction, mais qu'à ces occasions Amanda rencontrerait l'amour. Malheureusement l'alchimie qui peut se produire entre deux êtres ne se produisait jamais. Le roi ne désespérait pas qu'à la prochaine festivité, Cupidon serait au rendez-vous. La princesse jouait, s'amusait, riait, dansait et les rares fois où son cœur battit un peu plus vite pour un garçon, le terrible sortilège gâchait tout. Qu'il soit chevalier, noble ou dignitaire, ils fuyaient à toutes jambes sans exception. La reine la consolait de son mieux et répétait qu'ils ne la méritaient pas. Sa fille était ravissante mais cela ne suffisait pas à braver l'obstacle du malheur.
Le lendemain, la blonde princesse n'ayant pas trouvé de nouvelles idées, décida de se promener en allant au marché pour acheter des carottes à Boulette. En chemin, elle rencontra une petite fille en larmes.
- Pourquoi pleures-tu donc ?
- C'est à cause d'Irène.
- Irène ?
Elle lui montra sa poupée.
- Ah Irène !
La poupée de chiffons usée jusqu'à la corde avait la jambe droite qui ne tenait plus qu'à un fil.
- Je ne sais pas comment faire pour la remettre. Je n'ai pas assez d'argent pour la faire réparer et je ne sais pas coudre.
- Si tu veux, je vais m'en occuper.
- Mais vous êtes la Princesse !
- Oui et alors ? Tu crois que je n'en serais pas capable ? Je suis une princesse, et les princesses savent tout faire.
- Est-ce qu'Irène aura mal ? Ce sera long pour la guérir ?
- Je ferai très attention, elle ne souffrira pas, tu as ma parole.
- C'est vrai ?
- Je te le jure sur la bonne Fée des Vignobles ! Mais dis-moi, comment t'appelles-tu ?
- Jeanne.
- Eh bien Jeanne, j’emmène Irène avec moi. Je vais acheter des carottes pour ma lapine puis je m'occuperai de ta poupée. Je te donne rendez-vous demain au stand des fruits et légumes de Monsieur Christophe. D'accord ?
- Oui, merci princesse.
De retour au château, Boulette eut droit à un véritable festin alors qu'Amanda s'appliquait avec patience et minutie à recoudre la jambe cassée de la pauvre Irène. Elle se piqua plus d'une fois et le résultat ne fut pas à la hauteur des attentes espérées. Après plusieurs essais plus ou moins catastrophiques, la princesse convoqua en désespoir de cause la couturière de la cour. La reine fut ravie d'apprendre par sa dame de compagnie que sa fille avait demandé de l'aide à la spécialiste : enfin elle allait se ranger et oublier ses lubies de mécanique. Ce premier palier franchi, elle lui ferait consolider cette passion avec la cuisine, le chant, la danse, la peinture et d'autres activités plus féminines afin de devenir une parfaite épouse. Irène recousue, mille questions assaillirent Amanda. Cela tournait tellement dans sa tête qu'elle dut s'allonger. La couturière alla immédiatement chercher ses parents. Quand ils arrivèrent leur fille présentait une mine radieuse. Étonnés - la couturière les avait affolés - ils s'approchèrent.
- Père, Mère, j'ai enfin trouvé ce que je veux faire dans la vie. Et ce sera utile pour tous nos sujets un jour ou l'autre.
Sa mère se gonfla d'orgueil. Elle se doutait de ce qu'elle allait dire.
- C'est en réparant Irène cette poupée de chiffons que m'est venue la vocation.
Le roi écoutait avec attention tandis que la reine avait le feu aux joues.
- J'ai pris ma décision. J'ai décidé de devenir kinésithérapeute.
La reine crut tomber à la renverse, elle ne s'attendait pas à ça. Que venaient faire cette poupée et le métier de kinésithérapeute ici ?
- Il y a dans notre royaume des gens qui travaillent dur, que ce soit dans les champs, les vignes ou les forêts. Il est de mon devoir de les aider à recouvrir l'usage de leurs membres cassés s'ils se blessent. Je serai ainsi utile à mon peuple. Et à côté, je continuerai d'apprendre tout ce qu'il faudra pour être une bonne épouse comme maman. Qu'en pensez-vous ?
- Tu es bien ma fille, répondit fièrement son père.
La reine en avait les larmes aux yeux. Elle l'encouragea vivement et lui promit tout son soutien.
Amanda suivit une formation intensive. Sa volonté, son désir d'apprendre, sa soif de connaissance étaient impressionnants. Elle consacra tout son temps à travailler et travailler encore. Elle s'était fixé comme objectif d'être la meilleure et elle y parviendrait. Mais, d'abord comme promis, elle rapporta à Jeanne sa poupée guérie. Amanda en voyant le plaisir de l'enfant comprit qu'elle avait fait le bon choix. Tout le peuple la soutenait dans sa démarche. Très rapidement, elle devint la meilleure kinésithérapeute de tout le royaume. Sa renommée dépassa même les frontières du pays. La princesse demanda juste un peu d'aide magique pour mieux savoir faire la cuisine, coudre ou danser.
Du bûcheron à la lingère, du vigneron à la couturière, du palefrenier à la maraîchère, on réclamait l'assistance de la princesse pour soulager et soigner toutes sortes de blessures. Lors de nouveaux bals, Amanda vint à la rescousse de princesses qui s'étaient tordu la cheville ou avaient des pieds meurtris par les cavaliers trop maladroits. D'autres tournois eurent lieu et la jeune kinésithérapeute soigna des chevaliers. Elle remarqua très vite que la plupart étaient de vraies poules mouillées mais afin de recouvrer le plus rapidement possible l'usage de leurs membres fracturés, ils faisaient avec soin la rééducation qu'elle leur prodiguait. La malédiction cependant la poursuivait toujours et chaque soir le froid gardait son cœur prisonnier des glaces, la laissant seule dans son grand lit.
C'est lors d'un jour de marché que se produisit l'accident. Ni une ni deux, on transporta le blessé par charrette à Pierre-Haute le dispensaire royal où exerçait Amanda.
- Jeanne, mais qu'est-ce que tu fais là ?
- Je vous amène le colporteur-troubadour, princesse.
- Princesse ? demanda le blessé alors que la douleur se faisait sentir.
- Tout le monde m'appelle comme ça. C'est un surnom, répondit-elle en faisant signe à Jeanne, l'index sur les lèvres, de garder le secret.
- Où est ma compagne de route, ma chère guitare ? demanda-t-il en serrant les dents.
- Jeanne vous l'apportera. Mais pour l'instant, je dois vous examiner. Qu'est-ce qui s'est passé ? Jeanne, raconte-moi tout.
- Un bruit a effrayé le cheval et il s'est emballé. Comme je parlais avec Irène, je ne faisais pas attention et je n'ai pas vu arriver le carrosse. Ce monsieur a surgi et m'a poussée pour éviter que je ne me fasse renverser. Puis il a attrapé la bride du cheval, mais le mouvement d'avant en arrière a été trop brusque et il est mal tombé.
- Je vois. Je m'occupe de tout. Vous êtes...
- Matteo-Mathias. C'est d'origine... Aouh, répondit-il en essayant vainement de masquer sa douleur quand Amanda palpa sa jambe.
- Vous me raconterez plus tard d'où vient votre prénom. Je vais appeler notre magicien de garde pour calmer la douleur.
Jeanne se tourna vers le colporteur-troubadour : « Merci de m'avoir sauvé la vie. Vous êtes mon héros. Je reviendrai vite avec votre guitare c'est promis. Au revoir princesse ».
Et elle partit en courant.
- Combien de temps je vais devoir rester ici ?
- Au moins six semaines.
- Six semaines ? C'est beaucoup trop long ! Je dois reprendre la route.
- Si vous suivez mes conseils, ce sera plus court.
- La magie ne pourrait pas tout réparer ?
- Non, ce serait extrêmement dangereux ! Les os, les ligaments et les muscles réagissent de manière trop aléatoire à une intervention magique. Je reviens.
Elle arriva quelques instants plus tard avec le magicien qui fit quelques passes magiques-magnétiques, le mal disparut et le colporteur-troubadour sombra rapidement dans le sommeil. Elle s'occupa de ses autres patients et finit sa journée. En rentrant, Amanda eut une longue conversation avec sa lapine.
- Boulette, j'ai un nouveau patient. Un bien grand gaillard avec des cheveux noirs. Il a empêché Jeanne, tu sais la petite fille à la poupée, de se faire renverser. Mais c'est lui qui s'est fait une entorse au genou.
La lapine opina des oreilles.
- Il est colporteur-troubadour. C'est original comme métier, tu ne trouves pas ? Il portait une chemise couleur bronze avec des broderies dorées et un t-shirt rouge en dessous. N'importe quoi. Je me demande bien pourquoi je te dis ça. Enfin je te raconte toujours tout, n'est-ce pas ?
Elle aurait juré que Boulette avait esquissé un petit sourire moqueur.
- Il a un prénom étrange, il s'appelle Ma...
Elle ne put finir sa phrase attaquée par le froid qui venait d'envahir tout son être. Elle supplia le sommeil de vite lui venir en aide. Boulette se blottit contre elle et s'endormit après l'avoir veillée longuement.
***
Le lendemain au dispensaire de Pierre-Haute
- Bonjour colporteur-troubadour.
- Bonjour princesse.
- Avant de commencer, j'aimerais quand même savoir d'où vient votre étrange prénom.
- Mes grands-parents venaient à la fois de la chantante Italie et de l'Allemagne romantique. Mes parents ont voulu leur rendre hommage et c'est ainsi que j'ai hérité du prénom de Matteo-Mathias.
- Il est très beau.
Elle remarqua qu'il avait les yeux clairs. Il faudrait qu'elle en informe Boulette. C'était une information capitale.
- Merci princesse. Heu, c'est normal que je commence à nouveau d'avoir mal ?
- Je suis désolée. La magie antalgique s'estompe rapidement et il ne faudra pas en abuser. Dès que cela devient insupportable, nous mettrons un petit coup de baguette pour vous soulager provisoirement.
Matteo-Mathias la regarda d'un peu plus près. Petite, blonde, des yeux noisette, vraiment mignonne. On aurait dit une princesse, pensa-t-il, un surnom qui lui allait comme un gant.
- Je vais entamer les soins. Dois-je prévenir quelqu'un que vous êtes ici ?
- Mes sœurs habitent loin, elles savent que je suis sur les routes mais le temps de les avertir, je devrais être guéri.
- Je vais tout faire pour cela. Par contre, j'ai de la peine de vous savoir tout seul.
- Je ne suis jamais seul, j'ai ma guitare.
Et il se pencha pour la sortir de sous le lit tout en serrant les dents quand la douleur se fit trop forte.
- Je constate que Jeanne est déjà passée.
- Oui, juste avant d'aller à l'école. Et puis, vous êtes là.
Il rougit légèrement en disant cela et Amanda le remarqua.
- Je vais vous faire un massage doux pour décontracter le muscle du genou. Puis nous utiliserons la cryothérapie pour diminuer l’œdème et bien sûr la douleur.
- Je suis entre vos mains.
L'ourlet de son oreille vira au cramoisi et Amanda s'en apercevant, rougit à son tour. Elle commença le massage puis elle lui mit quelque chose autour du genou.
- Qu'est-ce que c'est ?
- C'est un appareil en toile matelassée munie d'armatures et fermé par des bandes Velcro. Ça sert à immobiliser les fractures ou les luxations des membres inférieurs. Et voilà. Je vais m'occuper des autres. Il faudra de la patience Matteo-Mathias, mais tout ira bien.
Les jours s'ajoutaient aux jours, le colporteur-troubadour suivait docilement sa rééducation. Elle aimait passer du temps avec lui. Son métier l'intriguait. Bon orateur, il déclamait des poèmes, aimait lire, composer des chansons, vendre toutes sortes d'objets et par-dessus tout, jouer de la guitare. Elle parlait de lui chaque soir avec Boulette et n'imaginait pas qu'il faisait de même la concernant avec sa fidèle guitare. Il avait décidé de suivre une quête : offrir une culture libre à tous. C'est pour cette raison qu'il avait pris la route et partageait son savoir en l'enrichissant par ses rencontres et échanges. Elle était conquise par cette idée. Elle-même avait maintes fois proposé des réformes à son père pour améliorer les conditions de vie de leurs sujets. Matteo-Mathias continuait de parler et elle ne faisait que regarder sa bouche… Sa bouche… Il lui fallut du temps pour revoir l'ensemble du décor environnant. C'est la patiente au bras cassé qui la ramena sur terre. Elle laissa à regret son colporteur-troubadour qui la suivit du regard alors qu'elle franchissait la porte de la chambre voisine. Qu'elle est belle, pensait-il, dans sa blouse blanche avec son sourire, son rire ! Il se rappelait tout d'elle, même de la jolie bretelle violette de soutien-gorge qu'il avait entre-aperçue.
En rentrant chez elle, Amanda eut l'envie de lui faire plaisir, elle appréciait cet homme. C'était la première fois qu'une idée pareille lui passait par la tête. Mais pas question d'appeler la cuisinière en chef qui raconterait tout à ses parents. Ils tireraient instantanément des plans sur la comète. Il n'était qu'un patient après tout et l'intéressait justement parce qu'il était intéressant et rien de plus, se mentait-elle. Elle avait eu recours à la magie pour apprendre mieux et plus vite. Il n'y avait plus qu'à la mettre en pratique. Elle s'appliqua soigneusement à confectionner un cake aux olives. Fière de son ouvrage, elle taquina son patient quand elle le vit le lendemain.
- Si vous faites bien vos exercices de rééducation, il y aura une surprise.
- Vous piquez ma curiosité chère princesse. Allez, dites-moi ce que c'est ?
- Ta ta ta d'abord le travail, la récompense ensuite.
- Tortionnaire
- Non, princesse-kiné ! fit-elle avec un clin d’œil.
Comme chaque jour, Matteo-Mathias s'appliqua avec soin. Il marcha avec des cannes, continua son renforcement musculaire sur le tapis pour se réentraîner à la marche, s'assit sur une chaise pour monter et descendre sa jambe et termina avec un exercice d'assouplissement. Parfois la douleur était vive et le découragement rôdait autour, près à fondre sur lui comme l'aigle sur sa proie. Mais il tenait bon. Amanda le soutenait de son mieux puis allait rendre visite à ses autres patients tout en le surveillant de loin. Le colporteur-troubadour termina sa séance en faisant des mouvements dans la piscine. Il faudrait qu'elle raconte à Boulette qu'il portait un maillot de bain gris. C'était pas commun. En fait, elle pensait à lui tout le temps. Si seulement c'était réciproque. Elle revint plus tard avec un petit sac.
- Bravo, je suis très fière de vous !
- J'ai donc mérité ma récompense.
- En effet !
Elle déballa assiettes, serviettes, gâteau salé. Elle coupa quelques tranches et lui présenta le tout.
- Un cake aux olives, j'adore ça. Mais pour quelle occasion ?
- Comme ça, pour le plaisir.
- Ben merci beaucoup princesse.
Matteo-Mathias attrapa la première tranche qui s'émietta sur-le-champ. Il eut un petit sourire gêné mais en avala une bonne part.
- Il est rudement bon.
La tranche qu'Amanda prit, tomba en miettes comme tout le reste du cake.
- Je suis désolée. Je ne comprends pas, ce n'est pourtant pas la première fois que j'en fais un.
- C'est l'intention qui compte, la consola-t-il avec un large sourire.
Ce garçon la troublait. Et pour revenir au cake, il n'y avait pas à dire, la magie concernait l'apprentissage théorique culinaire mais pour le reste, elle manquait cruellement de pratique ou alors quelque chose ou quelqu'un avait perturbé ses pensées, voire les deux. Elle le regarda et se pencha vers lui. Son cœur se mit à battre plus fort, plus vite, c'était incontrôlable et délicieux à la fois. Il s'approcha d'elle et ils s'embrassèrent. La dame au bras cassé rompit le charme en appelant la princesse.
Amanda flotta sur un petit nuage tout le reste de la journée. C'est Boulette qui n'allait pas en croire ses grandes oreilles, elle serait la première à être au courant. Elle ne vit pas le soleil se coucher, tellement elle répétait encore et encore cette merveilleuse journée à sa lapine : ils s’étaient embrassés. Alors qu’elle caressait délicatement Boulette, elle se surprit à imaginer qu’elle passait ses mains sur le torse velu de Matteo-Mathias. Le bloc de glace réagit très violemment à cette fantaisie de l’esprit. La princesse s’écroula de douleur sur le sol. L'attaque glaciale sur son cœur n’avait jamais été aussi puissante. Elle finit par se relever péniblement et mentit du mieux qu’elle put à sa lapine qui s’était cachée sous l’armoire. Elle lui assurait que ça allait, tandis que Boulette semblait lui dire « c'est ça, prends moi pour une salade ». Reprenant son souffle, elle eut peur, se sentant perdue. Matteo- Mathias fuirait comme tous les autres quand il connaîtrait la vérité. C'était pourtant l'homme de sa vie, elle le savait au plus profond d'elle-même et pour que le bloc de glace réagisse de cette façon, c'est qu'il sentait l'immense menace qu'il pouvait représenter. Mais Matteo-Mathias serait-il assez fort pour l'aimer malgré cette horrible malédiction ? Est-ce lui qui pourrait l'en débarrasser à tout jamais ou n'était-ce qu'un baiser pour du beurre ? Elle se sentait tellement bien avec lui. Sa dernière pensée avant de s'endormir fut pour lui, malgré des doutes affreux.
***
Le lendemain, après des années d'absence, le méchant magicien fit une annonce dans tout le royaume.
- Torturer la princesse ne m'amuse plus. Dans ma grande bonté, je suis décidé à lever la malédiction à la condition qu'on coupe la tête de Boulette dans une heure sur la place du marché.
À cette annonce, Amanda perdit connaissance dans la salle du trône. Ses parents étaient très ennuyés, ils avaient enfin le moyen de délivrer leur fille mais à quel prix. Une heure c'était relativement court, il fallait prendre une décision : ce n'était qu'une lapine après tout. Ils transportèrent leur fille dans sa chambre, saisirent Boulette qui ne se méfiait pas et enfermèrent la princesse à double tour.
- Nous n'avons pas le choix, dit le roi.
- Elle nous pardonnera un jour, répondit la reine.
Ils partirent pour la place du marché avec la pauvre lapine qui gigotait dans un sac de jute.
Amanda se réveilla brusquement et appela Boulette. Elle comprit très vite que ses parents allaient sacrifier cette pauvre bête pour la sauver. Elle se précipita sur la porte et essaya vainement de l'ouvrir. Elle s'acharnait sur la poignée mais celle-ci ne cédait pas, il fallait trouver un autre moyen. Elle se mit à réfléchir : sauter par la fenêtre, bien trop haut ; défoncer la porte, bien trop difficile. Il lui restait l'option de nouer les draps et les rideaux pour en faire une corde mais elle n'arriverait jamais à temps, quand soudain, elle aperçut Jeanne au loin.
- JEANNE, cria-t-elle de toutes ses forces et fit de grand signes.
- Princesse ? répondit Jeanne qui s’approchait du château.
- Écoute-moi bien. Va chercher ton héros et courez aussi vite que possible sur la place du marché. Ils vont tuer ma lapine Boulette. Il faut les en empêcher. Tu as bien compris ?
Jeanne s'élança comme le vent alors que la princesse coincée dans sa tour invoquait avec l'énergie du désespoir la bonne Fée des Vignobles.
La foule s'était peu à peu rassemblée sur la place où le méchant magicien aux côtés du roi et de la reine regardait la pauvre Boulette se débattre. Celle-ci avait bien compris que quelque chose ne tournait pas rond. Le bourreau l'attacha, leva sa hache, prêt à lui couper la tête quand il reçut en pleine face… une guitare. Matteo- Mathias à peine essoufflé sauta sur l'estrade, poussa le bourreau tandis que Jeanne délivrait la victime. L'air mauvais, le méchant magicien regarda ce grand jeune homme aux yeux clairs et aux cheveux noirs qui avait interrompu la fête. Alors que le bourreau peinait à se relever, Jeanne constata que la guitare était fichue.
- C'est donc toi le freluquet qui fait battre le cœur de la princesse, toi dont elle parle à Boulette tous les soirs.
Et il imita Amanda en minaudant : « si tu voyais son dos, si tu voyais ses épaules. Et son nez, et sa peau, et ses oreilles. »
Le bloc de glace faisait donc office d'espion. Jeanne scruta son héros puis posa le regard sur le méchant magicien. Il ne s'était pas vu dans un miroir depuis longtemps celui-là, pensa-t-elle.
Le colporteur-troubadour ne se laissa pas démonter.
- Je vous échange la vie de Boulette et la levée de la malédiction contre ce que j'ai de plus précieux. Devinez donc, magicien, ce que cela peut être. C'est plus ou moins rond, jaune et plus gros que des noyaux de cerises.
- De l'or ! Sombre crétin ! Des pépites d'or, répondit-il les yeux presque fous.
- J'ai de quoi vous remplir cette guitare. Acceptez-vous le marché ?
- Plus grosses que des cerises, dis-tu ? C'est d'accord.
- Vous le jurez ?
- Oui mais je veux tout ton or dans une demi-heure. Si tu ne respectes pas les délais, tu le paieras de ta vie !
- NON, hurla Amanda qui avait réussi à s'enfuir selon la tactique des draps noués.
- Princesse quel honneur, se régala le méchant magicien. Je veux son or et estimez-vous heureuse que je ne vous demande pas en mariage.
- Matteo-Mathias, où allez-vous trouver tout cet or ? Vous êtes colporteur-troubadour, je vous le rappelle.
- Et alors ? répondit celui-ci un peu vexé.
- Je vous laisse à vos querelles d'amoureux. Je reviens dans trente minutes.
Et il disparut dans un épais nuage de fumée noire.
- Princesse, moi, je vous ai fait confiance pour sauver mon genou. Alors croyez en moi !
Jeanne s'approcha avec Boulette qu'elle donna à Amanda.
- Je vais avoir besoin de magie, dit le jeune homme. Ne me posez aucune question, le temps nous est compté. Je sais ce que je fais.
Amanda qui avait l'habitude de commander de par son titre et sa fonction découvrit une autre facette de son colporteur-troubadour.
- Faites ce qu'il dit, ordonna le roi.
- Pardonne-moi ma chérie mais c'était pour ton bien.
- Je sais.
Boulette fronça le nez. Il donna des ordres, et les sorciers, lutins et grandes fées l’aidèrent à téléporter de sa région natale, la précieuse cargaison directement dans la guitare. Le méchant magicien revint pile à l'heure. La foule était craintive. Matteo-Mathias s'approcha, sûr de lui, vers le magicien et lui tendit la guitare.
- Je te donne ce que je t'ai promis.
Le méchant magicien lui arracha la guitare et prit l'or à pleines mains.
- Mais ce n'est pas de l'or, constata-t-il.
- Je ne t'ai jamais promis d'or ! C'est toi qui a en parlé. Ces pépites comme tu dis, sont la fierté de ma région. Ce sont des mirabelles. Et leur vente rapporte beaucoup d'argent.
La foule était médusée. Il était malin le colporteur-troubadour.
- Tu m'as eu, mais jamais je ne délivrerai la princesse. Tu entends JAMAIS !!!
- Tu te parjures ?
- Et comment !
- LIBRE enfin, s'écria Boulette qui se transforma en Fée des Vignobles sous les yeux ébahis de la foule. Tu t'es parjuré et cela a annulé ton sort qui m'avait métamorphosée en animal.
C'était donc ça, pensa la foule. Elle ne les avait pas abandonné. Et la Fée des Vignobles lança une attaque magique sur le méchant magicien qu'il contra très facilement.
- Tu es rouillée, ma pauvre vieille. Occupe-toi donc de ça.
Et il transforma tous les humains présents en sangliers fous, sauf Matteo- Mathias et Amanda qui avaient paré le coup. Les sorciers, lutins et grandes fées désenchantaient, désenvoûtaient, désensorcelaient les sangliers mais cela prenait du temps et le désordre était grand. L'affrontement entre la Fée des Vignobles et le méchant magicien continuait, tandis que le colporteur-troubadour essayait de protéger les humains chargés par les sangliers.
Le titre de puissante Fée des Vignobles n'était pas usurpé, elle avait vite retrouvé toute l'étendue de ses pouvoirs. Le méchant magicien constata rapidement que le combat ne tournait pas à son avantage. Il lança un dernier jet de magie maléfique en direction de la princesse. Mais c'était sans compter sur Matteo-Mathias qui se jeta devant elle pour faire bouclier de son corps et s'écroula. La Fée des Vignobles riposta violemment et le méchant magicien disparut. Tous les sangliers reprirent forme humaine. La foule restait muette alors que le corps froid et sans vie du colporteur-troubadour gisait aux pieds de la princesse.
- Mon enfant, je ne peux rien faire. Je suis sincèrement désolée, lui annonça la Fée des Vignobles. Je n'ai pas le pouvoir de ressusciter les morts.
La princesse tomba à genoux et serra son amour perdu contre elle. C'est à ce moment que son cœur, prisonnier des glaces pendant des années, se mit à irradier d'une telle chaleur qu'elle passa à travers le corps de Matteo-Mathias qui se réveilla. La foule était subjuguée.
- Dites-moi belle Fée des Vignobles, demanda Jeanne rompant le silence, qu'est devenu le méchant magicien ?
- Je l'ai envoyé chez ma cousine dans le royaume des terres gelées. Mais j'ai pris soin de lui faire un petit cadeau. Il aura toujours tellement chaud qu'il sera capable de faire fondre la glace sous ses pieds. Il devra donc éternellement courir pour éviter de se noyer. Raffiné, n'est-ce pas ?
Personne n'osait répondre non par crainte mais par respect. La princesse- kinésithérapeute et le colporteur-troubadour se regardèrent très longuement sans rien dire. Alors que la foule attendait et que rien ne se passait, Jeanne lança : « ben alors, il vient ce baiser ? ».
Ils s'embrassèrent sous les hourras, les applaudissements (même ceux de la patiente au bras cassé), les vivats, les acclamations de tous. Le roi et la reine étaient aux anges de voir leur fille si heureuse avec ce garçon. La Fée des Vignobles donna un coup de baguette magique et répara la guitare qui fut comme neuve.
- Merci Boulette, euh je veux dire Fée des Vignobles, dirent les amoureux.
- Je compte sur vous pour faire de votre vie à deux un conte de fées.
- Nous y veillerons.
Et depuis, tous les soirs quand la princesse Amanda va se coucher, son époux, le colporteur-troubadour lui lit un conte de fées pour elle tout en lui caressant tendrement les cheveux. Inévitablement, elle s'endort dans ses bras et n'a plus jamais froid.

Votez pour vos nouvelles préférées
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 465 autres membres